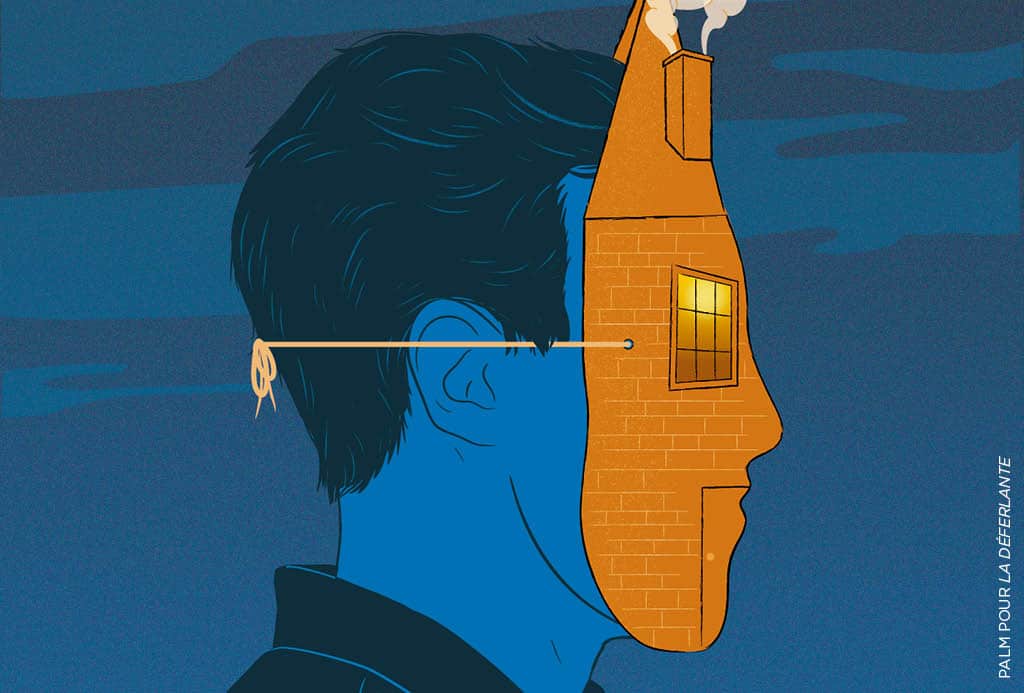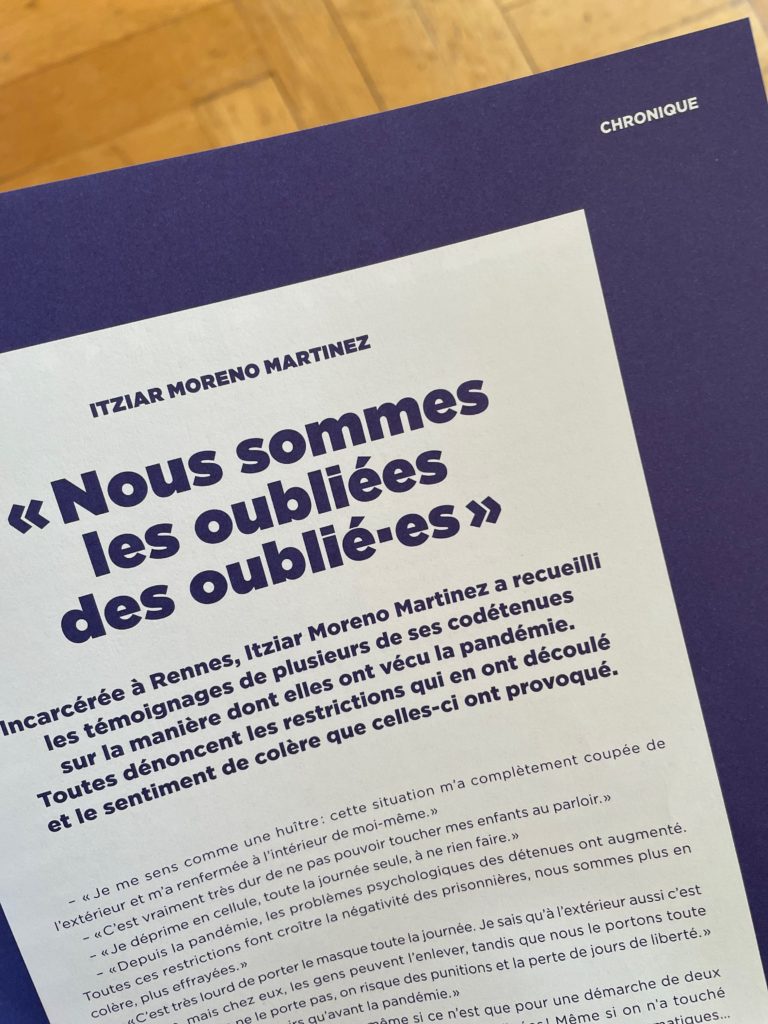J’ai 46 ans aujourd’hui. Après une décennie passée derrière les barreaux et 14 mois de bracelet électronique, me voilà libre de ma « dette », de mes mouvements et de mon avenir.
Cela n’est pas gai, certes, mais tellement quelconque dans l’univers carcéral, où cohabitent des vies cabossées et des âmes meurtries. Le point commun entre nous toutes : une existence qui mène droit dans le mur. Ce mur arrive plus ou moins tard et sous différentes formes, en fonction des crimes ou des délits commis. Toujours est-il qu’en ce qui me concerne, à force de ranger soigneusement mes blessures dans des petits tiroirs pour, tout à la fois, les supporter et les occulter, la commode a fini par céder. Brutalement.
Littéralement radiée de la société
Dans un état dépressif sévère et avec un discernement altéré, j’ai voulu mourir, mais en emmenant avec moi mes deux têtes blondes de 8 et 4 ans. Bien plus tard, je me suis réveillée à l’hôpital. Seule. Eux n’ont pas survécu. À mon réveil, je fus accueillie par un policier, planté devant moi : « À compter de cette heure, madame, vous êtes en garde à vue. » 48 heures plus tard, je me suis retrouvée alors, pour la première fois, face à un juge des libertés et de la détention. Sur le plan légal, c’est à ce moment précis que les acteur·ices de la magistrature se proclament représentant·es et défenseur·esses de la « société ». Elles et ils œuvrent alors pour déterminer ce que vous méritez, et c’est bien normal, mais aussi ce que vous êtes. Cela est plus délicat et hasardeux, car elles et ils ne vous jugent qu’au prisme de votre acte. Plus tard, à la suite de l’enquête menée par les expert·es psychiatriques, au moment du procès, c’est votre personne, l’être humain que vous êtes, votre histoire, votre personnalité et même votre apparence qui sont décortiquées et jugées avec pour principaux outils, tel que je le ressens alors, l’orgueil et le mépris.
Ma culpabilité est abyssale, j’ai créé un raz de marée chez toutes celles et ceux qui ont connu mes deux enfants. C’est un fait, mon acte est terrible et incompréhensible, mais il ne me définit pas. Du premier au dernier jour de détention, j’ai été littéralement radiée de la société, physiquement, socialement, civiquement. Je n’étais plus une femme, ni une mère, ni une soeur, ni une fille, ni une collègue. Seulement une détenue et une affaire judiciaire.
Retrouver ma place
Tout est chiffre ou devient chiffre : numéro d’écrou, numéro de cellule, nombre d’années de peine à effectuer, travail rémunéré à la pièce, achats du quotidien (limités, y compris pour l’hygiène !), articles et alinéas du Code de procédure pénale pour essayer de comprendre ce qui vous arrive, jusqu’au calendrier accroché à la porte de la cellule. Le temps s’écoule dans cette salle d’attente de la vie et j’attends patiemment de retrouver ma « place ». Par chance, j’ai fait une belle rencontre, je me suis mariée à Fresnes en 2013 avec un homme que j’avais connu bien avant mon incarcération et j’ai eu une petite fille à la prison de Rennes en 2015. Alors cette sortie, je la rêve. Février 2020, la grande porte s’ouvre enfin. La chaleur d’un foyer, l’amour des miens, ça y est, j’y suis ! Le bracelet électronique et le confinement n’ont aucun impact sur mon bonheur, tout est doux et léger.
Cette place dans la société, j’ai toutefois un mal fou à la retrouver. De mon côté, je me sens alors prête et confiante. Je suis libérée, mais avec pour seul document officiel en poche mon « billet de sortie » et son en-tête du ministère de la Justice. Si, dans un premier temps, je pense que ce sera mon sésame pour reprendre ma vie en main, je constate que ce bout de papier me renvoie sans arrêt à mon ancien statut. Il me stigmatise. Il fait office de pièce d’identité et presque de CV. Partout je dois le présenter pour justifier le fait d’arriver sans dossier et sans passif : à la banque, auprès de la Sécurité sociale, dans les cabinets médicaux, etc.
À plusieurs reprises, on me demande de fournir un certificat d’hébergement rédigé par mon mari. Aux yeux de l’administration pénitentiaire, je ne suis donc pas son épouse mais une personne qu’il héberge, comme quelqu’un de passage ou un banal site Internet ! Même chez moi… je ne suis pas vraiment chez moi. Ma fierté est blessée. La conseillère d’insertion chargée du suivi de la période sous bracelet me sermonne fermement : il n’est pas question que j’utilise mon nom d’épouse puisque le ministère de la Justice m’identifie sous mon nom de jeune fille. L’infantilisation n’a plus de limite, on choisit mon identité à ma place. Moi qui pensais être libre après avoir franchi la porte de sortie…
Il y a eu aussi cette autre conseillère qui après m’avoir annoncé que je n’aurai aucune allocation chômage après dix ans et demi d’activité en détention (le droit du travail ne s’applique pas aux détenu·es) se croit rassurante en me disant avec un grand sourire : « Mais ce n’est pas grave, vous avez un mari ! » Le jour de mon procès, j’ai été jugée par un procureur représentant la « société ». Durant toute ma détention, j’ai imaginé que la sortie serait mon eldorado, qu’elle signerait mon retour dans cette « société ». Une fois dehors, j’ai eu le sentiment que les institutions, les règles et les normes qui régissent notre société me fermaient de nouveau la porte, qu’elles m’enfermaient encore. Je n’ai pas baissé les bras, j’ai lutté pour redevenir une femme indépendante et libre. Aujourd’hui, j’exerce un métier à travers lequel j’aide les autres à trouver leur place dans le monde du travail.