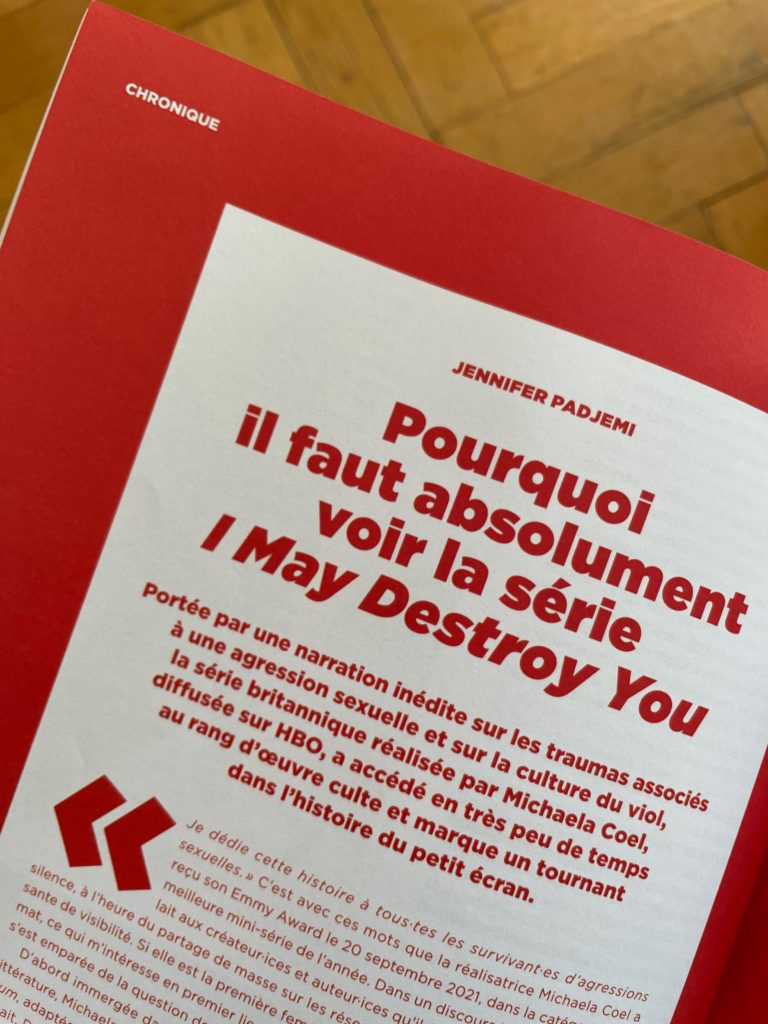Cette histoire se déroule il y a deux ans à Lille, près du palais des Beaux-Arts. C’est presque l’heure du dernier métro. Mon amie Camille et moi venons de quitter le groupe d’ami·es avec qui nous avons passé une soirée dans un bar, et nous nous apprêtons à rentrer chez nous, après avoir discuté de nos études et de ce que nous en attendons.
À cette époque, je suis encore étudiant en lettres. Je ne suis alors pas certain des mots pour me définir, ni conscient que « homme cisgenre » peut suffire à me décrire. Dès mon enfance, je n’ai pas su, pas pu, adhérer à certains codes de virilité.
Mon androgynie est alors trop mal maîtrisée pour me rendre compte que je peux être un homme tout en me sentant étranger à ces codes. Et à vrai dire, cela ne me préoccupe pas beaucoup. Au début de mon adolescence, période où je me suis laissé pousser les cheveux par esprit de rébellion, cette androgynie était accidentelle. J’ai appris peu à peu à en jouer avec des vêtements aux coupes bien choisies, un ton de voix qui prête à confusion. Je suis un habitué des « bonjour madame, ah pardon, monsieur » et, sincèrement, ça ne me chagrine pas. La curiosité et la méchanceté d’autrui sont les fibres qui m’ont permis de tisser mon identité, quand bien même j’aurais voulu par moments me débarrasser de ces petits fils gênants qui ont pu me faire douter de la solidité du tissu.
Camille et moi discutons.
Tout à coup une voix, tout à coup plusieurs voix, un chœur mal accordé, nous les entendons derrière nous et nous arrêtons de parler, nous ne savons pas d’où elles viennent, et nous ne déchiffrons pas le message qui, nous le savons d’instinct, nous est adressé.
Des macho men qui se sont mis en tête d’emmerder des nanas
« Eh les meufs, vous êtes trop bonnes ! » Camille et moi attendons maintenant de mettre des visages sur ces voix, nous attendons aussi qu’ils nous voient, et on devine rapidement que c’est une bande de jeunes copains, ils sont cinq, six peut-être, des macho men qui se sont mis en tête d’emmerder des nanas, nous les sentons approcher – et certainement leurs yeux s’élargissent : deux silhouettes fines sur une place publique, venez, on va les faire chier !
Puis ils contournent les deux femmes, voient leurs visages qu’encadre une chevelure dénouée, et l’un de ces deux visages attire l’attention plus que l’autre : cette femme a une fine barbe, son implantation de cheveux est haute et ses sourcils sont bas. Par ailleurs, aucun maquillage n’orne cette figure à l’aspect plat. Je ne sais pas à quoi ils s’attendaient, mais pas à cela.
« Oh putain, c’est un mec ! »
Je ne vais pas vous mentir : même en sachant que Camille est blasée d’être abordée de manière aussi inélégante, c’est d’abord pour elle que je m’inquiète. Moi, ça va. Je savais que dès que les garçons se rendraient compte de leur erreur, ils seraient gênés de m’avoir importuné dans mon quotidien d’homme.
Les codes masculins : une protection face aux normes hétéros de la rue
Je comprends que le harcèlement de rue n’est habituel que pour celles que l’on perçoit comme femmes. Je n’en suis donc pas victime. Si je me sens en danger dans l’espace public, je peux adopter une démarche dite « virile », attacher mes cheveux, ouvrir mon manteau pour me donner une carrure plus large, bouger les épaules plus que les hanches. Alors, oui, je m’inquiète des discriminations homophobes (je pourrais dire « follophobes »), j’ai peur de croiser un groupe d’hommes sorti pour casser du pédé, mais heureusement, dans la rue, je n’ai eu que des expériences désagréables, jamais traumatisantes. Je ne suis pas le plus à plaindre !
Après quelques moqueries échangées sans malveillance avec les garçons, Camille et moi nous éloignons de leur groupe. Je lui demande comment elle se sent.
« Oui, boh, tu sais, ça m’arrive souvent… »
La scène a duré cinq minutes tout au plus. Camille en est ressortie agacée plus qu’angoissée. Nous avons rapidement parlé d’autre chose. De mon côté, j’ai gardé cette histoire en mémoire, un peu comme une fable : elle m’a permis de comprendre comment les quelques codes masculins que je possédais me protégeaient face aux normes hétéros de la rue, qui ne m’affecteraient pas tout à fait de la même manière si j’étais une femme.
Ma façon d’habiter le monde, d’aborder la rue, était liée à la perception que les autres avaient de moi, à ce qu’ils me laissaient faire, à ce qu’ils décidaient de me faire subir ou pas. Si mon corps, mon visage, si cette accumulation d’images brouillées par l’obscurité nocturne ne définit pas qui je suis, ces images reflètent parfois une vilaine couleur sexiste, de la même teinte que les trottoirs de la ville. •