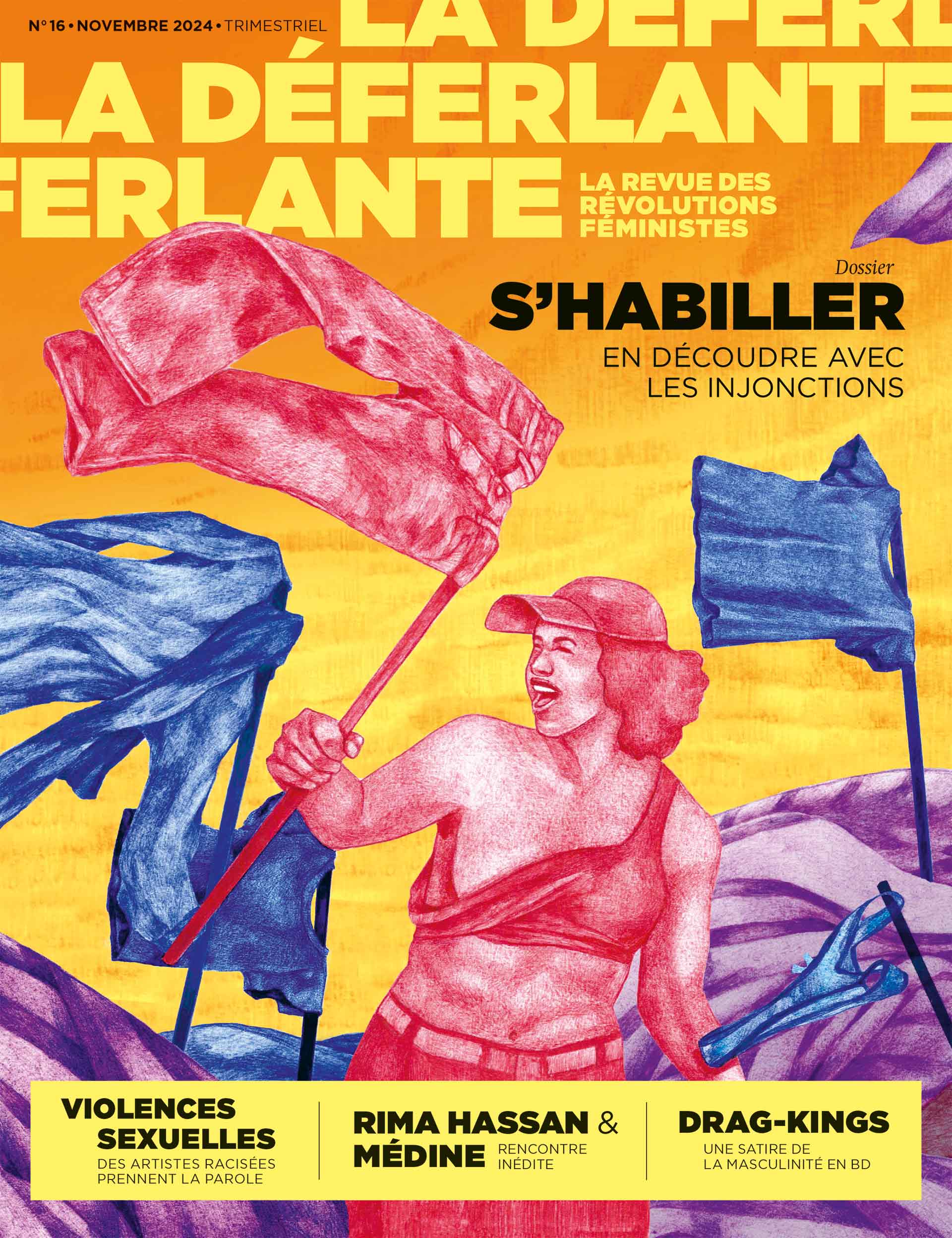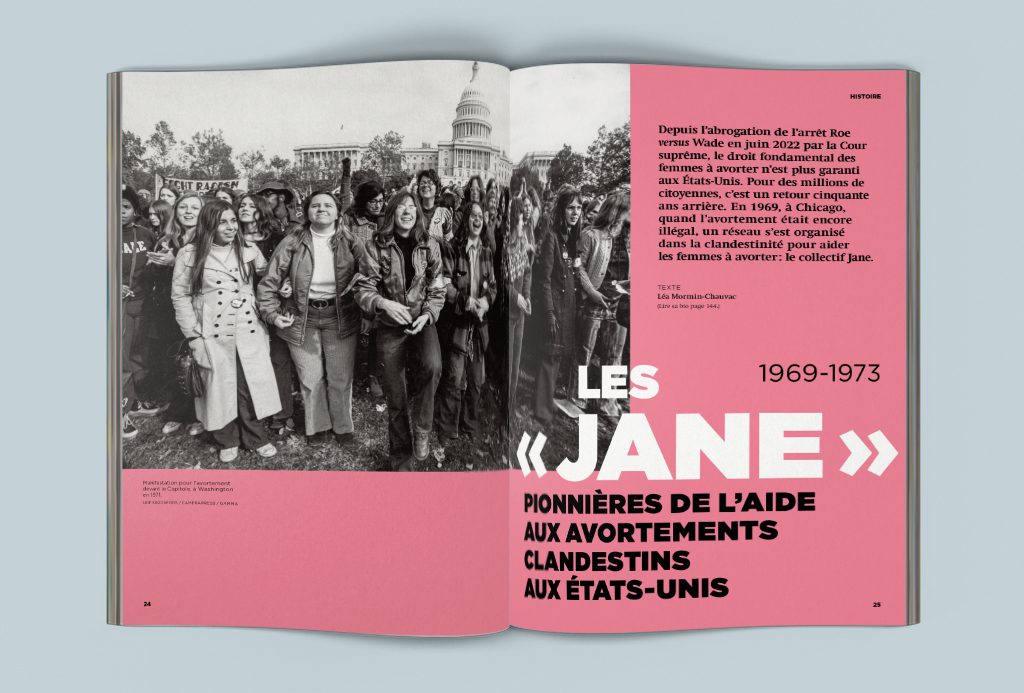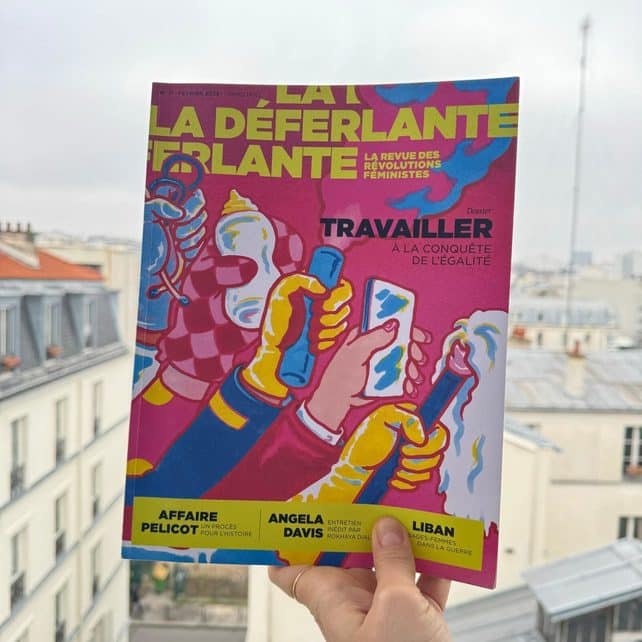Choqué·es. « Le grand public et les avocat·es ont été choqué·es par ces propos, car ils sortent de la norme », admet Frédérique Morel, vice-bâtonnière à Nancy et membre de la commission règles et usages du Conseil national des barreaux.
L’avocate vise directement les propos de Nadia El Bouroumi, l’une de ses consœurs qui défend deux accusés dans le procès des violeurs de Mazan et qui, le 19 septembre 2024, a posté une vidéo où elle danse sur le refrain du morceau du groupe Wham! Wake Me Up Before You Go-Go (Réveille-moi avant de partir). L’avocate s’est défendue en plaidant l’humour et en arguant « qu’il faudrait se lever tôt pour [la] museler », mais dans un procès où la victime de viols était sous soumission chimique, la provocation est à son paroxysme.
Alors que Dominique Pelicot et 50 autres hommes sont accusés de viols aggravés sur Gisèle Pelicot et comparaissent, depuis le 2 septembre 2024, devant la cour criminelle du Vaucluse, les provocations sont-elles déontologiquement acceptables ?
Nadia El Bouroumi n’est pas la seule à détonner dans ce procès hypermédiatisé. Isabelle Crépin-Dehaene, autre avocate de la défense, a suscité l’indignation au sujet de la cagnotte lancée par l’influenceuse Nabilla Vergara en soutien à Gisèle Pelicot en parlant sur son profil LinkedIn d’« un soutien qui tue ». Quand Gisèle Pelicot a demandé la clôture de la cagnotte, l’avocate s’est fendue d’un nouveau post à l’égard de la star : « Dommage, elle aurait pu vendre ses seins en plastique. »
« Sanctionner les dérives »
Face à ces stratégies de dénigrement, Frédérique Morel précise : « Je n’ai aucun avis sur leur manière de défendre leurs clients, elles sont totalement libres, mais effectivement la communication sur les réseaux doit être empreinte de modération et de délicatesse. »
Pour Claude Vincent, avocate au barreau de Nantes et coprésidente de la récente commission féministe du Syndicat des avocats de France (créée en 2023, elle compte 345 membres), la vidéo postée par Me El Bouroumi « est indigne. Elle ne s’inscrit pas dans l’exercice des droits de la défense et mériterait une sanction. De façon générale, les ordres devraient davantage intervenir et sanctionner les dérives sur les réseaux sociaux ».
Pour les professionnel·les du droit, il est essentiel de distinguer les propos tenus hors et dans la salle d’audience. « [À la barre du tribunal] nous avons une immunité totale de parole, dans le respect de l’article 41 de la loi de 1881 sur la liberté d’expression [qui interdit toutefois la diffamation, l’injure et l’outrage] », rappelle Frédérique Morel, qui ajoute que l’exercice de la profession doit se faire avec « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité », selon l’article 3 du code de déontologie des avocat·es.
« Ce n’est pas rendre service à l’accusé que d’attaquer la victime. »
Anne Bouillon, avocate
La médiatique avocate féministe Anne Bouillon, autrice d’Affaires de femmes. Une vie à plaider pour elles (L’Iconoclaste, 2024) insiste auprès de La Déferlante : « Chacun·e est libre des moyens de sa défense, c’est la pierre angulaire du procès équitable. » Cependant, « terroriser la victime, c’est très contre-productif, poursuit-elle. L’efficacité d’un système de défense se mesure à l’aune du résultat obtenu, et ce n’est pas rendre service à l’accusé que d’attaquer la victime ».
« La défense est libre, mais on se limite plus ou moins au regard de notre propre morale et éthique », précise encore Me Claude Vincent, avocate d’une partie civile dans le procès de Gérard Depardieu. « Dans ce procès, je fais face à un confrère, Me Jérémie Assous, qui accable médiatiquement les parties civiles avec une ligne misogyne, à savoir : ces femmes portent de fausses accusations car elles sont vénales. La liberté d’expression nous autorise aussi à critiquer ces pratiques, et notre profession doit s’interroger collectivement. »
Le Canada offre un autre modèle de législation. Afin de contrer les défenses qui portent atteinte à la dignité des femmes, la loi interdit depuis 1992 aux avocat·es comme au ministère public de faire référence au passé sexuel des victimes d’agressions sexuelles. « Si la victime a consenti à des relations sexuelles avec son partenaire intime par le passé, il n’est pas pertinent de dire qu’elle est davantage susceptible de consentir aujourd’hui », explique Suzanne Zaccour, chercheuse et directrice des affaires juridiques de l’Association nationale femmes et droit qui lutte pour les droits des femmes au Canada. « Ce raisonnement, établi sur des stéréotypes, est d’autant plus problématique qu’on a plus de risques d’être agressé·e sexuellement par quelqu’un avec qui on a déjà eu des relations sexuelles que par un inconnu. »
Deux fois victimes
D’une manière générale, les avocat·es français·es regardent la législation canadienne avec frilosité et invoquent des cultures judiciaires différentes. « Nous n’avons pas besoin de légiférer là-dessus car, à mon sens, un juge ne va pas regarder une victime en fonction de son passé », affirme la vice-bâtonnière Frédérique Morel. « Je crois qu’une bonne justice ne se rend que lorsque tout a pu être dit, débattu et discuté, et que finalement le verdict rendu peut susciter l’adhésion et de la victime et du condamné », complète Anne Bouillon.
Me Claude Vincent s’interroge également sur la pertinence du texte canadien : « Notre serment prévoit déjà la dignité et la délicatesse, donc à mes yeux, une ligne de défense misogyne sort déjà du cadre. » Elle insiste : « Les président·es font la police de l’audience et doivent intervenir quand les lignes sont franchies et qu’une victime se fait agresser à la barre. » L’avocate rappelle par ailleurs qu’il existe une « limite légale, et totalement méconnue » : la victimisation secondaire. Cette notion, apparue dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme il y a une dizaine d’années, introduit l’idée que « la victime n’est pas censée être une deuxième fois victime, cette fois de la procédure judiciaire ».
Dans leurs plaidoiries, les avocats de Gisèle Pelicot, Antoine Camus et Stéphane Babonneau, ont eux aussi dénoncé « une forme de maltraitance de prétoire ». Par exemple, lorsque Guillaume de Palma, l’avocat de six des accusés, a osé affirmer : « Il y a viol et viol. », Me Antoine Camus a fait valoir que : « Certaines stratégies de défense n’ont plus leur place dans une enceinte judiciaire en France, au XXIe siècle. Si la défense est libre, elle dit aussi ce que nous sommes. »

Journaliste indépendante, elle s’intéresse aux sujets sur la fin de vie et travaille également sur les violences sexuelles.
Voir tous ses articles.