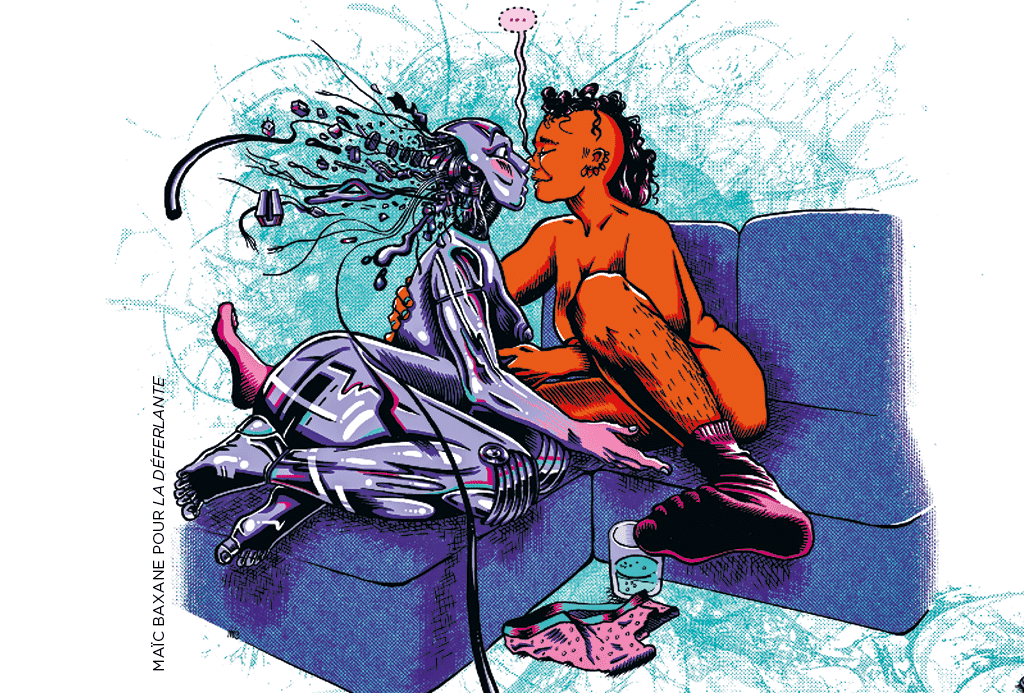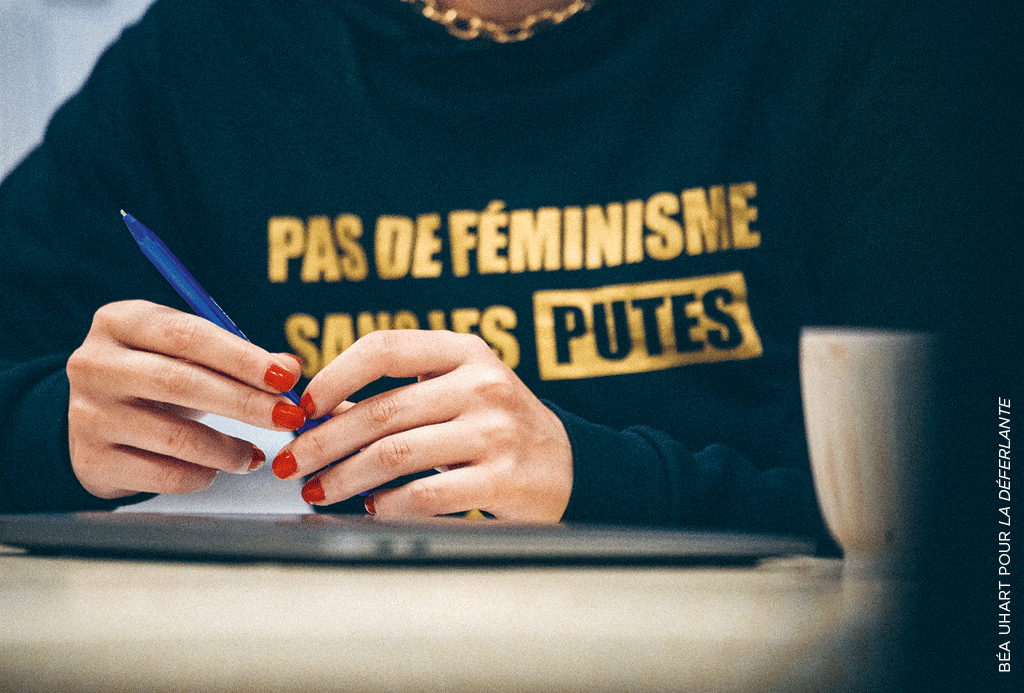Depuis le 2 septembre 2024, Dominique Pelicot et 50 autres hommes, accusés de viols aggravés sur Gisèle Pelicot, comparaissent devant la cour criminelle du Vaucluse. La soumission chimique exercée sur Gisèle Pelicot et la levée du huis clos – qu’elle a elle-même demandée – donnent à ce procès un écho médiatique, social et politique d’une ampleur inédite.
Les débats qui ont animé les audiences rappellent à quel point les violences sexistes et sexuelles, notamment au sein du couple, sont encore largement méconnues et invisibilisées, et ont mis en lumière la question de l’impunité des agresseurs. Maîtresse de conférences en sociologie à l’université de Strasbourg, Alice Debauche travaille sur les violences sexuelles depuis plus de vingt ans – elle a soutenu une thèse sur le viol en 2011 et a contribué à l’enquête Violences et rapports de genre (Virage) de l’Institut national d’études démographiques réalisée en 2015.
Avant de parler de la loi, peut-on donner une définition sociologique du viol ?
La question du viol et des violences sexuelles s’inscrit dans des rapports de domination des hommes sur les femmes. À la fin des années 1970, la sociologue britannique Jalna Hanmer montre que les violences contre les femmes constituent des instruments de contrôle social.
D’abord en tant qu’acte effectif, avec les représentations stéréotypées, comme les viols commis sur des lesbiennes « pour les remettre dans le droit chemin » ou les viols commis sur des femmes alcoolisées ou la nuit. Mais également au-delà des actes, en tant que menace permanente qui pèse sur les femmes. La très grande majorité des jeunes femmes, voire la totalité, entendent un jour leur mère, leur père, leur entourage leur expliquer qu’il ne faut pas qu’elles fassent ci ou ça parce que c’est dangereux. Du point de vue de l’organisation de la société, l’existence du viol et des violences sexuelles sert à contrôler ce que peuvent faire ou non les femmes.
Quelles sont les lois marquantes sur le viol ?
La loi de 1980 est intéressante comme début de période d’observation. Elle entérine un changement de perspective juridique et sociale sur la question des violences sexuelles. Jusque-là, le Code pénal ne donnait pas de définition du viol, et on s’appuyait sur une jurisprudence très vague du début du XXe siècle, qui disait que le viol est un « coït illicite avec une femme qu’on sait ne point consentir ».
À l’époque, on se préoccupait davantage de la morale et du risque de grossesse illégitime que de l’atteinte à la victime. En 1980, la nouvelle loi va donner les conditions de l’absence de consentement : le viol devient un acte de pénétration sexuelle sur la personne d’autrui, commis par violence, contrainte ou surprise – plus tard [en 1994] sera ajoutée la menace. Cette loi intègre aussi la possibilité que les hommes soient victimes, et envisage le viol au sein du couple. En 1992, le Code pénal est remodelé et les lois sur le viol et les violences sexuelles sont transférées du chapitre des atteintes aux mœurs à celui des atteintes aux personnes : cela permet la reconnaissance des victimes. Autres mesures phares : en 1989, les délais de prescription sont allongés à dix ans après la majorité quand la victime est mineure au moment des faits, notamment en raison de l’incapacité des enfants à porter plainte. En 2002, le délai de prescription passe à vingt ans après la majorité, et, en 2018, à trente ans. Enfin, la loi de 2021 introduit la notion d’âge au consentement et ajoute à la liste des actes considérés comme un viol l’acte bucco-génital sur autrui.
Pensez-vous que le procès de Mazan soit un tournant dans la prise de conscience des violences sexistes et sexuelles ?
Cela fait plus de vingt ans que je travaille sur la question, et, de manière récurrente, il est question de « libération de la parole », de « prise de conscience » ou de « transformation du regard ». En 2017, aux débuts de #MeToo, dans les nombreux débats publics et médiatiques, il était dit que rien ne serait plus jamais comme avant. D’un point de vue sociologique, on regarde les effets produits sur le long terme : cela fait toujours couler énormément d’encre, et les choses avancent vraisemblablement, mais pas forcément de manière très sensible sur la prise en charge par les pouvoirs publics et la législation.
Cela dit, le procès de Mazan est intéressant, car il met la lumière sur ce qui peut se passer au sein du couple. Au début des années 2000, la publication de l’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff) a entraîné un début de prise de conscience autour des violences au sein du couple, mais l’accent était davantage mis sur les violences psychologiques (harcèlement, contrôle, dénigrement) que sur les violences sexuelles. #MeToo puis #MeTooInceste, en 2021, ont assez peu parlé du couple.
« L’existence du viol sert à contrôler ce que peuvent faire ou non les femmes. »
Avec le procès de Mazan, on se rend compte que des époux agressent, et qu’une femme relativement âgée, mariée, qu’on ne se représente pas comme la victime type, peut subir des viols. C’était d’ailleurs l’un des éléments déjà mis en évidence dans l’enquête Virage de 2015 : les violences sexuelles auxquelles les femmes de plus de 25 ans sont le plus exposées se déroulent au sein de leur couple.
Quand on analyse les crimes jugés à ce procès, on se rend compte qu’on est face à des actes extraordinaires, sulfureux, qui soustraient ces situations à l’ordinaire de la vie conjugale. Mais cela oblige aussi à se représenter le fait que les violeurs ne sont pas nécessairement identifiables comme tels, qu’ils peuvent faire partie de notre quotidien, qu’on peut les connaître. La diversité des âges et des statuts sociaux permet de se rendre compte que ce sont des personnes parfaitement banales par ailleurs.
À l’instar du procès d’Aix en 1978, qui aboutit à l’adoption de la loi de 1980, pensez-vous que le procès de Mazan peut faire changer la loi ?
De nombreuses associations féministes revendiquent l’inscription de la notion de consentement dans la loi. C’est intéressant puisque l’apport de la loi de 1980 était justement de retirer la notion de consentement du Code pénal en définissant plutôt les conditions de l’absence de consentement. Au-delà de la demande de définition juridique du viol, inscrire le consentement dans la loi est une manière de sortir de cette représentation de la sexualité où les hommes expriment leur désir et où les femmes le subissent plus ou moins. Dans les années 1970, un slogan disait « Non c’est non ». Ici, on pourrait reformuler cette revendication ainsi : « Nous voulons pouvoir dire oui pour manifester notre désir, sur le moment présent, de nous engager dans une relation sexuelle. » Selon moi, il s’agit d’une revendication davantage sociale que juridique : ce n’est pas tant un point technique sur lequel les juristes et les législateurs vont réfléchir et travailler qu’une question de regard sur la société, sur l’état des rapports en matière de sexualité entre femmes et hommes.

Par Sarah Boucault
Journaliste indépendante, elle s’intéresse aux sujets sur la fin de vie et travaille également sur les violences sexuelles.
Voir tous ses articles.