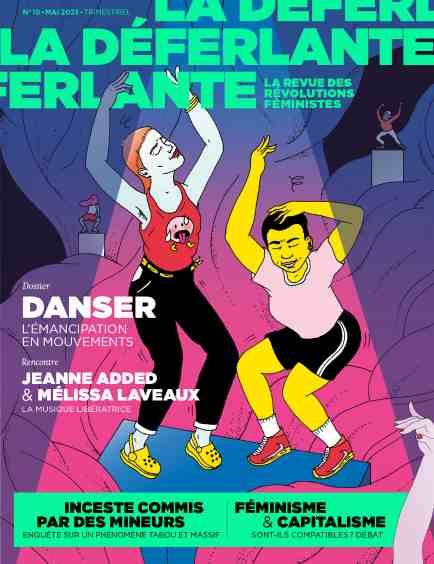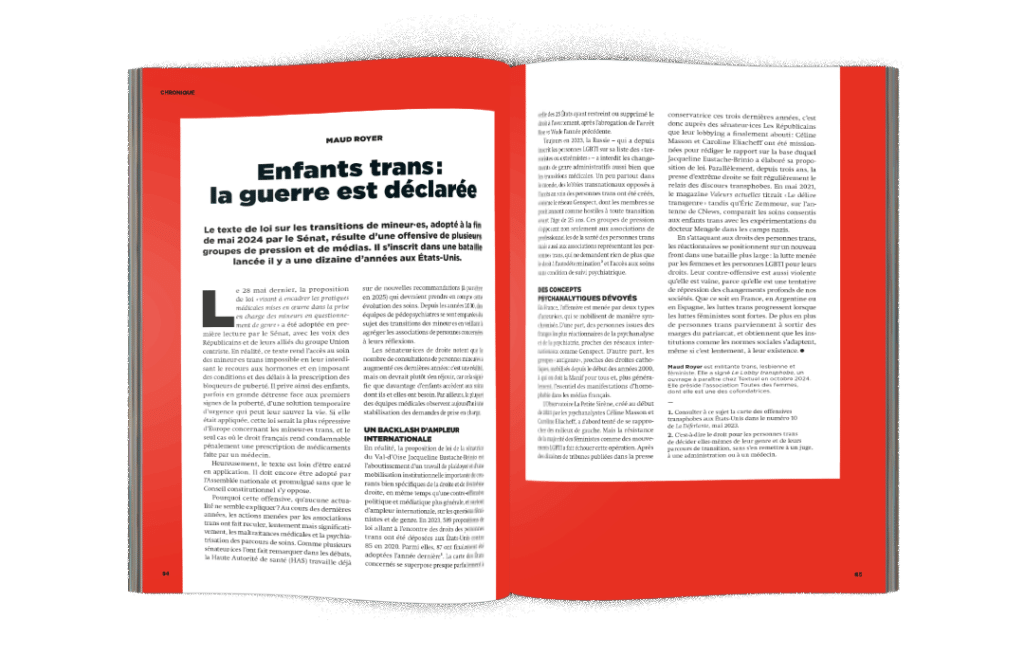« De combien de nos morts avez-vous besoin pour vous soucier de ce qui nous arrive ? » scandent les manifestant·es brandissant des bougies. Elles et ils sont une centaine rassemblé·es ce soir de la mi-février 2023 devant le département de l’Éducation, à Londres, pour une veillée funèbre à la mémoire de Brianna Ghey, une jeune fille trans de 16 ans poignardée quelques jours plus tôt à Werrington, au nord-ouest de l’Angleterre.
« Maintenant, tous les deux ou trois mois j’entends parler de quelqu’un qui s’est suicidé. Pour une si petite communauté, ça fait beaucoup ! »
Jane Fae, militante trans
Produire des contenus haineux, ça assure le Buzz
Elle s’inscrit dans un climat de haine grandissant à l’égard des personnes trans depuis une décennie, avec pour principale conséquence une grave dégradation de leurs conditions de vie. En témoigne la dégringolade du pays dans le classement de l’International Lesbian and Gay Association (Ilga) qui défend les droits des personnes LGBT+ au niveau européen. En 2015, le Royaume-Uni arrivait en tête des États européens ; six ans plus tard, il n’occupe plus que la quatorzième place du classement. Parmi les raisons avancées par l’Ilga : l’incapacité du gouvernement britannique à réformer le Gender Recognition Act de 2004. Depuis plusieurs années, cette loi encadrant le changement de genre est décriée par les associations LGBT+ à cause du processus invasif et déshumanisant qu’elle fait subir aux personnes concernées lors des entretiens médicaux et psychologiques obligatoires pour l’établissement d’un diagnostic de dysphorie de genre. Par ailleurs, les personnes trans sont également touchées de plein fouet par la crise qui affecte le service de santé publique britannique, le National Health Service (NHS) et qui s’est encore accentuée avec la pandémie de Covid-19. Le temps d’attente pour une première consultation relative à une dysphorie de genre se compte en années, de même que le processus médical de transition en lui-même.
« Les personnes trans traversent une période horrible, en particulier celles qui reçoivent peu de soutien et n’ont pas accès à des espaces communautaires », témoigne Cleo Madeleine, militante trans qui vit à Norwich, ville moyenne de l’est du pays. Elle est porte-parole de Gendered Intelligence, une association britannique de soutien pour et par les personnes trans basées à Londres. « Cela entraîne chez certain·es une peur de sortir de chez soi, des difficultés à aller chez le médecin ou à demander de l’aide en cas de besoin. Les effets sur leur santé mentale sont profonds. » L’une des raisons majeures de cette détérioration est l’explosion de l’hostilité et de la violence transphobe sur les plateaux télé, les réseaux sociaux et dans les pages des tabloïds depuis quelques années. Une hostilité qui se traduit en actes : en 2022, les agressions transphobes ont explosé, augmentant de 56 % par rapport à l’année précédente, selon le Home Office, le ministère de l’Intérieur britannique. C’est la plus forte hausse depuis 2011, année où ces données ont commencé à être recueillies. « Maintenant, tous les deux ou trois mois j’entends parler de quelqu’un qui s’est suicidé. Pour une si petite communauté, ça fait beaucoup ! », s’inquiète la militante trans vétérane Jane Fae par téléphone depuis sa petite ville de Letchworth, au nord de Londres. Affaiblie depuis l’épidémie de Covid-19, Jane est tenue de s’isoler chez elle. C’est de son domicile qu’elle dirige TransActual, une association de défense des droits des personnes trans.
« Comment en est-on arrivé là ? », s’interrogent aujourd’hui nombre de militant·es. Pour Jane Fae, la campagne particulièrement toxique sur le référendum du Brexit en 2016 a créé un précédent. « Tout au long de cette campagne, les citoyen·nes ont été matraqué·es de mensonges au sujet des immigré·es. » Mentir, produire des contenus haineux, c’est s’assurer de faire le buzz. Or, au même moment, la Première ministre conservatrice Theresa May décidait de réformer la loi sur la reconnaissance du changement de genre, « cherchant un moyen facile de prouver qu’elle n’était pas si à droite que ça, après son alliance avec les ultraconservateurs unionistes en Irlande du Nord ». D’après Jane Fae, cette réforme aurait dû passer aisément mais, du fait d’une forte instabilité gouvernementale, les ministres chargé·es de l’Égalité ont démissionné les un·es après les autres. « La réforme a alors attiré l’attention des médias conservateurs, qui se sont mis à publier une série d’articles alarmistes et complotistes prétendant, par exemple, que des hommes mal intentionnés allaient se faire passer pour des femmes trans et faire irruption dans des espaces réservés aux femmes pour les violer », se souvient-elle.
Katy Montgomerie, ingénieure trans de 33 ans et célèbre militante pour les droits des personnes LGBT+ via sa chaîne YouTube, estime pour sa part que le gouvernement de droite s’est progressivement rapproché de l’extrême droite, sous l’influence des guerres idéologiques agitées par les mouvements réactionnaires proches de Donald Trump. « Avec l’immigration, un de leurs thèmes de prédilection est la transidentité. Sachant qu’en ce qui concerne la Grande-Bretagne, s’opposer aux droits des personnes gay n’est plus du tout “porteur” politiquement… »
Un mouvement Terf de plus en plus influent
C’est dans ce contexte qu’un petit groupe de féministes – parmi lesquelles la journaliste Julie Bindel¹ ou l’universitaire Germaine Greer² – s’est mis à relayer ces discours transphobes. Les « terf s » (Trans-Exclusionary Radical Feminists), à l’origine issues de la gauche et des mouvements féministes mais qui s’engagent alors dans un militantisme violemment anti-trans, font rapidement des émules. L’exemple le plus connu est celui de la romancière à succès autrice de Harry Potter J.K. Rowling. Elle prend régulièrement la parole sur les réseaux sociaux ou sur son blog pour s’attaquer aux femmes trans sous prétexte qu’elles mettraient en danger les femmes cisgenres (personne dont l’identité de genre est en concordance avec le sexe assigné à la naissance). En 2022, elle a annoncé sa participation au financement d’un lieu d’accueil exclusivement réservé aux femmes cisgenres à Édimbourg. Et ces derniers mois, elle s’est très ouvertement engagée contre la loi écossaise en interpelant régulièrement la Première ministre Nicola Sturgeon.
Des articles anti-trans dans les journaux progressistes
En quelques années, les réseaux terfs britanniques se sont structurés et ont pris de l’ampleur. Déjà en 2017, l’organisation Women’s Place UK avait été créée pour s’opposer au projet de réforme du Gender Recognition Act et réclamer l’exclusion des femmes trans des lieux d’accueil des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Puis, en 2019, c’est la LGB Alliance qui est fondée, en opposition à Stonewall, l’organisation LGBT+ la plus connue de Grande-Bretagne, qui a affiché son soutien aux personnes trans. C’est à cette période qu’une partie des associations spécialisées dans les violences sexistes et sexuelles commence à ne plus accepter les personnes trans.
Avec cette montée en puissance, les arguments des militant·es terfs ont peu à peu imprégné l’opinion. Ainsi, Mumsnet, un forum en ligne à travers lequel des parents échangent des conseils, est devenu depuis 2015 un lieu privilégié d’expression de propos transphobes. « J’ai l’impression que l’intégralité de notre paysage médiatique est devenue anti-trans », résume Katy Montgomerie. En une décennie, le nombre d’articles négatifs publiés a explosé, analyse pour sa part la vétérane Jane Fae, engagée dans Trans Media Watch, une association qui étudie la représentation des personnes trans et intersexes dans la presse : « Entre 2010 et 2015, il y avait une centaine d’articles par an sur les personnes trans. Aujourd’hui on est à environ 6 000, c’est-à-dire plus que le nombre de personnes pourvues d’un certificat de changement de genre… » Même les journaux réputés progressistes à l’image du Guardian³ ou du New Statesman publient des articles anti-trans.
Harcèlement de masse sut la questions des mineur·es
Conséquence de ce déferlement médiatique, les militant·es et les associations de soutien aux personnes trans subissent un harcèlement quotidien et font parfois l’objet d’actions en justice.
Stonewall est aujourd’hui l’une des principales cibles du mouvement terf. Parmi les associations de défense des victimes de violences sexistes et sexuelles, rares sont celles qui déclarent encore publiquement accueillir les personnes trans.
Depuis l’automne 2022, l’association Mermaids, qui soutient les enfants trans et leurs familles, est visée par une enquête de la Charity Commission, l’organisme chargé du suivi et du contrôle des organisations caritatives. Elle est accusée de nuire aux mineur·es et aux personnes vulnérables qu’elle soutient. Cette enquête fait suite à la publication en septembre 2022 d’un article du quotidien conservateur The Telegraph affirmant que Mermaids fournissait des binders (bandeaux de poitrine) à des jeunes trans sans le consentement de leurs parents. L’offensive se cristallise autour de cette question des mineur·es, laissant à penser, par exemple, qu’il serait facile pour les enfants d’accéder à des bloqueurs de puberté⁴ et qu’il faudrait par conséquent les en protéger. La réalité, vu les délais d’attente du NHS, est tout autre. D’après l’ONG britannique The Good Law Project, les mineur·es doivent attendre en moyenne plus de 18 mois pour un premier rendez-vous, ce qui signifie que beaucoup de jeunes trans traversent leur adolescence sans avoir pu se faire prescrire des inhibiteurs de puberté.
La justice veut s’en prendre aux bloqueurs de puberté
« Le nombre d’enfants qui souhaitent vivre dans un genre différent de celui qui leur a été assigné à la naissance est minime ! Faire croire le contraire relève de la panique morale, bâtie sur des faits inventés », estime Talia – son prénom a été changé à sa demande –, enseignante et référente LGBT+ dans une école londonienne, qui fait ici allusion à la récupération politique, par les militant·es anti-trans, d’une affaire qui s’est déroulée entre 2019 et 2020. Elle a opposé, d’une part, le Tavistock and Portman NHS Foundation, organisme public qui gère le seul service de changement d’identité de genre pour les mineur·es au Royaume-Uni, et d’autre part, Keira Bell, une femme de 23 ans qui a pris des bloqueurs de puberté à l’âge de 16 ans, puis entamé une transition hormonale, avant de détransitionner cinq ans plus tard. En première instance, les juges ont mis en doute la capacité des moins de 16 ans à décider seul·es⁵ de prendre les bloqueurs en question, même si leur médecin estime qu’iels en sont capables. En décembre 2020, le NHS décide de suspendre l’accès à ce type de traitement pour toute personne de moins de 16 ans n’ayant pas encore commencé à le prendre. « J’étais en contact avec des parents d’enfants trans à l’époque, se souvient Katy Montgomerie. Iels avaient changé de genre en maternelle ou à l’école primaire. Au collège ou au lycée, iels étaient des enfants ordinaires, dont les ami·es ne savaient pas qu’iels étaient trans. Tout d’un coup, iels couraient le risque d’être outé·es et de voir leur corps changer de façon irréversible. Comment leur expliquer cela ? J’ai du mal à me remettre du fait que ces gens nous détestent autant. » En 2021, le jugement en appel renverse cette décision, concluant qu’il revient « aux clinicien·nes plutôt qu’à la cour de décider de la compétence [de mineur·es de moins de 16 ans] à se voir prescrire des inhibiteurs de puberté ». Mais les difficultés d’accès aux soins demeurent. Même si les mineur·es sont censé·es avoir accès aux bloqueurs de puberté, il leur faut attendre tellement longtemps qu’ils basculent souvent dans la liste d’attente d’accès aux soins des adultes.
« Le nombre d’enfants qui souhaitent vivre dans un genre différent de celui qui leur a été assigné à la naissance est minime ! Faire croire le contraire relève de la panique morale, bâtie sur des faits inventés. »
Talia, enseignante et référente LGBT+
Dans ce contexte difficile, des militant·es des droits des personnes trans tentent de résister au mieux, et cherchent les moyens de contrer les arguments des réactionnaires sans risquer de s’exposer à la haine. « Ça n’arrivera jamais, mais j’adorerais réussir à faire dire à J.K. Rowling sur un plateau télé qu’elle déteste les personnes trans et qu’elle aimerait que leur nombre diminue. Ce serait horrible, mais on y verrait plus clair », explique Katy Montgomerie. Elle fait ici référence à une pratique qui s’est développée à la télévision britannique depuis quelques années et qui consiste à imposer aux personnes trans invitées un « débat » face à des interlocuteur·ices hostiles. De fait, elles se retrouvent sommées de justifier leur transidentité⁶. « On se retrouve avec des gens qui hurlent à des femmes trans qu’elles ont un pénis. Une bonne partie des activistes trans ont décidé, et c’est parfaitement compréhensible, de ne plus débattre à la télé, mais je me demande parfois si on ne risque pas ainsi d’être réduit·es au silence », poursuit-elle. Dans un contexte où les médias leur ferment la porte ou ne leur proposent pas des conditions acceptables pour s’exprimer, nombre de personnes trans se sont, à l’instar de Katy Montgomerie, façonné des espaces où elles peuvent parler librement.
Shon Faye a abandonné sa carrière d’avocate pour militer et devenir journaliste et autrice. En 2021, elle a publié The Transgender Issue : An Argument for Justice (Verso Books), un manifeste pro-trans au succès inattendu dans lequel elle démonte patiemment les différents arguments transphobes. Quant à l’artiste Travis Alabanza, qui explore son identité de personne trans, noire et non binaire à travers des performances drag et des pièces de théâtre, iel a publié en 2022 None of the Above: Reflections on Life Beyond The Binary (Canongate Books), une autobiographie qui revient sur sept phrases blessantes qu’iel a entendues au cours de sa vie, afin de se les réapproprier. Des figures qui donnent de l’espoir, selon Katy Montgomerie qui a quasiment le même âge que la « Section 28 », cette série de lois passée sous le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher en 1988 interdisant notamment de faire la « promotion » de l’homosexualité en en parlant à l’école. Elle souligne que les jeunes aujourd’hui ont plus de modèles trans à disposition, que ce soit en couverture des magazines, parmi les super-héros Marvel, ou en tête des charts, avec la chanteuse allemande Kim Petras par exemple.
Manifs et actions en justice
Dans la rue, la résistance s’organise aussi et prend de l’ampleur. Les manifestations de lutte pour les droits des personnes trans, comme le Trans Day of Remembrance qui se tient le 22 novembre, rassemblent à chaque édition de plus en plus de monde. « La dernière Trans+ Pride, qui s’est tenue en juillet 2022 à Londres a rassemblé entre 20 000 et 30 000 personnes, c’est énorme », rappelle Natacha Kennedy, universitaire trans, autrice d’une thèse de sociologie sur les jeunes trans, enseignante au Goldsmiths College, une université LGBT-friendly du sud de Londres. « Je n’arrivais pas à le croire, la foule s’étendait à perte de vue sur l’avenue Piccadilly, au cœur de la capitale. Les manifestations me rendent optimiste parce qu’elles rassemblent toujours un tas de gens. »
En dehors des manifestations, les organisations trans et LGBT+ multiplient les stratégies pour soutenir et défendre concrètement les personnes trans vivant au Royaume-Uni. Mermaids gère par exemple un numéro d’urgence et un service de messagerie instantanée. Gendered Intelligence organise des activités sportives destinées aux jeunes trans et à leurs familles. L’association organise des cours de natation, activité dans laquelle les personnes trans sont souvent stigmatisées. Quant au centre social londonien The Outside Project, il a ouvert le premier refuge britannique pour les personnes LGBT+ n’ayant pas de domicile fixe en 2017⁷, et, au début de la pandémie de Covid-19, le premier refuge pour personnes LGBT+ victimes de violences domestiques. Le centre accueille des personnes trans susceptibles d’être mal accueillies ou carrément interdites d’accès dans des structures similaires. La lutte, enfin, se joue aussi sur le plan juridique. Avec l’aide de l’ONG The Good Law Project, Gendered Intelligence a ainsi déposé un recours contre le NHS d’Angleterre, arguant que les délais dans la prise en charge des personnes trans étaient discriminatoires. Cleo Madeleine, porte-parole de l’association, a assisté aux audiences. « Cette action en justice ne va pas tout résoudre, explique-t-elle, mais quelle que soit son issue, ce qui compte c’est de montrer aux membres de la communauté, qui ont le sentiment d’avoir été abandonnés par le gouvernement et le système de santé, qu’on est en train de se battre. »
- Julie Bindel est une autrice et journaliste féministe anglaise âgée de 60 ans, connue pour son engagement contre les violences faites aux femmes.
- D’origine australienne, Germaine Greer, 89 ans, est une figure de la vie publique britannique. Elle s’est fait connaître mondialement avec La Femme eunuque, un manifeste féministe publié en 1970.
- En octobre 2018, un éditorial du Guardian sur le Gender Recognition Act a été critiqué par des journalistes de la rédaction états-unien·ne du journal qui lui reprochaient de faire « la promotion de positions transphobes ».
- Les bloqueurs (aussi appelés inhibiteurs) de puberté stoppent provisoirement l’apparition de caractères sexuels secondaires (seins, règles, moustache…) ne correspondant pas au genre vécu par l’adolescent·e. Il ou elle peut ainsi cheminer dans son questionnement de genre, avant de décider, ou pas, de prendre un traitement hormonal de transition.
- En Grande-Bretagne, la capacité des jeunes de moins de 16 ans à prendre des décisions par elleux-mêmes, y compris en désaccord avec leurs parents, est évaluée à l’aune du concept de « mineur mûr » souvent utilisé en droit médical.
- Des formats similaires ont fait leur apparition en France. Le 15 octobre 2022, par exemple, dans son émission « Quelle époque ! » sur France 2, Léa Salamé a organisé un « débat » où Marie Cau, première maire trans de France, était confrontée à l’activiste anti-trans Dora Moutot.
- Au Royaume-Uni, 24 % des jeunes sans domicile fixe s’identifient comme LGBT+.