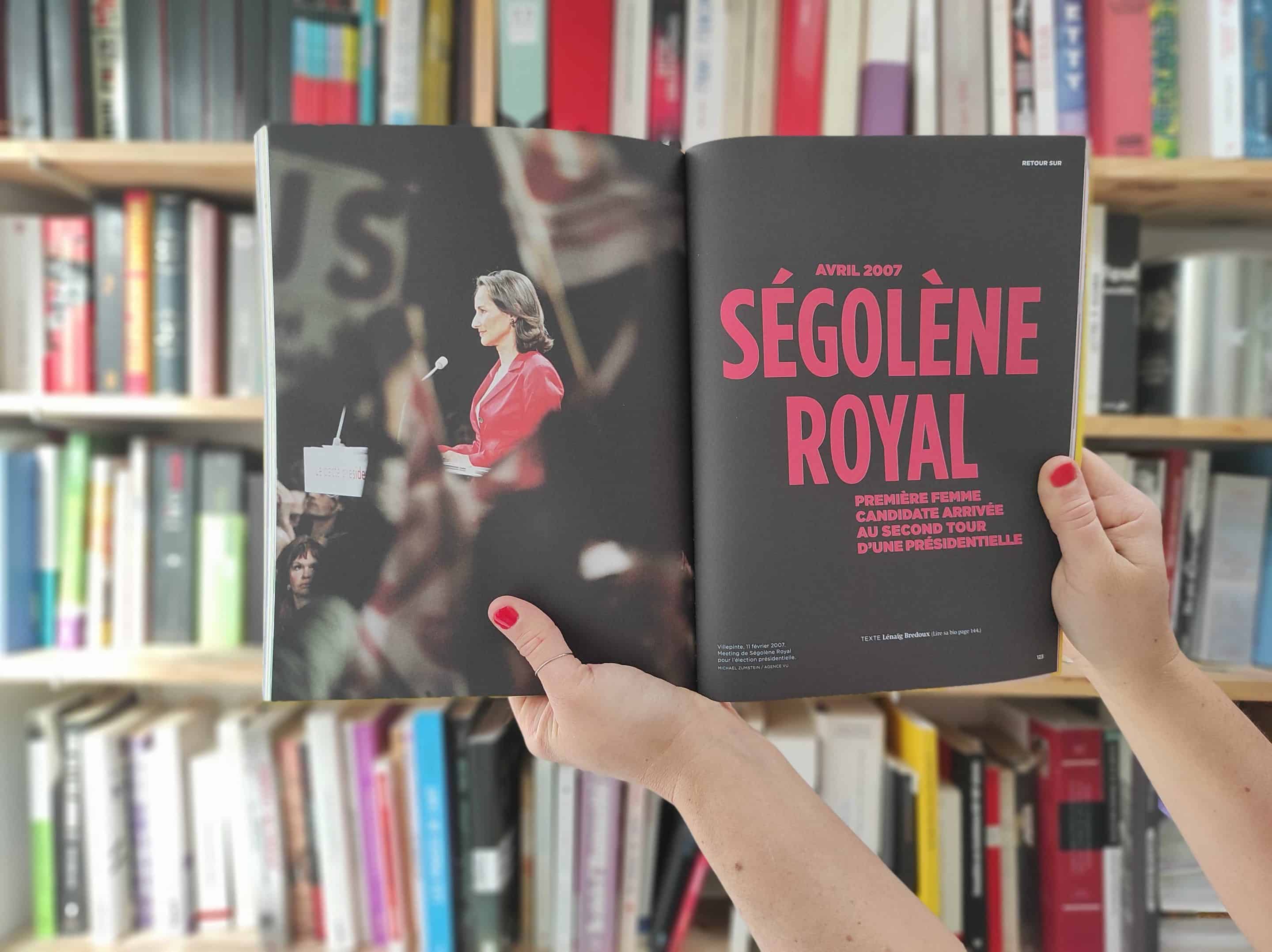L’ambiance est tendue. La salle, hostile. Ségolène Royal hésite à faire les quelques pas qui la séparent du pupitre. Son équipe est fébrile. Le discours a été préparé dans des conditions rocambolesques. Une de ses collaboratrices finit par la prendre par la main pour la guider.
En ce mois de novembre 2008, la candidate défaite à la présidentielle l’année précédente fait face à ses camarades de parti, les socialistes réunis en congrès à Reims.
Elle veut conquérir la formation dont elle est membre depuis plus de 20 ans en devenant sa première secrétaire. Elle a pour elle les 17 millions de voix du second tour de l’élection de 2007, remportée par Nicolas Sarkozy. Mais Ségolène Royal cultive des relations houleuses avec l’appareil du parti : « Il faut nous soigner de toutes ces petites et grandes blessures que nous nous sommes infligées », lance-t-elle à ses camarades. Elle est huée. Elle l’est encore quand elle évoque leurs « tendresses, [leurs] colères, [leurs] indignations ». Le mot « tendresse » irrite ; il semble incongru aux oreilles socialistes.
Pendant plus de 30 minutes d’un discours souvent poussif et maladroit, Royal prend ses camarades de front, avec une grammaire éloignée des classiques du mouvement ouvrier. Elle appelle à être « plus fraternelle, et pourquoi pas plus maternelle avec les plus démunis ». Sa conclusion déclenche une bronca : « Nous rallumerons tous les soleils, toutes les étoiles du ciel. » Pour une partie du PS, la coupe est pleine : le vocabulaire de celle qu’ils surnomment « la Madone », qu’ils jugent « mystique » quand ce n’est pas « folle », leur est insupportable. Au point qu’ils en oublient que cette formule finale est inspirée d’un texte – certes peu connu – de Jean Jaurès lui-même, fondateur du parti : « Même les socialistes éteignent un moment toutes les étoiles. »
« Avec Ségolène, tout devenait un sujet de moquerie », se souvient Aurélie Filippetti, ministre de la culture sous François Hollande et membre de l’équipe de 2007. « Elle a subi un sexisme monstrueux. Elle était “conne”, “incompétente”, elle avait des “intuitions”, “du flair”, mais pas de culture politique, ni d’intelligence rationnelle. Tout était sujet à critique. Qu’elle sourie trop ou pas assez, que sa jupe soit trop longue ou trop courte. Même qu’elle soit belle, ils ne le supportaient pas… »
Une pionnière
À Reims, Ségolène Royal échoue de peu et s’incline devant Martine Aubry. Jamais elle ne retrouvera l’aura de ces années-là. En 2011, quand elle tentera d’être à nouveau désignée candidate à la présidentielle, c’est François Hollande, son ex-compagnon, qui l’emportera – elle finira quatrième de la primaire citoyenne, sèchement battue. Son parcours la conduit ensuite à devenir ministre sous Hollande, puis une « ambassadrice des Pôles » contestée sous Emmanuel Macron. De plus en plus isolée, elle a échoué, en septembre dernier, à être élue sénatrice. Le regard posé sur elle s’en est obscurci. La mémoire de ce qu’elle a représenté s’est en partie évanouie.
Quinze ans plus tôt, elle a pourtant incarné un immense espoir, a fait se lever des dizaines de milliers de personnes dans des meetings enflammés, a amené à la politique des foules qui s’en tenaient bien loin : des femmes, des queers, des habitant·es des quartiers populaires, des sans-parti et sans-carte, des chercheurs et chercheuses, et des chanteurs et chanteuses. Elle incarnait un « désir d’avenir », selon le nom du mouvement qu’elle avait lancé en marge du PS – également titre de son livre (Flammarion, 2006).
Elle était la première femme à se présenter à l’élection présidentielle avec des chances de l’emporter. Elle avait auparavant gagné, dès le premier tour en novembre 2006, la primaire de son parti contre deux poids lourds, Dominique Strauss-Kahn (cinq ans avant qu’il n’abandonne la vie politique après avoir été accusé de viol) et Laurent Fabius1 (qui préside aujourd’hui le Conseil constitutionnel). Ce qu’elle a alors subi est à peine croyable.
« Qui va garder les enfants ? »
Dès l’annonce de son ambition, en 2005, ses camarades se déchaînent. « Mais qui va garder les enfants ? », aurait glissé Fabius, faisant référence aux quatre enfants du couple que Royal forme alors avec Hollande, premier secrétaire du PS. « La présidentielle n’est pas un concours de beauté », souffle Jean-Luc Mélenchon. « Voyez la mère Merkel [Angela Merkel, chancelière allemande – ndlr], poum dans le popotin ! », lance Michel Charasse, ancien ministre de François Mitterrand.
Pendant les mois qui suivent, celle qui était à cette époque la plus proche conseillère de Royal, Sophie Bouchet-Petersen compile ce qu’elle appelle un « florilège des cochoncetés ». Pour La Déferlante, elle a exhumé les notes qu’elle avait prises à l’époque. On y retrouve des politiques, beaucoup, notamment socialistes. Ainsi Jean-Christophe Cambadélis cité dans Le Canard enchaîné en janvier 2006 : « Ni les socialistes ni la France ne sont assez mûrs pour faire confiance à une femme dans une période aussi difficile. » Ou l’ancien ministre Jean Glavany, dans Le Nouvel Obs en février 2006 : « Elle représente ce que j’exècre le plus au monde. »
On y lit aussi des extraits d’articles de presse. Dans Libération, que l’équipe Royal consulte chaque jour, le journaliste Luc Le Vaillant indique qu’« au pays de Ségo-reine, il y aura des dames-sécateurs ». Alain Duhamel déclare, à propos du couple Hollande-Royal : « Elle est la candidate médiatique, il est le prétendant légitime », et publie cette année-là un livre sur les prétendants à l’Élysée dans lequel Royal ne figure même pas.
Royal fera elle-même la chronique de ces anathèmes dans Ce que je peux enfin vous dire (Fayard, 2018) : elle est un « microphénomène de mode » et incarne un « moment mondain » ; elle est « dame patronnesse », « mère fouettarde », « la petite mère des peuples », « une marque de détergent, un vrai produit marketing », une « meneuse de revue ».
Ses tenues sont scrutées. Royal s’habille en blanc depuis 2004 – on lui reproche de jouer sur un registre religieux. Elle opte pour le rouge – elle est accusée de passer plus de temps à choisir ses vêtements qu’à concevoir son programme politique… À Libé, on regrette en 2004 qu’elle ait « longtemps gâché sa beauté sous de longues jupes plissées ».
Son sourire et sa voix font couler de l’encre. Ses chaussures aussi. Une photographie, publiée dans Libération en août 2006, montre des sandales blanches à talon sur l’estrade – celles de Royal qui participe à la Fête de la rose de Frangy-en-Bresse –, derrière quatre roses rouges gisant au sol. « Une construction stéréotypée et symbolique du genre », écrivent en 2009 les chercheur et chercheuse en information et communication Louise Charbonnier et Jean-Claude Soulages, dans la revue Mots2. Le photographe Sébastien Calvet, qui a suivi la socialiste pendant un an, s’en est toujours défendu. Des photos des pieds des politiques, il en a fait souvent. Il n’est pas responsable de la mise en scène de son travail. Royal n’a rien voulu entendre : certain·es se souviennent encore du savon que lui a passé la candidate après la publication de cette photo.
Les images s’inscrivent dans un contexte : celui-ci veut qu’en politique les femmes « se voient présentées […] dans leur singularité de femmes, constamment renvoyées à l’altérité de leur corps […], prisonnières d’une enveloppe corporelle qui les distingue des autres acteurs du champ », résume Cécile Sourd3 dans un article de sciences politiques publié en 2005.
De fait, les portraits de Ségolène Royal la présentent comme un ovni. Avec ses propositions iconoclastes à gauche – la glorification du drapeau national, le discours sécuritaire avec pour corollaire le concept « d’ordre juste » qu’elle popularise, la démocratie participative –, la candidate détonne. Mais son CV, archi-classique, compte parmi les plus fournis de la République.
Elle est énarque – même promotion Voltaire que François Hollande. Elle a été conseillère du président Mitterrand dans les années 1980. Puis députée des Deux-Sèvres, dans une circonscription pour laquelle elle avait arraché l’investiture avec un culot monstre, et où elle a triomphé contre la droite en 1988. En 2004, elle a réussi à conquérir la région Poitou-Charentes, où elle est surnommée « Zapatera » en référence au chef de gouvernement espagnol de l’époque, le socialiste José Zapatero. Quand elle est candidate à la présidentielle, en 2007, elle a été deux fois ministre.
Rien n’y fait. Elle est souvent présentée comme « la fille de » – elle a raconté comment elle a dû s’émanciper de son père militaire –, ou « la femme de ». Dans la presse, le couple Hollande-Royal se décline en « Monsieur » et « Madame », parfois « papa » et « maman ». Elle est sa « moitié », il est « son homme ». Arnaud Montebourg, porte-parole de la candidate, tente d’inverser le stigmate : « Ségolène n’a qu’un défaut, c’est son compagnon. » Le bon mot fait grincer les dents socialistes ; il est suspendu un mois.
« Qu’a‑t-elle fait pour mériter ça ? »
À l’époque, Montebourg ne sait rien du drame qui se joue au sein du couple. Il sera révélé au soir du second tour des élections législatives, le 17 juin 2007. Deux mois après son échec à la présidentielle, Ségolène Royal annonce sa rupture avec François Hollande, en couple avec la journaliste de Paris Match Valérie Trierweiler.
Durant toute la campagne, la candidate a souffert intimement : « J’étais comme un général en chef qui doit remonter sur son cheval malgré la blessure qui saigne à son flanc et qu’il dissimule derrière son armure », confie-t-elle dans Ce que je peux enfin vous dire (Fayard, 2018). Elle est convaincue qu’elle doit se taire. Que la presse, l’équipe de Sarkozy et même les socialistes se gausseraient d’une femme trompée, disqualifiée d’office pour prétendre incarner la République. « Serait revenue l’éternelle question culpabilisante, que mes adversaires et plus encore les machos du PS n’auraient pas manqué de poser publiquement et que seules les femmes subissent : qu’a‑t-elle fait pour mériter ça ? »
Les témoins de l’époque que nous avons interrogés se souviennent aussi de la petite chambre que la candidate avait aménagée à son QG parisien, au n° 282 du boulevard Saint-Germain. « Tous les soirs, elle faisait croire aux journalistes qu’elle rentrait chez elle. Ils voyaient une silhouette qui s’engouffrait dans une voiture. En réalité, elle restait dormir au 282 », se souvient Françoise Degois, alors journaliste à France Inter, qui est ensuite devenue la conseillère spéciale de Royal, à partir de novembre 2009.
Au fil des mois, la candidate ne parviendra jamais à dissiper le soupçon d’incompétence qui la poursuit. Chaque erreur, chaque maladresse – et il y en a eu : de l’emploi hasardeux du terme « bravitude », inventé alors qu’elle est en visite sur la muraille de Chine, aux critiques des 35 heures, pourtant l’une des lois emblématiques votées par les socialistes au tournant des années 2000, en passant par une confusion très grande sur le conflit israélo-palestinien – est lue à l’aune de l’insuffisance supposée de la candidate.
Le procès en incompétence
« Cette campagne était pourtant très réfléchie. Elle s’appuie sur des analyses électorales », se souvient la journaliste Cécile Amar, coautrice avec Didier Hassoux de Ségolène et François – biographie d’un couple (Privé Éditions, 2005). « Royal parie que le temps des femmes est venu – à l’étranger, elle voit Merkel et Michelle Bachelet [au Chili – ndlr]. Elle pense son “ordre juste”. Elle voit la crise démocratique avant tout le monde, et propose la démocratie participative. Elle construit un mouvement en dehors du PS, comme Macron ensuite avec En Marche!. Mais, elle, elle est passée pour une sorcière… » Finalement, rappelle Amar, « tout ce qu’elle faisait était utilisé pour la disqualifier ». Après, « c’est la spirale, l’engrenage ».
« Au fil de la campagne, explique de son côté Françoise Degois, Ségolène Royal a commencé à intérioriser cette violence et ces charges contre elle. Elles ont commencé à devenir des vérités dans sa tête. Et elle a commis de plus en plus d’erreurs. »
« Elle a fait des fautes, on a aussi été victimes de nous-mêmes, dit encore l’ancienne conseillère spéciale Sophie Bouchet-Petersen. Mais l’entreprise de délégitimation a été meurtrière. » L’ex-ministre de l’éducation Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole de Royal lors de la campagne présidentielle de 2007, se souvient très bien qu’à partir de janvier de cette année-là, « cela commence à se déchaîner […] Le récit matraqué est celui de la nullité. Il finit par devenir une évidence. Et les biais de confirmation fonctionnent : tous les éléments allant dans ce sens sont retenus quand ceux qui l’infirment n’impriment pas le cerveau. C’est un toboggan infernal. »
Ça tire dans tous les sens. Y compris chez les socialistes. Michel Rocard vient lui demander de se retirer à son profit. Éric Besson trahit, quittant son mandat de secrétaire national à l’économie du PS pour rejoindre l’équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Il publie un livre assassin : Qui connaît Madame Royal ? (Grasset, 2007).
D’autres feront de même, après la défaite, à l’image de Lionel Jospin qui sort de sa retraite pour publier L’Impasse (Flammarion, 2007). L’ancien premier ministre, battu dès le premier tour à la présidentielle de 2002, parle d’un « fourvoiement ». La lecture de l’ouvrage est édifiante. Jospin y juge que le succès de Royal à la primaire « a tenu sans doute d’abord à sa qualité de femme », que les « commentaires malvenus », sexistes donc, « ont servi la candidature »… Et puis, « dans une formation politique qui valorise la parité […], être une femme n’était pas un handicap ».
Certes l’ancien premier ministre, figure respectée de la social-démocratie, décrypte ses désaccords politiques et stratégiques avec la candidate. Mais il parsème son récit de remarques déroutantes. Il critique « le soin, pour le moins inédit, mis à donner un sens symbolique à son apparence, à se vêtir de blanc », « cette proximité proclamée et cette inaccessibilité organisée » qui « semblaient conçues pour provoquer ferveur et dévotion et non pas pour obtenir une adhésion réfléchie », ou encore « le style inédit qu’elle a donné à ses meetings, appelant les Français à “s’aimer les uns les autres” ou à lui “donner leur énergie” », qui « appartient à un registre assez éloigné des exigences de la démocratie ». Rien de moins.
Chez les féministes non plus, Royal ne fait pas consensus. Pourtant, elle s’est toujours revendiquée de ce courant politique. Elle s’est aussi distinguée toute sa vie par les thématiques qu’elle a portées, et les pratiques qu’elle a mises en place. Ainsi, ministre déléguée à l’Enseignement scolaire dans le gouvernement Jospin, au tournant des années 2000, elle a lutté contre la pédocriminalité et le bizutage. Candidate à la présidentielle, elle promet, si elle est élue, qu’une de ses premières mesures portera sur la lutte contre les violences conjugales.
La valorisation de son rôle de mère heurte les féministes
Par ailleurs, elle s’est toujours entourée de femmes – c’est rare en politique. « Elle aime travailler avec des femmes. Elle nous a mis le pied à l’étrier, à moi, à Najat [Vallaud-Belkacem], et même à Delphine [Batho]… Sa praxis de la politique était vraiment féministe », soutient Filippetti. « Elle a donné confiance à toute une génération de jeunes femmes », salue aussi Vallaud-Belkacem.
Mais la valorisation de son rôle de mère a heurté une partie des militantes féministes. Chez Royal, c’est une constante : dès 1992, elle avait innové en invitant un photographe à la maternité, quelques heures après la naissance de sa fille. En 2007, lors du grand meeting de Villepinte, la candidate lance, émue : « Je sais au fond de moi, en tant que mère, que je veux pour tous les enfants qui naissent et qui grandissent en France ce que j’ai voulu pour mes propres enfants. »
Dans sa campagne, plutôt que son nom de famille, elle utilise son prénom « Ségolène » (scandé par ses partisans en meeting), ou « Ségo » – le regroupement de ses militant·es pendant la campagne, coordonné par son fils Thomas, s’appelle la « Ségosphère ». Pour se distinguer de Sarkozy, elle dit à la télé : « La différence, je crois qu’elle se voit. »
« Elle mettait en scène le fait d’être une femme. Mais ce n’est pas positif en soi. Ce qui importe, c’est le programme politique », commente la militante féministe Caroline De Haas, alors encartée au PS, et se déclarant par ailleurs consciente du sexisme subi par la candidate.
Le piège se referme
« Amorcé par Ségolène Royal elle-même, le piège symbolique a fonctionné. La candidate, (auto-) définie comme mère, a été réassignée à son genre », explique en 2009 la professeure à Sciences-Po Lyon Isabelle Garcin-Marrou.
Les chercheuses Catherine Achin et Elsa Dorlin4 dressent le même constat dans un article publié dans la revue Mouvements en avril 2007, juste avant l’issue de l’élection. Elles rappellent qu’en 1997, la gauche plurielle autour de Lionel Jospin décide d’instaurer la parité pour répondre au « malaise démocratique ». Et elle s’y engage en pensant que les femmes réconcilieront les Français·es avec la politique, en la faisant « autrement », « en mobilisant des qualités réputées féminines ».
« On perçoit ici l’effet pervers de la “quadrature du cercle” : appelées en politique au nom de leur “différence” et de capitaux politiques spécifiques, historiquement associés à leur sexe […], les femmes sont pénalisées dans la conquête des réelles positions de pouvoir qui reste attachée à la possession de ressources plus classiques », écrivent Achin et Dorlin. Quoi qu’elles fassent, les femmes sont exclues. Illégitimes.
Quinze ans plus tard, aucune femme n’a jamais été élue présidente de la République ou présidente de l’Assemblée nationale. Aucune, depuis, n’est devenue première ministre. La seule à avoir atteint le second tour d’une élection présidentielle est la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen. C’était en 2017.
Régulièrement, les femmes élues ou militantes sont moquées, prises à partie ou déconsidérées. Christiane Taubira, Nathalie Kosciusko-Morizet, Chantal Jouanno, Najat Vallaud-Belkacem, Cécile Duflot… Toutes peuvent en témoigner. La dernière cible en date s’appelle Sandrine Rousseau, finaliste de la primaire EELV à l’automne 2021 et féministe revendiquée. Sa candidature et son discours ont été salués par un déclenchement violent de sexisme.
« Aujourd’hui, je regarde le parcours de Ségolène Royal différemment de la manière dont je l’ai perçu en 2007 », admet l’écologiste. À l’époque, elle la voit comme « un animal politique étonnant », aux « accents mystiques », avec qui les désaccords sont profonds : « J’avais des lignes rouges – les drapeaux au 14-Juillet, le discours sécuritaire ». Sandrine Rousseau poursuit : « Il m’a fallu vivre ma campagne pour comprendre que ce qu’elle avait subi était du sexisme, ou plutôt une haine des femmes libres en politique. » Et l’économiste lilloise, plaignante dans l’affaire Baupin en 2016, conclut : « Cette haine des femmes indépendantes est sidérante. Depuis Cléopâtre dont on ne retient que le nez et la beauté, on n’est toujours pas prêt·es. »
Une époque révolue ?
Le constat est partagé par la politiste Frédérique Matonti, autrice d’un livre de référence, Le Genre présidentiel (La Découverte, 2017), et fine connaisseuse de la campagne de Royal. « Depuis 2007, je ne suis pas certaine que cela ait beaucoup évolué pour les femmes en politique. Il faudra aussi surveiller la campagne d’Anne Hidalgo5. En réalité, l’irruption des femmes dans l’espace public a précipité les discours réactionnaires. Plus on en voit, plus le retour de bâton est fort. C’est vrai pour les femmes, mais aussi pour l’intersectionnalité et les luttes antiracistes. »
En cet hiver 2021–2022, un pamphlétaire d’extrême droite, condamné pour incitation à la haine raciale et accusé d’agressions sexuelles par au moins sept femmes, enchaîne les plateaux télé. Candidat à la présidentielle, Éric Zemmour y déverse sa misogynie et sa transphobie. « Royal a été moquée pour avoir appelé à la “fra-ter-ni-té”. Elle disait qu’on devait s’aimer. C’était génial », se souvient son ancienne conseillère pour la presse, Dominique Bouissou. « Aujourd’hui, les Zemmour et Le Pen fracturent la société. On est dans le mur. » Personne n’a encore rallumé les soleils.
*
1. Laurent Fabius a démenti à de nombreuses reprises avoir prononcé cette phrase.
2. Louise Charbonnier et Jean-Claude Soulages, « Les destins croisés ou les avatars du genre. Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal vus par les photographes de Libération », Mots. Les langages du politique, 2009 (n° 90).
3. Cécile Sourd, « Femmes ou politiques ? La représentation des candidates aux élections françaises de 2002 dans la presse hebdomadaire », Mots. Les Langages du politique, 2005 (n° 78).
4. Catherine Achin et Elsa Dorlin, « J’ai changé, toi non plus. La fabrique d’un‑e Présidentiable : Sarkozy/Royal
au prisme du genre », Mouvements, 5 avril 2007.
5. Candidate déclarée pour le PS à l’automne 2021. Au moment où nous bouclons ces pages (21 janvier 2022), quatre autres femmes sont officiellement candidates à l’élection présidentielle : Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), Marine Le Pen (Rassemblement national), Valérie Pécresse (Les Républicains) et Christiane Taubira (divers gauche).