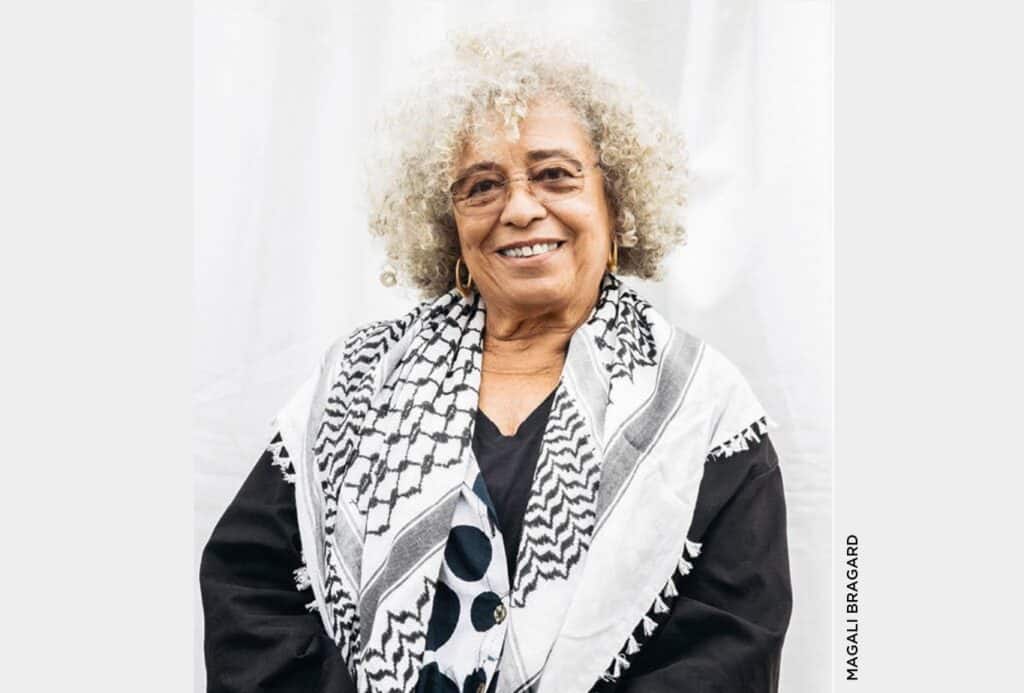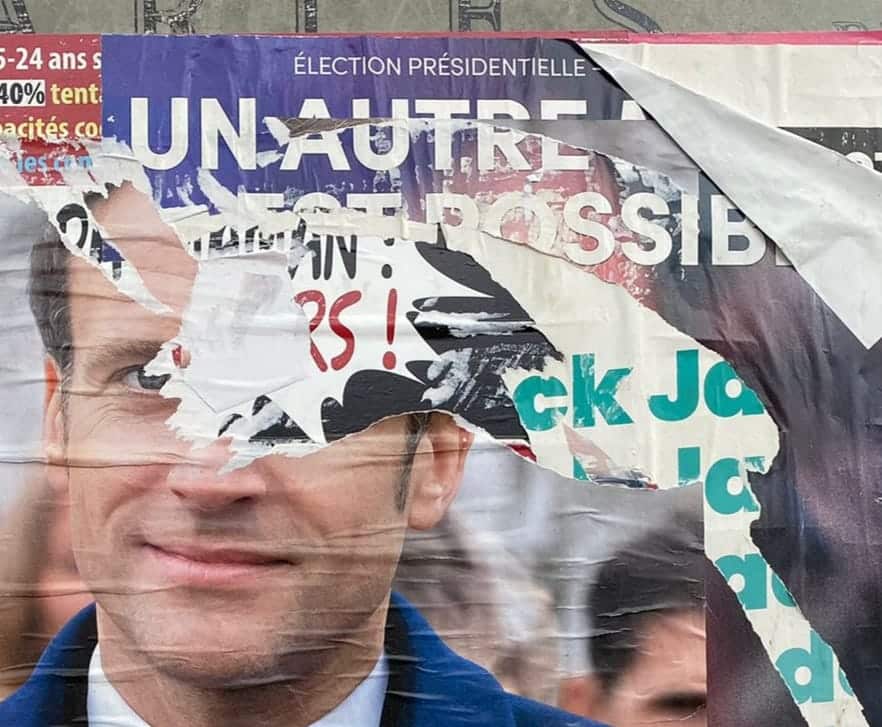Professeure de droit à l’université de Californie à Los Angeles (UCLA) et à Columbia (New York), Kimberlé W. Crenshaw est à l’origine d’une réflexion critique qui envisage comme structurelles les inégalités raciales dans le système politique et juridique aux États-Unis.
Depuis le 20 janvier, l’administration Trump multiplie les attaques contre les universités : baisse des budgets, restriction des libertés académiques, censure des sujets de recherche liés au genre ou à la race. Quelle ambiance règne actuellement sur les campus ?
Nous sommes sous le choc. Les conseils d’administration sont prêts à se plier aux exigences de Donald Trump pour ne pas se voir retirer leurs financements fédéraux. Du coup, si nous continuons à enseigner les questions féministes ou la théorie critique de la race malgré les interdictions, nous risquons de ne pas être défendu·es par nos directions. Déjà dans les années 1950, à l’époque du maccarthysme, les universités avaient dû supprimer leurs départements d’études raciales. En limitant la transmission des savoirs qui entretiennent l’esprit critique, on renforce le discours conservateur, ce qui permet à l’extrême droite de se placer au centre du jeu et, désormais, au centre du pouvoir.
Grâce au dynamisme de ses universités et des recherches sur le genre et la race, les États-Unis sont mondialement considérés comme le berceau de la théorie intersectionnelle. Comment expliquez-vous que ce même pays ait pu élire deux fois Donald Trump ?
L’idée selon laquelle les États-Unis sont une nation blanche où les femmes ont pour mission de procréer reste très enracinée dans notre culture. Et elle se réactive facilement dès que ressurgit la peur ancienne de la fin de la dominance blanche.
L’attaque du Capitole par les soutiens de Donald Trump, en janvier 2020, avait pour objectif affiché de « reprendre le pays ». Mais à qui, si ce n’est aux électeur·ices racisé·es qui avaient voté pour Joe Biden ? En 2024, la possibilité que Kamala Harris, une femme noire, soit élue à la Maison Blanche a réactivé cette peur chez les partisan·es de Trump, qui n’ont eu de cesse, pendant toute la campagne, de la réduire à sa race et à son genre pour la disqualifier.
En se présentant comme le seul capable de sauver le pays, Donald Trump a obtenu le vote des femmes [blanches], des hommes latinos et des hommes africains-américains, qui ont cru à l’idée que leur pays était pris d’assaut par « l’autre », c’est-à-dire n’importe qui n’étant pas eux. Beaucoup d’entre elles et eux ont pensé que les politiques de discrimination que Trump ne manquerait pas de mettre en place ne les concernaient pas.
Les attaques contre les idées et les politiques discriminatoires ne sont pas une nouveauté aux États-Unis…
Toutes les études et les initiatives pouvant apporter plus d’égalité entre les citoyen·nes, qu’il s’agisse des travaux critiques de la race, de ceux portant sur l’intersectionnalité ou du « Projet 1619 » lancé en 2019 par le New York Times Magazine pour réévaluer les conséquences politiques de l’esclavage, ont été férocement attaquées par les mouvements conservateurs. La loi « Don’t say gay » [Ne prononcez pas le mot « gay »], interdisant tout enseignement en lien avec l’orientation sexuelle et le genre à l’école, qui a été votée en 2022 par plusieurs États, a fragilisé les droits des personnes LGBTQIA+ dans le secteur de l’éducation.
Les États-Unien·nes n’ont pas compris que, en s’en prenant à ces enseignements, on cible les idées mêmes d’égalité et d’inclusion, mais aussi les politiques qui les favorisent. Progressivement, toutes les actions et toutes les institutions qui conscientisent l’opinion et assurent plus d’inclusion ont été démantelées. Désormais, les attaques contre nos droits se propagent dans toute la société, jusqu’aux entreprises françaises commerçant avec l’État fédéral états-unien, dont les politiques de diversité sont menacées.
« C’est parce que la théorie intersectionnelle est très efficace pour identifier les inégalités qu’elle est aujourd’hui menacée »
En quoi l’intersectionnalité et la théorie critique de la race peuvent-elles nous venir en aide pour élaborer une réponse à ces attaques ?
Les mouvements des droits civiques dans les années 1960, puis féministes dans les années 1980, ont permis aux femmes et aux personnes noires d’obtenir davantage de droits. Sauf que rien ne concernait spécifiquement les femmes noires. Par exemple, dans l’affaire DeGraffenreid vs General Motors, en 1976, cinq ouvrières noires ont porté plainte contre le constructeur automobile pour discrimination à l’embauche en raison de leur genre et de leur race. Mais la cour a refusé de reconnaître leur préjudice au motif que des femmes – blanches – et des Noirs – uniquement des hommes – étaient par ailleurs embauché·es dans l’entreprise.
La théorie intersectionnelle permet aujourd’hui d’identifier les dysfonctionnements d’institutions qui discriminent spécifiquement les femmes racisées parce qu’elles appliquent encore un logiciel combinant racisme et sexisme.
Penser à travers ce prisme permet de questionner de vieux réflexes, comme le fait de croire que Kamala Harris, parce qu’elle est une femme noire, serait incompétente, alors qu’elle a été la procureure générale de l’État le plus peuplé des États-Unis, la Californie.
C’est parce que ces théories sont très efficaces qu’elles sont aujourd’hui menacées. Imaginez un bâtiment rempli d’amiante dont des promoteurs prétendent qu’il est sain : pour perpétuer ce mensonge, ils vont prohiber l’emploi du mot « amiante », empêcher le recours à des expert·es et à toutes les méthodes permettant d’évaluer l’état du bâtiment pour ensuite l’assainir. C’est ce que fait Donald Trump quand il interdit l’enseignement et la recherche sur la théorie critique de la race ou l’intersectionnalité.
Peut-on encore combattre la politique de Trump sur le plan légal ?
Historiquement, la loi a toujours été du côté des oppresseur·euses, mais les opprimé·es n’ont pas d’autre choix que de s’y référer également, car c’est elle qui fixe les règles communes. Depuis des années, les conservateur·ices œuvrent pour contrôler le système judiciaire – le droit en général – et pour stopper l’avancée des droits civiques. Par exemple, quand, juste avant la fin de son premier mandat, Donald Trump est passé en force pour faire nommer Amy Coney Barret – une juge très conservatrice, soutenue par la droite religieuse – à la Cour suprême, les États-unien·nes ne se sont pas indigné·es, car elles et eux ne comprennent pas suffisamment le fonctionnement du droit et des institutions – c’est ce sur quoi a échoué la gauche.
L’État de droit, même s’il est affaibli, reste la seule digue qui se dresse face à Donald Trump : des recours contre sa politique vont bientôt passer devant les juges, et très probablement l’emporter, à l’instar de celui s’opposant au démantèlement de l’Agence américaine pour le développement international, jugé anticonstitutionnel par un tribunal du Maryland en mars 2025.
Mais qu’adviendra-t-il s’il passe outre ? Nous ne sommes pas préparé·es à basculer dans un régime autoritaire où le président se fiche de nos institutions. Les dommages causés par sa politique ne pourront peut-être pas être réparés de notre vivant. L’horizon qu’il nous faut viser, c’est le siècle prochain. Mais si on ne lutte pas dès maintenant, on laissera aux générations futures un monde bien pire encore. Rien ne garantit que nous gagnerons, mais ce qui est sûr, c’est que nous perdrons si on ne se bat pas.