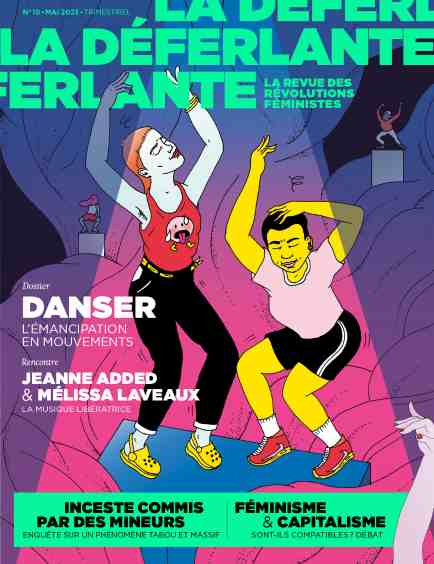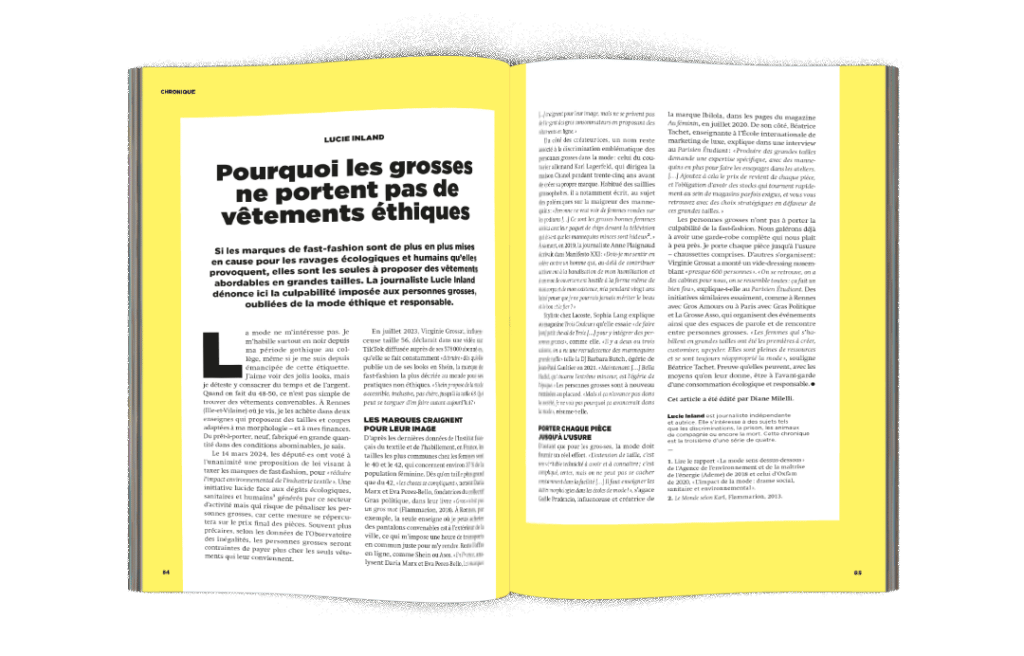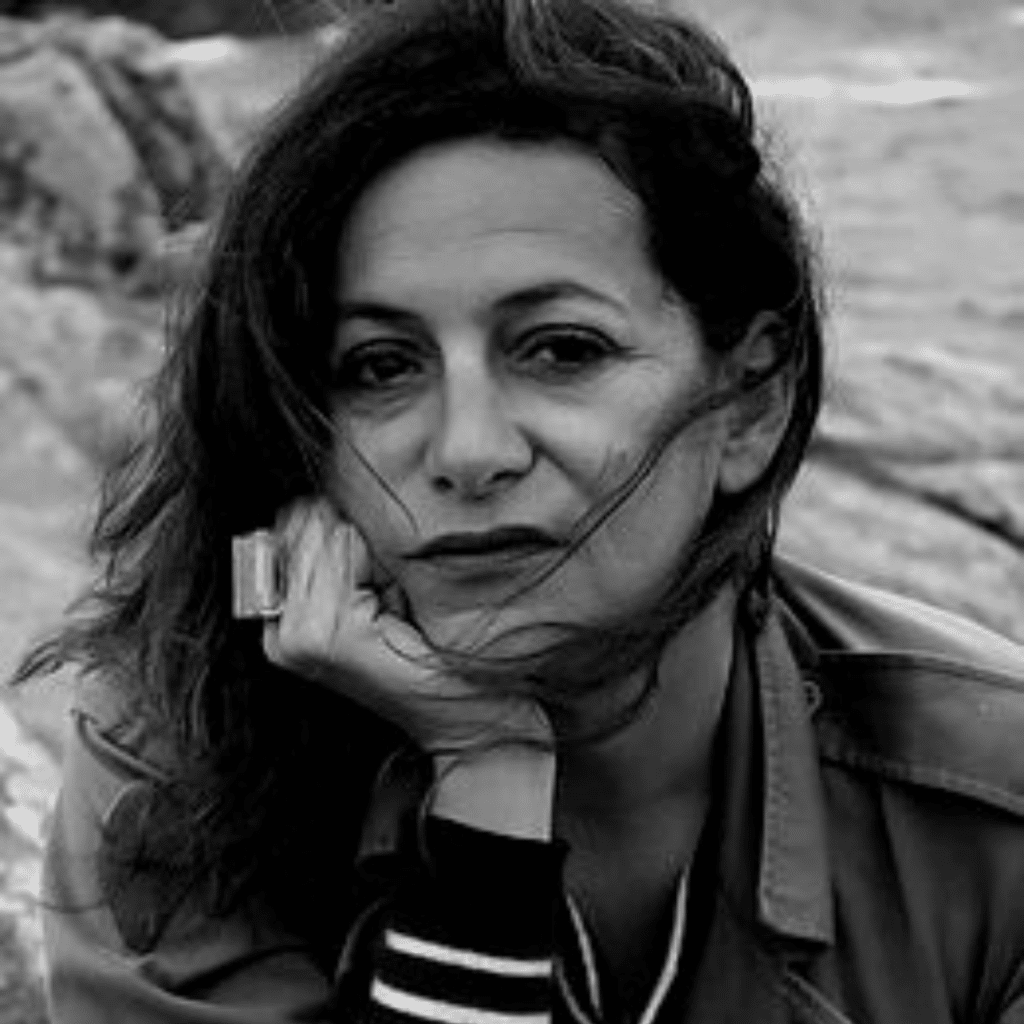On reconnaît tout de suite la mélodie du tube I will survive, repris jusqu’à plus soif à la Coupe du monde de 1998. Sauf que les paroles entonnées dans les manifs en 2023 n’ont rien à voir avec celles de la chanson originale de Gloria Gaynor : « Nous on veut vivre, pas juste survivre ! 64 ans, non, la retraite il la faut avant ! » Les yeux cernés de noir façon zombies, une dizaine de femmes imitent les célèbres pas de la chorégraphie de Michael Jackson dans Thriller. Les mouvements s’enchaînent, les danseuses se tapent le cœur et lèvent le poing en rythme. Nous ne sommes pas à une soirée, mais en pleine rue, au cœur des manifestations de l’hiver 2023. Tout de bleu (de travail) vêtues, en hommage à l’icône pop Rosie la riveteuse¹, les « Rosies » défilent contre la réforme des retraites, en dansant.
Formé au sein de l’association altermondialiste Attac en 2019 pour protester contre le premier projet de réforme des retraites défendu par Emmanuel Macron, le collectif est désormais bien rodé. Des tutos sur Internet permettent aux manifestant·es d’apprendre la chorégraphie en amont des mobilisations. Les paroles de plusieurs chansons détournées exposent avec humour et clarté l’impact des réformes sur les femmes, les précaires et « les prolos ». Enfin, les vidéos circulent sur les réseaux sociaux… Et les résultats sont là. « Au moment du premier acte anti-réforme, nous avons comptabilisé quelque soixante-dix cortèges de Rosies à travers le pays, se réjouit Youlie Yamamoto, pilier du collectif. Pour certaines, c’était leur première manif : la danse les rassure et leur ouvre un espace d’expression. »
« Danser, chanter : ce sont des façons de se confronter à nos peurs avec douceur. »
Youlie Yamamoto, cofondatrice du collectif Les Rosies
Entre une répétition de la choré et un atelier de fabrication des décors, Youlie Yamamoto raconte. À ses yeux, la désobéissance par la danse s’inscrit dans une réflexion plus générale : comment varier les formes de protestation pour attirer l’attention, mais aussi permettre aux mouvements sociaux de durer dans le temps ? Elle-même danseuse à ses heures perdues, elle imagine avec d’autres militantes une chorégraphie simple qui sollicite surtout le haut du corps, à la façon de la Macarena. « Peut-être parce qu’on est des femmes, on a parfois plus de facilité à utiliser nos corps que nos voix, à danser plutôt qu’à faire de longs discours, glisse-t-elle. Le militantisme de conférence a un côté plombant ! Danser, chanter : ce sont des façons de se confronter à nos peurs avec douceur. » Youlie dit que ce mode d’action lui a valu critiques et moqueries dans les milieux militants. Les Rosies seraient « des gourdes » aux méthodes « naïves ». Elle ne s’en émeut pas trop : le débat n’est pas nouveau.
« Si je ne peux pas danser, ce n’est pas ma révolution »
L’histoire d’Emma Goldman² en témoigne. On attribue communément à cette militante anarchiste d’origine russe, ayant migré aux États-Unis dans les années 1880, un slogan tagué sur les murs aux quatre coins du monde : « If I can’t dance, I don’t want to be in your revolution », repris en français par « Si je ne peux pas danser, ce n’est pas ma révolution ». Il n’existe en réalité aucune trace de cette phrase précise dans les écrits de Goldman. Ce qu’elle décrit en revanche dans ses mémoires, Vivre ma vie, publiés en 1931, est l’anecdote suivante : un soir de fête où elle danse et s’amuse, un militant vient lui chuchoter à l’oreille qu’il « ne sied pas à une agitatrice de danser » et que « sa frivolité nuit à la cause ». Goldman, qui a payé son engagement politique par de multiples emprisonnements, est furieuse. « Il est inconcevable, rétorque-t-elle, qu’un bel idéal comme l’anarchisme puisse exiger le refus de la vie, de la joie. » Elle ajoute que même dans les moments de lutte les plus difficiles, « les gens ont le droit à des choses radieuses ».
Quelques décennies plus tard, des militant·es de la gauche états-unienne vont détourner cette anecdote pour en faire un slogan qui va rencontrer un large succès. En 1973, l’essayiste Alix Kates Shulman, spécialiste de la pensée d’Emma Goldman, est sollicitée par un vieux copain anarchiste, imprimeur de profession. Il cherche une citation qui pourrait accompagner les mobilisations féministes de l’époque. Alix Kates Shulman lui raconte alors l’anecdote de la soirée dansante d’Emma Goldman. Voici bientôt la pensée de Goldman ramassée en une formule courte et efficace, un brin simplificatrice : « Si je ne peux pas danser, ce n’est pas ma révolution. » Floqué sur des tee-shirts, des pin’s, des autocollants, le slogan va traverser les époques et les continents. Et s’il suscite une telle adhésion, c’est qu’il soulève une question essentielle : quelle place accorder à la danse et à la joie dans nos luttes, aussi cruciales et violentes soient-elles ?
Une place immense, si l’on en croit Nadège Beausson-Diagne. L’actrice, rendue populaire par la série Plus belle la vie, a participé à la grande manifestation contre les violences faites aux femmes organisée en novembre 2022 par l’association Nous Toutes. Pendant la marche, elle s’est jointe à la chorégraphie exécutée, pendant quelques minutes, par une partie du cortège. L’initiative était portée par Dame Chevalier, un collectif féministe et anticapitaliste de formation récente. Sur un son électro ponctué par la prose de l’essayiste africaine-américaine Audre Lorde, les marcheuses ont ondoyé tout en lenteur, mimant des gestes d’autodéfense au ralenti, faisant mine d’éviter les coups en inclinant le buste. Parmi elles, des artistes, des membres de l’association de football féminin LGBT+ Les Dégommeuses et des manifestantes s’étaient spontanément jointes à la danse. En conclusion de la performance, toutes ont répété ce cri à l’unisson : « Violences sexistes, riposte féministe ! »
Au téléphone, Nadège Beausson-Diagne est encore émue par la puissance de ce moment partagé. « On a dansé lors de la marche, puis de nouveau le soir après nous être retrouvées dans un bar, juste entre nous, se remémore-t-elle. Je me suis réveillée le lendemain réellement ivre de joie, moi qui ne bois pas ! Il faut vraiment batailler pour sortir de l’isolement induit par le capitalisme et récupérer nos joies. Danser ensemble est une façon d’y parvenir. » C’est aussi le pari de Dame Chevalier. La chorégraphie, signée par l’artiste contemporaine Gisèle Vienne, a été mise en ligne sous forme de tuto, à l’instar de celles des Rosies. Dans la vidéo filmée dans les bois, la chorégraphe répète chaque mouvement, accompagnée par une élève enthousiaste et concentrée : la comédienne Adèle Haenel. Leur manifeste se résume ainsi : « Danser pour se donner de la force, pour reprendre l’espace, et ne plus s’arrêter avant d’avoir tout changé. »
La chorégraphie comme contre-culture
Dans Se défendre. Une philosophie de la violence (Zones, 2017), un essai qui explore les pratiques d’autodéfense mises en place par différents groupes minoritaires, la philosophe Elsa Dorlin consacre plusieurs passages à la danse. En décembre 2021, à l’invitation de Gisèle Vienne justement, elle a également donné une conférence intitulée « Chorégraphie de la puissance » au Centre national de la danse de Pantin³. « Cela me rappelle d’autres moments historiques comme les manifestations du Mouvement de libération des femmes. Leurs marches n’empruntaient pas les codes virilistes de la manifestation syndicale ou du défilé militaire. Les militantes formaient des rondes, des farandoles, elles se tenaient par les mains ou les épaules, explique Elsa Dorlin au téléphone. Les minorités ont toujours été exclues du langage politique hégémonique. Elles sont inaudibles et invisibles dans l’espace public. Ces modes d’expression passant par la danse se retrouvent fréquemment dans l’histoire des luttes. »
Les références sont anciennes – telles que le carnaval médiéval, qui permettait de s’approprier temporairement des espaces interdits et de renverser les hiérarchies, ou les cultures et les arts forgés par les résistances esclaves. Aux Antilles, le gwoka est aujourd’hui encore enseigné dans les écoles de danse, notamment en Guadeloupe : mêlant chant, percussions et danse, il est né durant les années d’esclavage, au son d’instruments fabriqués à l’aide de tonneaux. « Dès la fin du xviie siècle, le Code noir⁴ interdit la danse, sauf celle mise en scène par les colons, rappelle Elsa Dorlin. Mais les esclaves ont résisté en créant des chants et des danses, des arts du combat. Contre la violence, dans un monde ségrégué et abîmé, ils ont généré de la joie et de l’extase. » Selon la philosophe, il ne s’agit pas de juger s’il est utile ou approprié de danser mais plutôt de savoir pourquoi l’on danse. S’agit-il de rendre les luttes festives et agréables à regarder ? D’éviter l’affrontement ? Ou bien de sentir son corps et celui des autres, et ainsi « construire de la confiance, du collectif » ? Pour ce qui est de la dernière hypothèse, le collectif Las tesis a, selon elle, marqué un tournant.
Anticapitalisme et féminisme radical
En 2019, quatre féministes chiliennes de Valparaiso, ville ayant une longue tradition des arts de rue, créent une performance inédite dans un contexte de contestation sociale de grande ampleur et de répression brutale. Inspirées des travaux de l’anthropologue argentine Rita Segato sur la culture du viol, elles ont pour objectif de rendre les violences de genre visibles et de traduire dans un langage artistique des thèses et travaux d’universitaires féministes latino-américaines, d’où le choix du nom Las Tesis, « les thèses » en espagnol. La chorégraphie Un violador en tu camino (Un violeur sur ton chemin), qui allie chant et danse avec une efficacité redoutable, s’est diffusée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. « Las Tesis a proposé une danse qui convertit la violence, analyse Elsa Dorlin. Elles ne s’adressent pas au pouvoir – l’État, la justice, la police ou le système patriarcal. Elle le désigne directement comme coupable, elle le pointe du doigt comme violeur et meurtrier. Cette danse ravive des corps et rassemble des femmes. C’est un hymne aux résistances féministes et une parfaite incarnation de ce que peut être un chœur politique. » Décuplé, amplifié, leur geste est devenu une vague qui a circulé d’un bout à l’autre de la planète⁵.
« Les marches du MLF n’empruntaient pas les codes virilistes de la manifestation syndicale. Les militantes formaient des rondes, des farandoles, se tenaient par les mains ou les épaules. »
Elsa Dorlin, Philosophe
À cette mise en scène saisissante, il fallait donner suite par la danse, nous raconte la chorégraphe Gisèle Vienne, quand nous la rencontrons dans un petit café situé en face du Centre national de la danse, à Pantin, en Seine-Saint-Denis. À l’été 2022, le collectif Dame Chevalier auquel elle appartient entame un dialogue avec les féministes chiliennes de Las Tesis. Bientôt naît la fameuse chorégraphie Riposte féministe dansée pendant la marche Nous Toutes. « Elles nous ont ouvert le champ », résume la metteuse en scène. On sent que cette dernière, plus habituée aux scènes pointues qu’aux arts de rue, est à un moment de bascule : elle cherche d’autres canaux d’expression pour son militantisme anticapitaliste et féministe. « Cela a plus de sens aujourd’hui de travailler aux côtés des Dégommeuses que de l’opéra bourgeois, lance-t-elle. Tentons d’être radicales et de quitter le champ morbide du capitalisme. » Sa crainte était que la performance de rue puisse s’apparenter à de « l’animation mondaine », pas forcément accessible. Mais Gisèle Vienne a dépassé cette angoisse : « Écrire la chorégraphie avec les manifestants donne tout son sens à la rue et au geste artistique, qui est toujours politique. »
Gisèle Vienne ambitionne de faire de la danse une préparation physique à la lutte autant qu’un instrument pour changer nos perceptions. « J’aimerais que l’on apprenne à sentir les alertes sensibles qui remuent nos corps. Si j’entends “rage” quand on me dit “raison”, cela a un sens. Nous devons descendre dans la rue avec toutes les personnes qui souffrent des inégalités issues de ce système capitaliste. » Gisèle Vienne parle vite, s’anime, décrit avec passion la puissance du geste de Pina Bausch (1940–2009), l’une des plus célèbres chorégraphes du xxe siècle, qui fut parmi les premières à dire les violences sexistes au moyen de la danse. Gisèle Vienne se lève. « De toute façon, nous n’avons pas d’autre choix que de nous déchaîner pour laisser un monde le moins pourri possible aux générations à venir. » Ce sera physique.
1. « Rosie la riveteuse » figure sur une affiche états-unienne encourageant l’engagement des femmes dans l’industrie de l’armement pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa posture – poing levé, biceps exhibé – et la devise « We can do it » (On peut le faire) en ont progressivement fait un emblème féministe.
2. Lire l’article « Emma Goldman, la radicalité joyeuse », La Déferlante n°8, novembre 2022.
3. Conférence donnée dans le cadre du séminaire « Travailler la violence », en accès libre sur le site du CND.
4. Le Code noir désigne l’arsenal de textes juridiques édictés aux xviie et xviiie siècles pour organiser la condition des esclaves dans les colonies françaises. Abrogé une première fois en 1794, il est rétabli en 1802, puis définitivement aboli le 27 avril 1848.
5. Lire l’article « Las Tesis, ces Chiliennes qui chantent et dansent contre le viol », La Déferlante n°1, mars 2021.