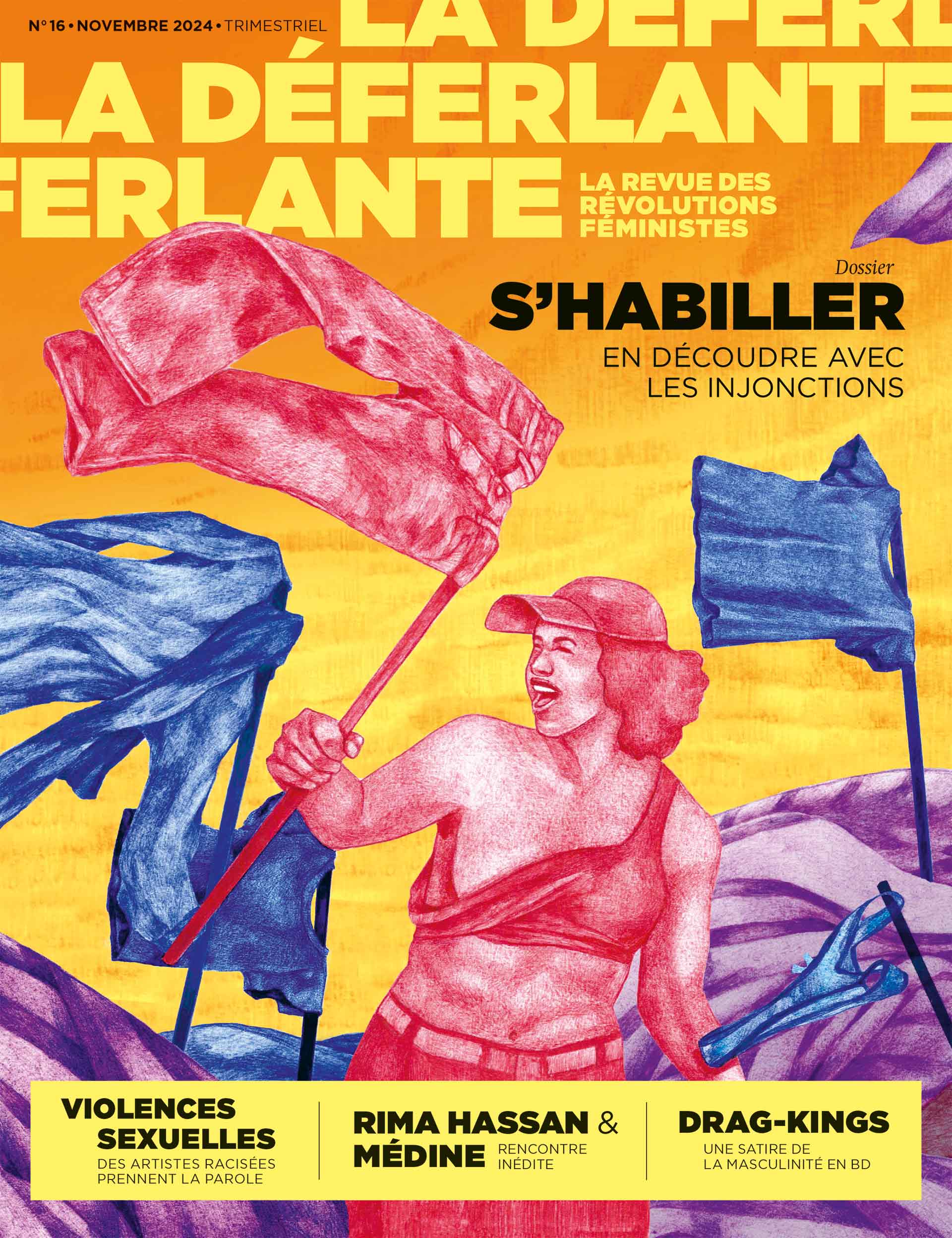« J’ai toujours bien aimé les vêtements. Pendant la nuit je pense à une tenue, et je suis hésitant. Parfois j’hésite à la mettre, car je sais que je vais avoir des avis négatifs, des regards. Mais je la mets quand même, parce que j’ai envie de porter cette tenue. »
Ce jour-là, Josué arbore un dos nu à dentelles noires et une splendide accumulation de colliers dorés. À 19 ans, le jeune homme est en terminale MMV (métiers de la mode et du vêtement) dans un lycée professionnel de Nantes (Pays de la Loire). Il fabrique et coud lui-même certains de ses bijoux et vêtements. Pour lui, la tenue est un moyen d’affirmer sa personnalité. « Avec les vêtements, tu peux t’exprimer publiquement », renchérit Chanez, 17 ans, dans la même classe.

Josué fabrique ses propres vêtements et bijoux.
Pourtant, dans une société de plus en plus crispée sur la question des apparences et des normes, attaquer la jeunesse sur sa tenue est la dernière tocade éducative. Une tendance qu’illustrent aussi bien la décision de Gabriel Attal, alors ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, d’interdire à partir de la rentrée 2023 le port de l’abaya (une robe longue et ample) ou du qamis (1) (longue tunique portée par les hommes), perçus comme vêtements religieux, au sein des établissements scolaires (lire l’encadré ci-dessous), que le projet d’expérimenter l’uniforme à l’école lancé en 2024.
Pour Aude Le Guennec, anthropologue du vêtement à la Glasgow School of Arts, « la question vestimentaire semble aujourd’hui être la seule “prise” des adultes sur cette jeunesse ». Au risque de venir brider sa construction identitaire, facilement taxée de communautarisme. Pourtant, les étudiant·es qu’elle connaît « essaient, tentent, expérimentent. Leur culture est versatile et inattendue ».
Interdictions vestimentaires à l’école : ce que dit la loi
La loi du 15 mars 2004 encadre, « en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ». Selon l’article L141‑5–1 du Code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Encadrer ne signifiant pas interdire, la loi donne lieu à de multiples interprétations qui s’apprécient au cas par cas. Les signes dits d’appartenance à une religion – kippa, croix, voile – peuvent être portés de façon discrète, sans manifestation de prosélytisme. Dans les faits, c’est le foulard qui est visé par cette loi, et c’est lui que les élèves doivent enlever avant d’entrer dans les établissements scolaires.
Malgré de nombreuses tentatives de légiférer dans le sens d’une interdiction, il est en revanche possible de porter le voile ou d’autres signes religieux à l’université, ainsi que dans l’espace public. Les fonctionnaires – dont les enseignant·es du service public – sont également tenu·es de respecter une stricte neutralité et de ne pas afficher manifestement leurs convictions religieuses.
Le 31 août 2023, une note de service parue au Bulletin officiel de l’Éducation nationale précise que le port de tenues longues et couvrantes de type abaya ou qamis « manifestant ostensiblement une appartenance religieuse en milieu scolaire ne peut y être toléré ». Le texte rappelle qu’en cas de non-respect, un dialogue doit être engagé avec l’élève avant la mise en place d’une procédure disciplinaire.
Une seule religion visée
Amina, 18 ans, est en terminale AEPA (animation enfance et personnes âgées). La jeune femme, qui se voile au quotidien, adopte pour le lycée un look pantalon large et sweat. C’est ce qu’Aude Le Guennec nomme « la mode modeste » : des tenues couvrantes et confortables, dont sont actuellement remplis les rayons de la fast-fashion et que l’on voit régulièrement lors des défilés des fashion weeks. « Je vois beaucoup de jugements liés à ma robe large et à mon voile, confie Amina. Les gens me regardent comme s’ils avaient peur. Moi je me sens mieux dans ma robe, mais je suis à l’aise aussi en pantalon. »

Amina est en terminale. Au lycée, elle est contrainte d’enlever son voile.
Lovona, 17 ans, et Fatima, 16 ans, sont en première AGOrA (assistance à la gestion des organisations et de leurs activités). L’une a troqué son jean déchiré et son haut moulant pour un voile, l’an dernier. « C’est mon choix. On peut penser que ça me freine, mais non. Ça me fait plaisir, et ça ne m’empêche de rien. » L’autre est régulièrement la cible d’une partie du corps enseignant, qui ne supporte pas qu’elle porte au lycée un bandeau en coton noir acheté dans une enseigne de sport, alors que ses longs cheveux en queue de cheval sont pourtant bien visibles. « L’école est laïque, on respecte ça. Alors pourquoi nous jeter des regards insistants lorsqu’on enlève notre voile avant le portail ? », demandent-elles.
Le syndicat SUD Éducation qui s’était déjà ouvertement positionné contre la loi 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques (lire l’encadré ci-dessus), s’oppose également aux dispositions récentes sur l’abaya et le qamis. « Le problème, c’est que non seulement c’est toujours la même religion qui est visée, mais aussi toujours le même genre, estime Lucie (elle préfère ne pas donner son nom de famille), enseignante et animatrice de la commission anti-sexisme du syndicat. L’histoire des qamis c’est juste pour cacher le sexisme. En vérité, la laïcité, c’est pour les musulmanes. Et sous couvert de laïcité, on renvoie des filles chez elles. »
Le syndicat, qui se positionne clairement en faveur du libre choix par les élèves de leur tenue, a régulièrement des remontées de collègues faisant face à des chef·fes d’établissement, des CPE ou des enseignant·es zélé·es, qui s’appuient sur les exigences vestimentaires du règlement intérieur. « Mais légalement, on n’a même pas le droit d’imposer une tenue vestimentaire ! Quant aux critères définis dans les règlements, ils sont toujours sujets à interprétations… Au final, il s’agit surtout d’adultes qui veulent contrôler le corps des jeunes filles. »
Pour Alice Pfeiffer, journaliste de mode et titulaire d’un master en gender studies de la London School, l’agentivité des jeunes femmes est délibérément ignorée. « On prête une soumission patriarcale absolue au fait de se voiler, alors que cela peut tout à fait être un choix. Et ce n’est ni l’affaire du gouvernement, ni de certaines féministes ! » Pour Aude Le Guennec, « l’abaya est stigmatisée et on renvoie alors l’adolescente à la règle. Mais les tenues larges qui sont à la mode, elles, ne semblent poser aucun problème. En fait, il y a deux poids deux mesures. Où place-t-on le curseur ? Et aussi, qui le place ? ».

Till, élève de terminale animation enfants et personnes âgées (AEPA).
Till, 17 ans, est en terminale AEPA, dans la classe d’Amina. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi ses camarades subissent autant de réflexions sur leurs tenues. Son « langage non verbal », à lui aussi, est fait de sweats et de pantalons larges, sans que l’équipe pédagogique semble s’en offusquer.
« À Nantes, ça va encore, c’est une grande ville, il y a une ouverture d’esprit », admet Justine, 19 ans, en terminale MMV. L’étudiante, dont la mère était couturière, porte un corset serré sur une chemise blanche à volants, une jupe noire – look que les quadras ayant grandi dans les années 1990 qualifieraient de « gothique » – et un trait d’eye-liner à faire pâlir Amy Winehouse. Si elle a l’habitude des regards admiratifs ou étonnés sur ses tenues, elle trouve odieuse la forme de fétichisation de certains hommes à son égard. « Je n’ai pas envie d’être un fantasme ! », assène-t-elle. Quant à certain·es enseignant·es, ils et elles insistent sur la nécessité de porter une tenue sobre pour décrocher un stage ou passer un examen. « Le milieu scolaire est très patriarcal, résume Justine. On nous dit de ne pas trop être dans “l’extravagance”, pas trop maquillé·e, pas trop tatoué·e… En tout cas, moi, j’ai toujours réussi à obtenir un stage ! »

Justine (en jupe) adopte les codes du style gothique, et Chanez, se reconnaît dans le style « old money ».
Ces crispations témoignent d’une forme d’ignorance liée à l’absence d’éducation vestimentaire, estime Aude Le Guennec : « On voit le vêtement comme un objet de consommation, alors qu’il est un objet de socialisation. Qu’est-ce qui fait vêtement ? C’est quoi, un look ? On a totalement mis de côté la subtilité du langage du vêtement. Quant à la fabrication du citoyen français, elle relève d’une vision jacobiniste. On doit tous être pareils. » Au contraire, comme l’explique Virginie Vinel, professeure de sociologie et d’anthropologie à l’université de Franche-Comté, les New Childhood Studies (c’est-à-dire les nouvelles approches en sociologie de l’enfance) « considèrent les enfants, les adolescentes et les adolescents comme des actrices et acteurs sociaux, dont les pratiques sont produites par les structures sociales, mais qui interprètent et participent à la construction, voire à la modification de leur environnement ».
Le chiffon rouge de la police du vêtement
Les nouvelles générations se montrent davantage critiques des commentaires qui peuvent être prononcés à leur égard, sur leur corps et leur genre. Chanez s’est ainsi agacée qu’une amie « avec une forte poitrine » s’entende dire que son crop top faisait « vulgaire ». Éternel chiffon rouge de la police du vêtement, le mythique top au-dessus du nombril a beaucoup fait parler de lui lorsque, en juillet 2021, Emmanuel Macron a invoqué l’exigence d’une « tenue décente » dans un entretien au magazine ELLE.
Une remarque sexiste donnant lieu à un florilège de photos de jeunes femmes nombril à l’air agrémentées d’un #BalanceTonTop sur les réseaux sociaux. Cet épisode entre en résonance avec celui de septembre 2020 où les #BalanceTonBahut et #Lundi14Septembre dénonçaient le sexisme s’en prenant aux tenues des filles dans les établissements scolaires. Ce à quoi Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’Éducation nationale, avait rétorqué qu’il convenait de s’habiller à l’école d’« une façon républicaine ».
Alors qu’un bout de ventre visible semble mettre en émoi le milieu éducatif et les politiques, Amina, elle, ne peut pas porter l’abaya kimono, une tenue pourtant fluide et ample mais jugée trop religieuse par l’institution. Josué, pour sa part, est conscient de ses privilèges : « Moi j’ai le droit de porter un haut transparent, mais mes camarades filles essuient des remarques. J’ai la sensation d’être favorisé, de pouvoir me permettre ce qu’on refuse à d’autres. »
La mode comme outil d’émancipation
« Le corps fait basculer le sens du vêtement. On te prête alors des qualités ou défauts qu’on projette sur ta morphologie, analyse la journaliste de mode Alice Pfeiffer. On assimile un intellect variable et une sexualisation à certaines apparences. Une fille qui a des formes est tout de suite sexualisée. » Chanez confirme : « On me sexualise depuis que j’ai 10 ans, c’est tellement dégoûtant ! C’est comme si on était une proie. T’as la rage, et l’envie de vomir. On ne sait pas comment sortir de ça. »
Maîtriser l’art des convenances permet aussi de s’en affranchir quand on le souhaite. « À la banque, je fais exprès de bien m’habiller, s’amuse Josué. Bien sûr qu’on peut jouer sur l’intention que les gens mettent derrière le vêtement. » Les propos, comme les tenues, sont assumés. La mode comme arme d’émancipation face aux carcans patriarcaux ? Lucie, enseignante de SUD Éducation, observe que les adolescent·es d’aujourd’hui se montrent beaucoup plus tolérant·es et ouvert·es à toutes les tenues, alors les réactionnaires s’affolent et « essaient de légiférer ».
Un constat partagé par la sociologue Virginie Vinel : « Sous l’effet du renouvellement du féminisme, des mouvements LGBTQI+ et de leur diffusion via les réseaux sociaux, la réflexivité des adolescent·es s’accroît et les amène parfois à mettre en question ces restrictions scolaires, et à déconstruire davantage les stéréotypes de genre. » Pour Alice Pfeiffer, les identités queers, notamment, participent beaucoup de cette déconstruction des codes : « Se libérer doit devenir une norme. La fluidité des genres et les vestiaires se rejoignent. On doit avoir le droit d’aller vers tous les paradoxes, sans en juger aucun. » Encore moins, peut-être, ceux d’une jeunesse qui vient « assumer la mode » et bousculer les carcans d’une société accro au jean basique. •
Cet article a été édité par Élise Thiébaut.
(1) L’abaya et le qamis sont des vêtements traditionnels portés dans les pays arabes et du golfe Persique couvrant le corps des épaules jusqu’aux pieds. Dans l’évocation de cette interdiction, on ne retiendra ensuite communément que celle de l’abaya.