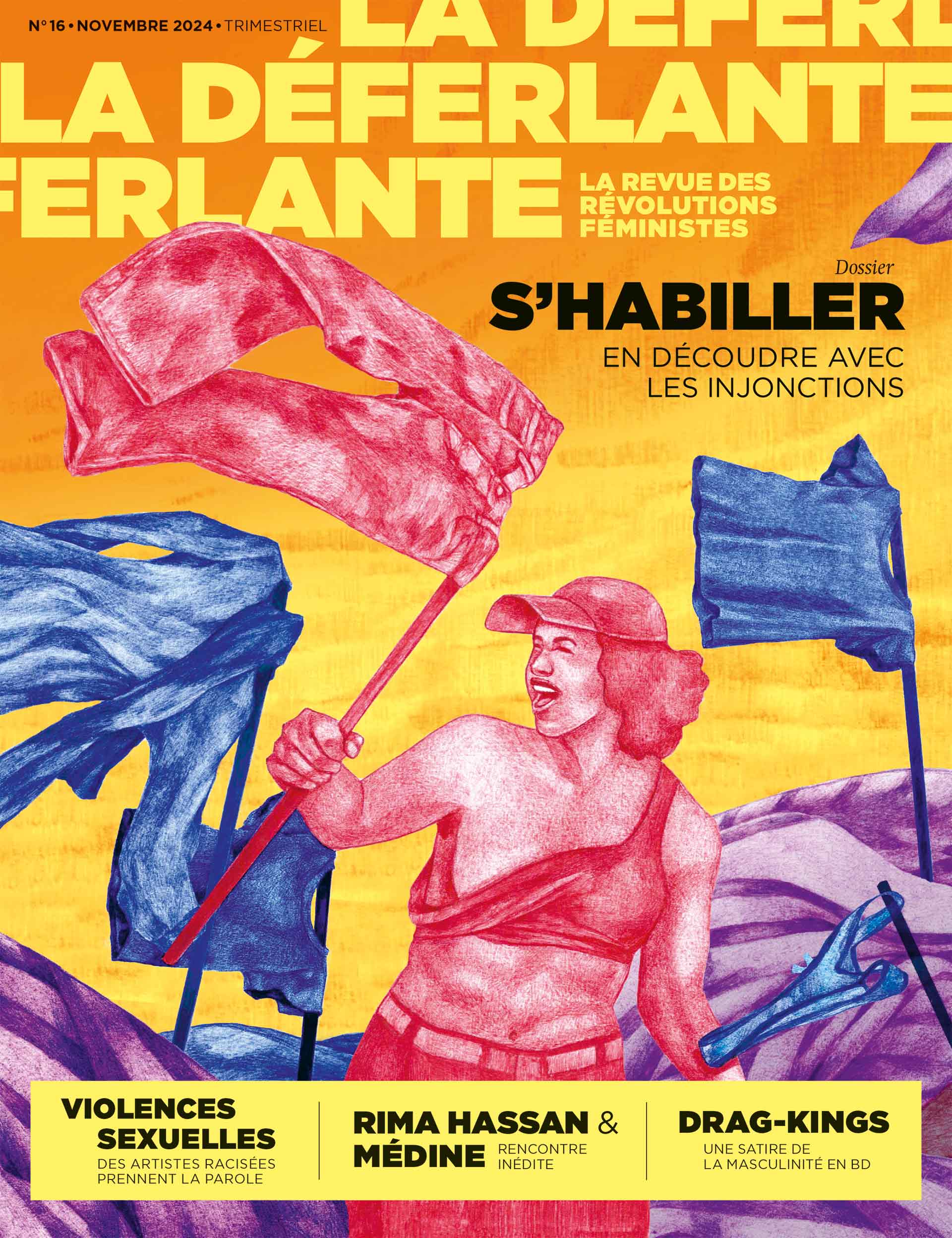Le Premier ministre, Michel Barnier, l’a promis le 22 septembre dernier sur France 2 : il ne reviendra pas sur les droits sociaux acquis tels que la procréation médicalement assistée pour toutes ou l’accès à l’avortement. Mais quelle confiance accorder à ces déclarations, quand son gouvernement a pour têtes d’affiche des ministres proches des milieux réactionnaires catholiques ?
Bruno Retailleau (Intérieur) fait partie des plus fervents soutiens du mouvement de La Manif pour tous (LMPT) – renommée en 2023 Le Syndicat de la famille. Comme d’autres ministres – Catherine Vautrin (Partenariat avec les territoires et Décentralisation de la France), Annie Genevard (Agriculture, Souveraineté alimentaire et Forêt), Patrick Hetzel (Enseignement supérieur et Recherche), François-Noël Buffet (Outre-mer) et Sophie Primas (chargée du Commerce extérieur et des Français de l’étranger) –, il a voté contre la loi Taubira instituant en 2013 le mariage pour toustes, puis, à l’instar d’Othman Nasrou (secrétaire d’État chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations), a longtemps soutenu son abrogation. Comme Laurence Garnier (secrétaire d’État chargée de la Consommation), il a voté en 2022 contre l’interdiction des thérapies de conversion (qui prétendent guérir les personnes homo- ou bisexuelles de leur orientation sexuelle, comme si elles étaient malades), et contre la constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) à l’hiver 2024.
« À part Retailleau, ce sont quand même des seconds couteaux, des résidus de La Manif pour tous, tempère Céline Béraud, sociologue, spécialiste des questions de genre et des religions à l’École des hautes études en sciences sociales. Ils sont allés chercher celles et ceux qui restaient chez Les Républicains, c’est-à-dire des personnes issues de la droite très conservatrice. » Avec seulement 47 député·es du groupe Droite républicaine (ex-Les Républicains) à l’Assemblée nationale, ce gouvernement n’aura selon elle pas la force de frappe suffisante pour « désanctuariser » les droits liés à l’IVG et aux familles LGBT+ : « Leur parti ne représente rien. »
Mais les associations féministes ne se disent pas rassurées pour autant. « Si on ne met ni volonté politique ni moyens financiers, il n’y a pas besoin de toucher aux lois pour restreindre les droits », pointe Véronique Sehier, rapporteure de l’étude « Droits sexuels et reproductifs en Europe », publiée en 2019 par le Conseil économique, social et environnemental.
Le noyautage des associations d’usagers
Surtout, « il ne faut pas sous-estimer les réseaux catholiques », explique Céline Béraud. Car si La Manif pour tous a indéniablement perdu en influence depuis 2013, de nombreuses organisations satellites ont continué à se développer. Parmi celles qui ont « gagné en professionnalisation et en visibilité », la sociologue cite les Associations familiales catholiques (AFC), à l’origine du lobbying exercé sur les sénateur·ices contre l’inscription de l’avortement dans la constitution à l’hiver 2024 ; mais également l’association anti-IVG Alliance Vita, créée par Christine Boutin, dont le délégué général, Tugdual Derville, a été porte-parole de La Manif pour tous en 2013.
« Les Associations familiales catholiques, sous l’égide de l’Union départementale des associations familiales, sont entrées dans un certain nombre de structures comme représentantes des usagers, et c’est ça qui est inquiétant aujourd’hui », commente Véronique Sehier. En mars dernier, elles demandaient la suppression des « très nombreuses références au genre » dans le programme d’éducation affective et sexuelle mis en place en 2001 dans les établissements scolaires, dans le parfait prolongement de leur lutte contre le programme pédagogique « les ABCD de l’égalité » en 2013.
UNE ACCÉLÉRATION DES PANIQUES RÉACTIONNAIRES À L’UNIVERSITÉ
Les questions liées à l’identité de genre sont au cœur de la bataille que livrent « les héritiers de La Manif pour tous », comme les appelle Maud Royer, présidente de l’association féministe Toutes des femmes, et autrice du Lobby transphobe (Textuel, 2024). Dans une chronique publiée dans le numéro 15 de La Déferlante, elle rappelle l’alliance tacite conclue entre « les groupes “antigenre”, proches des droites catholiques » et « les franges les plus réactionnaires de la psychanalyse et de la psychiatrie ». Sociologue des médias, Karine Espineira fait le même constat : dans Transidentités et transitudes. Se défaire des idées reçues (Le Cavalier Bleu, 2024, coécrit avec Maud-Yeuse Thomas), elle explique que « l’ensemble des mouvements “anti” a investi la scène médiatique et “contaminé” progressivement la sphère politique depuis 2011 ». C’est ainsi que, au printemps 2024, une proposition de loi interdisant les transitions de mineur·es, largement inspirée du rapport d’un groupe de pression transphobe (l’Observatoire la Petite Sirène), a été adoptée au Sénat.
« Une resucée de la théorie “antigenre” »
Davantage que la remise en question de droits acquis, Céline Béraud craint aujourd’hui l’accélération des paniques réactionnaires visant en particulier, dans l’enseignement supérieur, les études de genre et les études postcoloniales. « Mon ministre, Patrick Hetzel, est de ceux qui ont fait enfler la polémique sur le “wokisme” à l’université, qui est une sorte de resucée de la “théorie antigenre” » que brandissent les milieux catholiques, arguant que le genre n’est pas une construction sociale. La sociologue s’inquiète également des rapports de force au sein des établissements scolaires. Des personnalités conservatrices comme Alexandre Portier, ministre délégué à la Réussite scolaire et à l’Enseignement professionnel, pourraient y trouver des relais associatifs comme le Syndicat de la famille ou le mouvement SOS Éducation, qui prétend réunir parents et professeurs et qui est proche de l’extrême droite. Ces réseaux pourraient lancer de nouvelles polémiques sur les enfants trans ou l’éducation sexuelle à l’école.
Dans ce contexte inquiétant pour les droits des minorités sexuelles et de genre, la nouvelle secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Salima Saa, déplorait à la fin de septembre que la loi de 2001 prévoyant trois séances annuelles d’éducation à la sexualité à l’école ne soit pas appliquée. Une déclaration surprenante, car totalement à contre-courant des positions affichées par une bonne partie de ses collègues du gouvernement. La secrétaire d’État risque de se retrouver bien seule pour passer à l’action.
→ Retrouvez les recommandations ainsi que l’agenda de la rédaction juste ici.