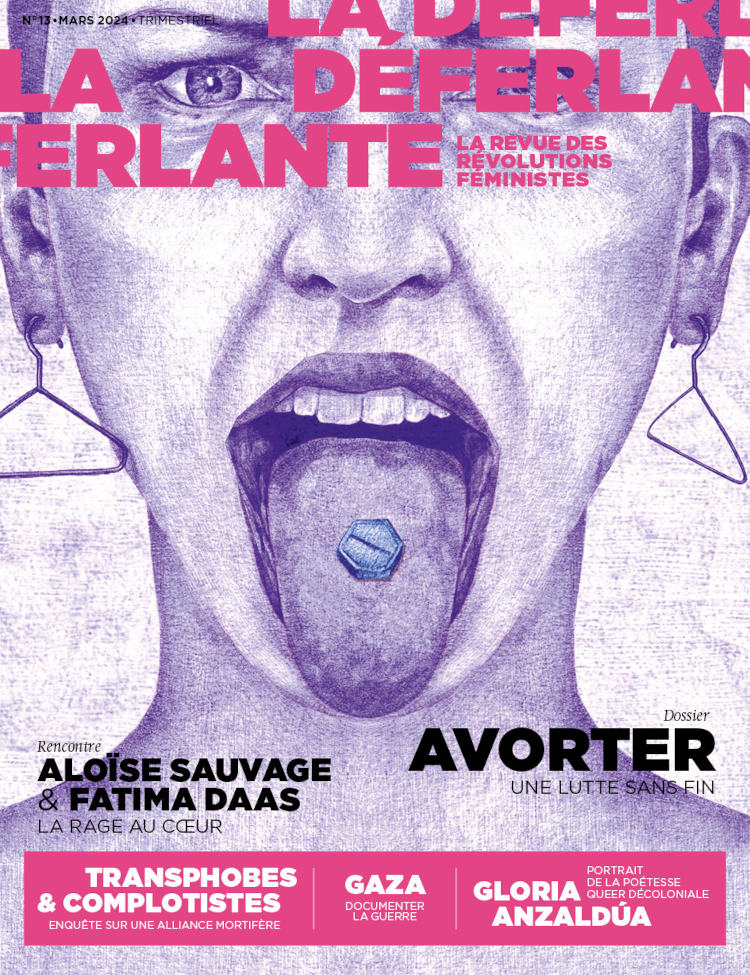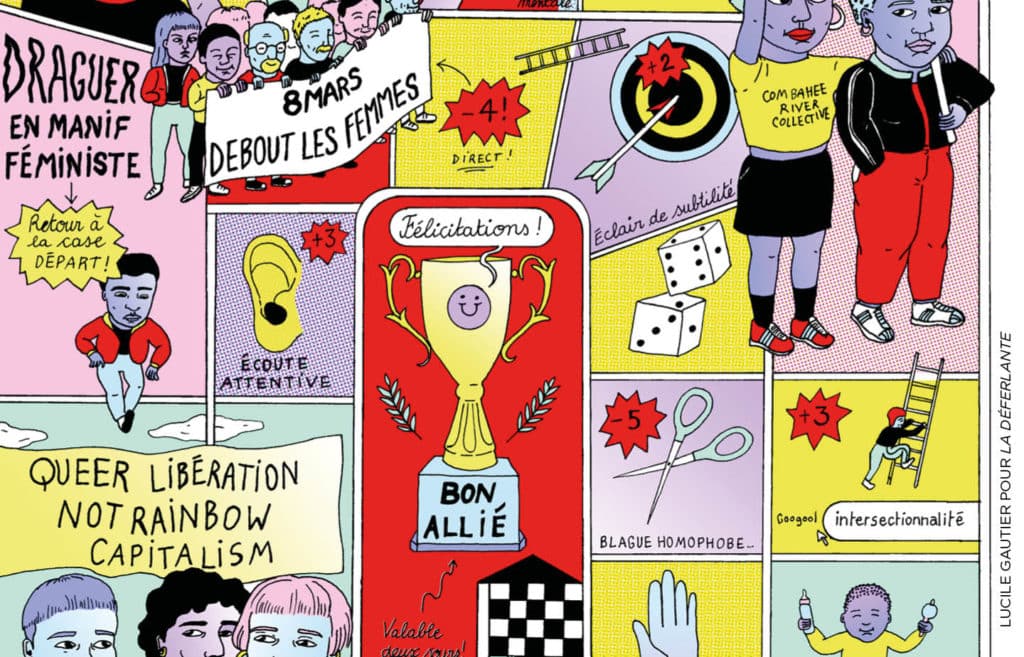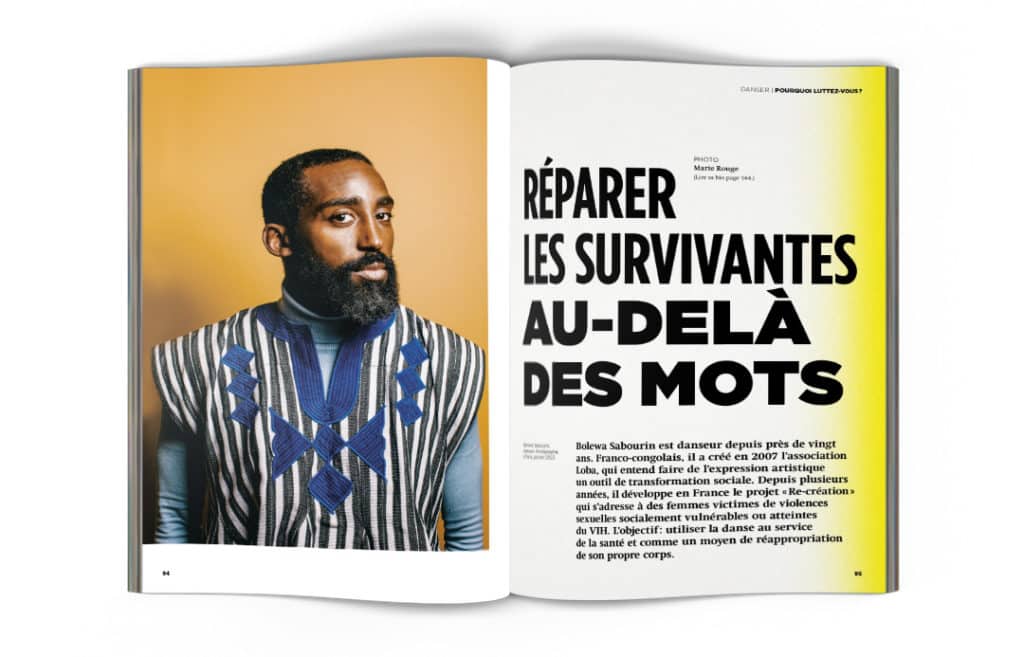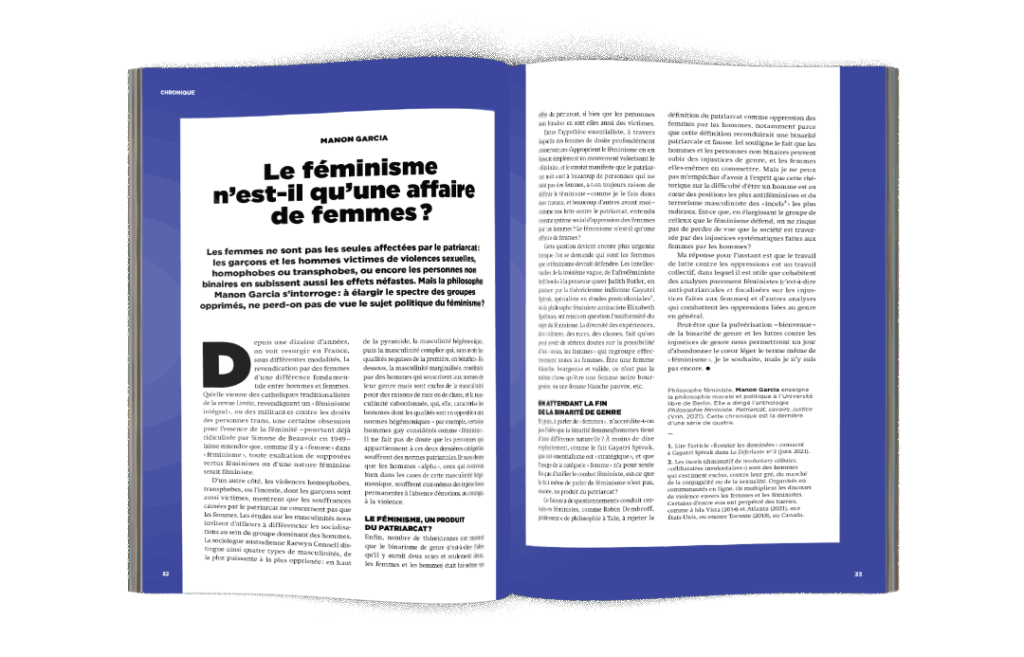« Ils seront furieux. » En acceptant le poste de Première ministre, n’en déplaise aux barons socialistes, Édith Cresson sait à quoi s’attendre (1). En ce mois de mai 1991, c’est la troisième fois qu’elle se rend à l’Élysée pour discuter de sa place dans le gouvernement. Elle a déjà été ministre de l’Environnement, puis ministre du Commerce extérieur et du Tourisme sous Mauroy, du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur sous Fabius, et des Affaires européennes sous Rocard. Elle aurait préféré les Finances, mais elle accepte avec courage cette promotion surprise. Le 16 mai 1991, Libération titre en couverture : « Et Dieu nomma la femme ». « Les premières flèches qu’on lui a décochées n’ont même pas attendu une semaine », se rappelle son ancien conseiller, Jean-Paul Tran Thiet.
François Mitterrand est président depuis dix ans. Il lui reste encore quatre ans à la tête de l’exécutif et il veut donner un nouveau souffle à son second septennat en nommant celle qui a été maire, députée, eurodéputée, conseillère générale et plusieurs fois ministre. Le lendemain de sa nomination, selon un sondage Ifop, 77 % des personnes interrogées sont satisfaites de l’annonce. Raphaëlle Bacqué, qui fait alors ses débuts dans le journalisme politique, se souvient : « Ma mère était enchantée qu’Édith Cresson soit à la tête du gouvernement. Elle était de la génération des féministes qui s’étaient battues pour l’avortement. De ce point de vue, Mitterrand avait bien senti la société. »
Au début des années 1990, la France est en queue de peloton des pays européens concernant la présence des femmes en politique. Margaret Thatcher a accédé au pouvoir dix ans plus tôt au Royaume-Uni. Hormis Indira Gandhi en Inde – nommée Première ministre dès 1966, elle est assassinée en 1984 –, les femmes n’occupent aucun poste politique de premier plan dans le monde. Le président français entend « briser un tabou » et souhaite surtout écarter Michel Rocard, son Premier ministre, trop populaire à son goût auprès des Français·es. Or Édith Cresson, fidèle au leader socialiste depuis les années 1960, est la seule à s’être publiquement désolidarisée de Michel Rocard en quittant son gouvernement un an plus tôt. C’est donc d’abord sur sa loyauté que mise le président.
Propos hypersexualisants au quotidien
Sur le papier, Édith Cresson présente aussi un profil différent : « Elle est familière du monde de l’entreprise, analyse Michelle Perrot, historienne du féminisme. Or, les principales difficultés de Mitterrand venaient de ce domaine. La compétence de Cresson en matière économique était un avantage pour lui. » Au Parti socialiste, on regarde pourtant d’un mauvais œil cette femme jugée trop proche du patronat. Pire, elle est toujours restée à l’écart des débats politiques aux différents congrès du PS et ne bénéficie d’aucun·e allié·e dans sa majorité relative.
La Constitution prévoit que les membres du gouvernement soient désigné·es par le ou la chef·fe de l’État, sur proposition de Matignon. Première déconvenue pour Édith Cresson : à son arrivée, les dés sont déjà jetés. « Le président avait une liste élaborée par Laurent Fabius », raconte-t-elle trente ans plus tard (2). Elle ne parvient à imposer que deux nouvelles personnalités : Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry. La presse y voit clair : L’Humanité parle de Pierre Bérégovoy, ministre des Finances et grand rival d’Édith Cresson comme du « Numéro 1 bis du gouvernement ».
Quelques jours plus tard, le 22 mai, Édith Cresson monte l’escalier la conduisant à la tribune de l’Assemblée nationale où elle doit prononcer sa déclaration de politique générale. Son discours est mal reçu. Dans les commentaires des politiques comme dans les médias, on lui reproche autant sa voix haut perchée que l’aspect technocratique de son discours. À la sortie de l’Hémicycle, le député François d’Aubert parle d’elle comme d’une « madame de Pompadour », du nom de la maîtresse et conseillère de Louis XV. Pour sa première interview télévisée au journal de 20 heures d’Antenne 2, le journaliste Philippe Lefait enfonce le clou : « On vous a comparée à une favorite. » La Première ministre, qui vient de rappeler à l’antenne que les femmes étaient aussi dotées d’un cerveau, ne cache pas son étonnement et répond, non sans humour : « Je suis peut-être la favorite, mais la favorite de mes électeurs. »
« On n’arrêtait pas de sous-entendre qu’elle n’était là que parce qu’elle était la bonne amie de Mitterrand, avec ce préjugé selon lequel les femmes n’ont d’influence ou n’accèdent au pouvoir que par le sexe », se souvient l’historienne Michelle Perrot. Dix ans auparavant, alors que, ministre de l’Agriculture, elle se rendait à une réunion de la FNSEA, elle était déjà accueillie par cette banderole : « Édith on t’espère meilleure au lit qu’au ministère ». Lorsqu’elle devient Première ministre, les propos hypersexualisants deviennent quotidiens. Dans le « Bébête Show », l’ancêtre des « Guignols de l’info », qui réunit chaque soir entre 8 et 13 millions de téléspectateurs sur TF1, Édith Cresson est représentée en panthère lascive aux pieds de François Mitterrand. À son propos, la marionnette du président parle en ces termes : « Je m’ennuie, alors la greluche, je la viole », ou encore : « Toi, tu vas reboucher ton trou et fous-nous la paix ! ».
Pas particulièrement féministe
Si la gauche s’est toujours appuyée sur les valeurs féministes dans sa quête de pouvoir, elle peine à mettre ces mêmes valeurs en œuvre une fois aux affaires. Après sa première élection en 1981, François Mitterrand a donné à Yvette Roudy un ministère des Droits de la femme et l’a positionnée comme « ministre déléguée auprès du Premier ministre ». À cette militante féministe, on doit notamment le remboursement de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), la loi sur l’égalité professionnelle, l’adoption en France du 8 mars comme Journée nationale des droits des femmes ou encore, un peu plus tard, la création d’une commission pour la féminisation des titres et noms de métiers. Mais sa proposition d’un quota de 25 % de femmes aux élections locales est censurée par le Conseil constitutionnel en 1982. « Mitterrand aimait les femmes, mais il aimait les femmes comme un homme aime les femmes à la manière d’autrefois, pas tellement pour les voir au pouvoir », avance Michelle Perrot. « Les années Mitterrand sont un demi-échec, analyse Mariette Sineau, directrice de recherche au Centre de recherches politiques de Sciences Po. Les femmes sont alors les élues du Prince avant d’être les élues de la nation. »
Pas particulièrement féministe, Édith Cresson est reconnue pour sa poigne et son volontarisme. La journaliste et ancienne ministre de Valéry Giscard d’Estaing, Françoise Giroud, dit même dans Libération qu’« elle en a » : des qualités politiques « viriles » qui la démarquent de son prédécesseur Michel Rocard. Le Quotidien de Paris se gausse, Édith Cresson, c’est : « le style vraiment un-peu-popote-pieds-sur-terre. Non plus la langue de bois, mais la langue de veau charcutière. » Elle est combative – une qualité indispensable dans ce contexte – mais incarne également une féminité populaire, illégitime sous les plafonds dorés de la Ve République. Ce qui, selon L’Événement du jeudi, fait d’elle « une personnalité doublement dérangeante ».
C’est au sein de son propre camp que les trahisons sont les plus cruelles. Roland Dumas, son ministre des Affaires étrangères, aurait, par exemple, rapporté à la presse une conversation privée dans laquelle elle comparait les Japonais à des fourmis. Car, durant son mandat, la locataire de Matignon, à plusieurs reprises, tient des propos racistes ou homophobes, notamment en 1991, dans la presse britannique ou à la télévision états-unienne. La même année Jacques Chirac, alors maire de Paris, évoque « le bruit et l’odeur » de populations immigrées dans son discours d’Orléans. La carrière de Cresson pâtit de telles déclarations. Pas celle de Chirac.
Dès janvier 1992, la rumeur du remplacement de la Première ministre est sur toutes les lèvres. En mars, le PS perd successivement les élections régionales et cantonales. Cresson, elle, est réélue de justesse à Châtellerault, mais ça ne suffit pas. Le Monde a raconté les circonstances de cette démission forcée : « Voilà quelques heures qu’elle est à la foire de Hanovre où elle rencontre Helmut Kohl. Le haut-parleur dominant le brouhaha la réclame d’urgence pour un appel téléphonique. À l’autre bout du fil, la conseillère de François Mitterrand, Anne Lauvergeon, lui apprend qu’on s’oriente vers “une solution Bérégovoy” pour la remplacer. Elle remettra sa démission le lendemain (3). »
Elle aura exercé moins de onze mois. Sur Antenne 2, la journaliste Véronique Saint-Olive souligne sa pugnacité : « Édith Cresson se sera battue jusqu’au bout. » Au milieu de la vindicte médiatique de l’époque, la journaliste est une des seules à remarquer les difficultés bien particulières d’exercice de la Première ministre.
Car pendant son mandat, Édith Cresson a dû tenir tête à ceux et celles qui la contredisaient dans sa propre équipe, notamment sur les dossiers liés à l’éducation qui concernaient l’apprentissage et l’alternance – ses chevaux de bataille durant des années. « Quand elle a lancé ce projet, l’Éducation nationale s’y est opposée, relate Jean-Paul Tran Thiet. Pour le corps enseignant, cela signifiait confier les élèves à des patrons sans foi ni loi pour les exploiter. Un certain nombre de très hauts responsables dans les milieux politiques de l’époque disaient à Édith Cresson : “Pourquoi tu vas enquiquiner des gens qui votent pour nous ?” » Elle avait pourtant le nez creux : trente ans plus tard, en 2022, plus de 830 000 contrats d’alternance étaient lancés.
La Première ministre n’a jamais trouvé de soutien au sein de son gouvernement et encore moins à l’Assemblée, où la proportion de femmes ne dépasse alors pas les 6 %. « Son mandat aurait sûrement été beaucoup moins violent avec plus de parité, analyse Françoise Gaspard. Les députés se permettaient tout et usaient de tous les noms. » En réalité, en dehors d’Yvette Roudy, peu de féministes soutiennent Édith Cresson à l’époque. « Elle m’appelait, on se parlait en tête à tête, se rappelle cette dernière. Elle me disait : “C’est dégueulasse ce que l’on vous fait”, et elle protestait extérieurement aussi », raconte-t-elle dans le podcast Y’a pas mort d’homme.
La bataille de la parité
Édith Cresson est encore au gouvernement lorsque Françoise Gaspard, sociologue, Claude Servan-Schreiber, journaliste, et Anne Le Gall, militante, publient un ouvrage manifeste pour la parité en politique : Au pouvoir, citoyennes : liberté, égalité, parité (Seuil, 1992) qui sera suivi le 13 novembre 1993 par un Manifeste des 577 pour une démocratie paritaire dans les colonnes du Monde. En 1993, l’Assemblée nationale compte moins de femmes qu’en 1945. Mais, comme le raconte un échange retranscrit dans Marie-Claire un an plus tard, François Mitterrand s’oppose à l’idée de parité : « Ne découpez pas la démocratie en tranches, l’une pour les hommes, l’autre pour les femmes, l’une pour les bruns, l’autre pour les blonds [sic]. » Impossible, en raison de ce refus présidentiel, de « court-circuiter le machisme des partis pour féminiser les investitures », déplore la politiste Mariette Sineau.
« Toute femme qui s’expose risque d’être traitée de pute. Toute femme visible est jugée sur son apparence et étiquetée mère, bonne copine, lesbienne, putain. Ça suffit. »
Manifeste des Chiennes de garde, mars 1999
Ce n’est qu’après son départ du gouvernement qu’Édith Cresson s’engage pleinement dans le combat pour la parité de genre en politique. En 1993, aux côtés de Simone Veil, elle signe la charte d’Athènes, un texte qui déclare : « Parce que les femmes représentent plus de la moitié de la population, la démocratie impose la parité dans la représentation et l’administration des nations. » En 1996, elle fait partie des dix femmes signataires d’un manifeste transpartisan dans L’Express. Tant à gauche qu’à droite, l’idée d’une égale représentation des femmes et des hommes dans les assemblées politiques s’impose et une sororité de coulisses se met en place. Seule ministre femme du gouvernement Alain Juppé – on parle alors de « Juppette » – maintenue à son ministère en 1996, Corinne Lepage se souvient de déjeuners mensuels avec des femmes de gauche et de centre droit dont faisaient partie Simone Veil et Édith Cresson. « C’était un groupe d’entraide informel. Même lorsque j’avais beaucoup de travail au ministère, je m’arrangeais toujours pour être présente. »
Le principe de la parité est la première entaille faite à l’universalisme français. Gisèle Halimi le souligne à l’époque dans les colonnes du Monde : « S’il consiste, de façon abstraite, à ignorer la différence sexuelle, c’est-à-dire l’essentielle mixité du genre humain, alors il faut faire la critique philosophique et politique de l’universalisme et montrer que, toutes les fois qu’on efface la différence sexuelle, on identifie en réalité le genre humain à un seul sexe, celui de l’homme. » Devenu Premier ministre en 1997 d’un gouvernement de cohabitation sous Jacques Chirac, Lionel Jospin fait finalement voter en 2000 la loi « favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».
Entre cohabitation et gauche plurielle, on est alors en plein malaise démocratique, et la parité apparaît comme un instrument indispensable au renouvellement de la classe politique et de ses pratiques. Comme s’en amuse Christine Guionnet, maîtresse de conférences à l’université de Rennes, dans la revue Politix en 2002, « les femmes sont censées adopter une approche spécifique de la politique : un plus grand pragmatisme, un rapport moins ambitieux, moins carriériste à la politique, une volonté d’être plus efficaces dans leur rapport au temps, une plus grande faculté à entretenir des relations de proximité… » Un pragmatisme dont Édith Cresson s’est toujours revendiquée dans son action, à défaut d’avoir une vision proprement féministe. Elle prétend ne jamais s’être imaginé un destin, contrairement à ses adversaires de l’époque – Rocard, Fabius, Bérégovoy – et affirme ne pas avoir fantasmé sur les ors de la République comme elle l’expliquait au micro du podcast Vieille Branche en 2019 : « Les femmes veulent des résultats, elles sont moins sensibles aux signes extérieurs du pouvoir. Pour les hommes, ce qui compte énormément, ce sont les tapis rouges, les plafonds dorés, les voitures qui font pin-pon. »
Des amendes plutôt que des femmes en tête de liste
En mars 1999, une autre femme politique, la ministre de l’Environnement Dominique Voynet est accueillie au Salon de l’agriculture par des insultes sexistes : « Enlève ton slip, salope ! » Plusieurs femmes issues du monde médiatique, intellectuel et politique (dont l’historienne Florence Montreynaud et l’autrice Isabelle Alonso) forment alors l’association des Chiennes de garde. Un nom volontairement outrancier proposé par Florence Montreynaud pour dénoncer les insultes sexistes dans l’espace public, dix-sept ans après l’échec de la loi anti-sexisme proposée par Yvette Roudy. Dans Libération, une centaine de personnes signent leur manifeste : « Toute femme qui s’expose risque d’être traitée de pute. Toute femme visible est jugée sur son apparence et étiquetée mère, bonne copine, lesbienne, putain. Ça suffit. »
À la suite de cet épisode, plusieurs anciennes ministres en poste en 1991 font leur mea culpa par voie de presse, dans Le Monde du 12 février 2000. Élisabeth Guigou reconnaît : « J’étais ministre du gouvernement d’Édith Cresson et je n’ai pas réagi. Des années après, j’ai honte de mon inaction. » Roselyne Bachelot, elle aussi, fait part de ses remords, reconnaissant pourtant que « la solidarité s’imposait ».
Encore aujourd’hui, à l’instar du parti Les Républicains, qui écope en 2018 d’une pénalité de 1,7 million d’euros, les partis politiques traditionnels de la Ve République préfèrent payer des amendes monumentales plutôt que de placer des femmes en tête de liste. Quant à la possibilité de briguer l’Élysée, rien de plus dur quand on est une femme : « L’imaginaire viril qui s’attache à la politique en France prend appui sur les institutions, analyse Mariette Sineau, coautrice de Femmes et République (4). Le président de la République concentre l’essentiel des pouvoirs et cela induit l’idée d’une incarnation masculine de la politique, a fortiori lorsque la fonction est occupée par de Gaulle, à l’origine de ce modèle, qui incarne la figure de l’homme providentiel. Ce régime, qui n’est ni parlementaire ni présidentiel, mais de type “présidentialiste”, est dur pour les femmes. »
Il faudra attendre l’élection d’Emmanuel Macron pour voir l’arrivée massive de femmes dans la chambre basse avec 38,8 % d’élues. Et 2022 pour qu’une femme, Élisabeth Borne, dirige à nouveau un gouvernement. En comparaison avec Édith Cresson, la Première ministre a subi relativement peu d’attaques sexistes pendant son mandat de juillet 2022 à janvier 2024. Le mouvement #MeToo politique aurait-il fait effet ? Trente ans après son passage à Matignon, Édith Cresson confesse malgré tout un regret dans les rares interviews qu’elle donne, telle celle accordée à Binge Audio en 2021 (5) : « Yvette Roudy me disait que j’avais tort, qu’il fallait se battre sur ces questions. Et aujourd’hui, je reconnais qu’elle avait raison. » •
Édith Cresson, l’industrieuse
Fraîchement diplômée de HEC pour filles, Édith Cresson rencontre François Mitterrand dans les années 1960. Elle le suit de la Convention des institutions républicaines (CIR) jusqu’au Parti socialiste où elle devient secrétaire nationale chargée de la jeunesse et des étudiants.
En 1977, parachutée, elle est élue maire de Thuré, dans la Vienne, avant de prendre la mairie de Châtellerault six ans plus tard. En 1979, elle rejoint le Parlement européen avec la première élection des eurodéputés au suffrage universel direct.
Elle intègre la commission de l’agriculture.
Après l’élection de François Mitterrand en 1981, Édith Cresson se voit confier le ministère de l’Agriculture, avant de prendre les commandes du Commerce extérieur et d’être nommée au Renouvellement industriel. Conserver les fleurons de l’industrie dans l’Hexagone sera son plus grand défi. Elle est ensuite nommée aux Affaires européennes avant de claquer la porte suite à un désaccord avec Michel Rocard en 1990.
Après sa démission, en 1992, elle poursuivra son action en faveur des écoles de la deuxième chance.
(1) Édith Cresson a raconté cet épisode dans de nombreuses interviews. Lire notamment l’article sur francetvinfo.fr du 15 mai 2021 : « Une femme à Matignon ? “Le pays est prêt mais la classe politique non” ».
(2) Y’a pas mort d’homme, épisode 1, série documentaire écrite par Hélène Goutany et Fiona Texeire pour Programme B, Binge Audio, 2021.
(3) « Édith Cresson, la chute d’une pionnière », Le Monde, 20 août 2021.
(4) Femmes et République, essai collectif dirigé par Michelle Perrot, La Documentation française, 2021.
(5) Voir la note no 2.