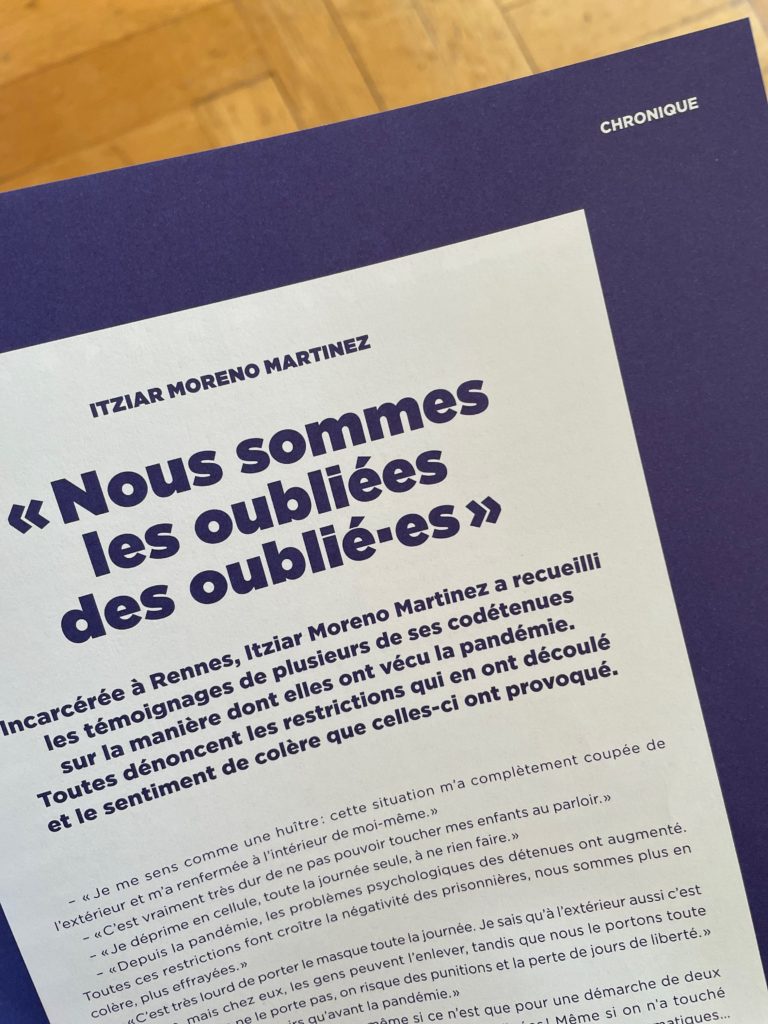Depuis une dizaine d’années, on voit resurgir en France, sous différentes modalités, la revendication par des femmes d’une différence fondamentale entre hommes et femmes.
Qu’elle vienne des catholiques traditionalistes de la revue Limite, revendiquant un « féminisme intégral », ou des militant·es contre les droits des personnes trans, une certaine obsession pour l’essence de la féminité – pourtant déjà ridiculisée par Simone de Beauvoir en 1949 – laisse entendre que, comme il y a « femme » dans « féminisme », toute exaltation de supposées vertus féminines ou d’une nature féminine serait féministe.
D’un autre côté, les violences homophobes, transphobes, ou l’inceste, dont les garçons sont aussi victimes, montrent que les souffrances causées par le patriarcat ne concernent pas que les femmes. Les études sur les masculinités nous invitent d’ailleurs à différencier les socialisations au sein du groupe dominant des hommes. La sociologue australienne Raewyn Connell distingue ainsi quatre types de masculinités, de la plus puissante à la plus opprimée : en haut de la pyramide, la masculinité hégémonique, puis la masculinité complice qui, sans avoir les qualités requises de la première, en bénéficie. En dessous, la masculinité marginalisée, constituée par des hommes qui souscrivent aux normes de leur genre mais sont exclus de la masculinité pour des raisons de race ou de classe, et la masculinité subordonnée, qui, elle, caractérise les hommes dont les qualités sont en opposition aux normes hégémoniques – par exemple, certains hommes gay considérés comme « féminins ». Il ne fait pas de doute que les personnes qui appartiennent à ces deux dernières catégories souffrent des normes patriarcales. Et sans doute que les hommes « alpha », ceux qui rentrent bien dans les cases de cette masculinité hégémonique, souffrent eux-mêmes des injonctions permanentes à l’absence d’émotions, au courage, à la violence.
Le féminisme, un produit du patriarcat ?
Enfin, nombre de théoriciennes ont montré que le binarisme de genre (c’est-à-dire l’idée qu’il y aurait deux sexes et seulement deux, les femmes et les hommes) était lui-même un effet du patriarcat, si bien que les personnes non binaires en sont elles aussi des victimes.
Entre l’hypothèse essentialiste, à travers laquelle des femmes de droite profondément conservatrices s’approprient le féminisme en en faisant simplement un mouvement valorisant le « féminin », et le constat manifeste que le patriarcat nuit aussi à beaucoup de personnes qui ne sont pas des femmes, a‑t-on toujours raison de définir le féminisme – comme je le fais dans mes travaux, et beaucoup d’autres avant moi – comme une lutte contre le patriarcat, entendu comme système social d’oppression des femmes par les hommes ? Le féminisme n’est-il qu’une affaire de femmes ?
Cette question devient encore plus urgente lorsque l’on se demande qui sont les femmes que le féminisme devrait défendre. Les intellectuelles de la troisième vague, de l’afroféministe bell hooks à la penseuse queer Judith Butler, en passant par la théoricienne indienne Gayatri Spivak, spécialiste en études postcoloniales (1), ou la philosophe féministe antiraciste Elizabeth Spelman, ont remis en question l’uniformité du sujet du féminisme. La diversité des expériences, des cultures, des races, des classes, fait qu’on peut avoir de sérieux doutes sur la possibilité d’un « nous, les femmes » qui regroupe effectivement toutes les femmes. Être une femme blanche, bourgeoise et valide, ce n’est pas la même chose qu’être une femme noire bourgeoise, ou une femme blanche pauvre, etc.
En attendant la fin de la binarité de genre
Et puis, à parler de « femmes », n’accrédite-t-on pas l’idée que la binarité femmes/hommes tient d’une différence naturelle ? À moins de dire explicitement, comme le fait Gayatri Spivak, que cet essentialisme est « stratégique », et que l’usage de la catégorie « femme » n’a pour seule fin que d’unifier le combat féministe, est-ce que le fait même de parler de féminisme n’est pas, encore, un produit du patriarcat ?
Ce faisceau de questionnements conduit certain·es féministes, comme Robin Dembroff, professeur·e de philosophie à Yale, à rejeter la définition du patriarcat comme oppression des femmes par les hommes, notamment parce que cette définition reconduirait une binarité patriarcale et fausse. Iel souligne le fait que les hommes et les personnes non binaires peuvent subir des injustices de genre, et les femmes elles-mêmes en commettre. Mais je ne peux pas m’empêcher d’avoir à l’esprit que cette rhétorique sur la difficulté d’être un homme est au cœur des positions les plus antiféministes et du terrorisme masculiniste des « incels (2) » les plus radicaux. Est-ce que, en élargissant le groupe de celleux que le féminisme défend, on ne risque pas de perdre de vue que la société est traversée par des injustices systématiques faites aux femmes par les hommes ?
Ma réponse pour l’instant est que le travail de lutte contre les oppressions est un travail collectif, dans lequel il est utile que cohabitent des analyses purement féministes (c’est-à-dire anti-patriarcales et focalisées sur les injustices faites aux femmes) et d’autres analyses qui combattent les oppressions liées au genre en général.
Peut-être que la pulvérisation – bienvenue – de la binarité de genre et les luttes contre les injustices de genre nous permettront un jour d’abandonner le cœur léger le terme même de « féminisme ». Je le souhaite, mais je n’y suis pas encore.

(1) Lire l’article « Écouter les dominées » consacré à Gayatri Spivak dans La Déferlante n°2 (juin 2021).
(2) Les incels (diminutif de involuntary celibates, « célibataires involontaires ») sont des hommes qui s’estiment exclus, contre leur gré, du marché de la conjugalité ou de la sexualité. Organisés en communautés en ligne, ils multiplient les discours de violence envers les femmes et les féministes. Certains d’entre eux ont perpétré des tueries, comme à Isla Vista (2014) et Atlanta (2021), aux États-Unis, ou encore Toronto (2018), au Canada.