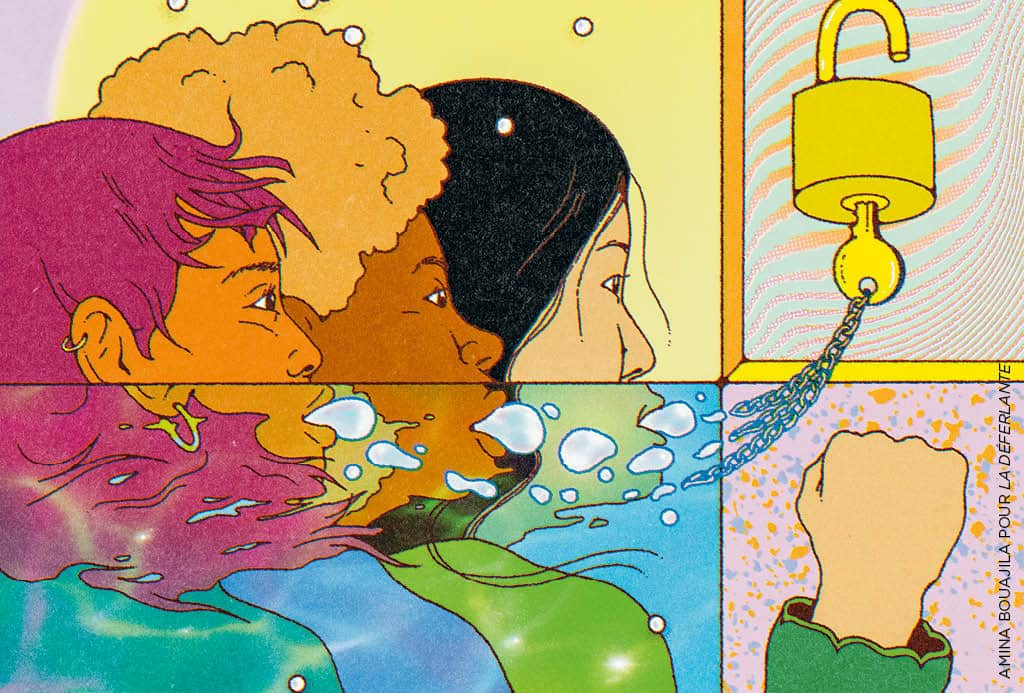Comment êtes-vous devenue féministe ? Plus précisément : comment êtes-vous devenue une humoriste féministe ?
Je pense que le féminisme m’est toujours apparu comme une évidence. Ma mère était une femme puissante et très franche. À sa façon, elle déconstruisait le patriarcat, même dans notre petite ville de Tasmanie : elle dénonçait la connerie quand elle la voyait. Moi, plus jeune, j’étais moins directe qu’elle. J’ai pris mon temps, j’ai essayé de comprendre le monde, mais il n’a aucun sens si on n’est pas misogyne… On n’a pas d’autre choix que d’être féministe.
Le féminisme a toujours été présent dans mes spectacles parce que mon travail a toujours été autobiographique. Et puis, raconter des histoires sur une scène de stand-up est un acte féministe, surtout quand j’ai commencé, dans les années 2000. À l’époque, je me suis mise à dire tout haut ce qui se chuchotait. Pour survivre en tant qu’humoriste, il faut à la fois renouveler le genre du stand-up et continuer à utiliser les méthodes qui marchent. Tout cela pour faire rire une salle pleine de gens. Et si cette salle vient de rire devant un type qui raconte des blagues sur le viol, eh bien tu as du pain sur la planche ! Je me demande, en vieillissant, si quand on n’a pas encore percé on se sent plus libre de dire les choses telles qu’elles sont. Peut-être que j’y serais moins encline maintenant que j’ai réussi… Non… je ne pense pas !
En France, un certain nombre de voix réactionnaires considèrent que les féministes « cassent l’ambiance » – vous entendez sans doute ça partout où vous allez – et se plaignent que l’on ne peut plus rire de rien… Comment leur répondez-vous ?
Je pense qu’on peut rire de tout. Mais également que c’est drôle de faire remarquer aux réactionnaires qu’ils sont nuls de rire de certains sujets. Ce n’est pas moi qui casse l’ambiance, ils peuvent s’amuser tant qu’ils veulent. Mais en réalité, ce qui leur pose problème, c’est qu’on leur dise que l’humour peut être destructeur.
Faire des blagues n’est pas sans conséquence. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Et je ne pense pas que la fin justifie les moyens. Si la seule raison pour laquelle on dit quelque chose, c’est d’en tirer un rire, c’est qu’on n’a rien à dire. Alors pourquoi prendre la parole ?
Grâce à l’avènement des technologies de l’information et la multiplication des plateformes, on entend davantage de voix. Si on veut juste rire de tout et n’importe quoi, il suffit de se connecter ! Il y a tout ce qu’il faut sur Internet pour rire bêtement. Nous n’avons plus besoin de comédiens ou de comédiennes qui disent des trucs stupides sur scène : c’est déjà enregistré et c’est là pour toujours, même plus besoin de sortir de chez soi ! S’il faut trouver un coupable à l’évolution de la scène humoristique, alors ce sont les réseaux sociaux. En fait, ce ne sont pas les lesbiennes qui tuent l’humour : c’est Facebook et Mark Zuckerberg.
Dans vos spectacles, la notion de pouvoir est centrale. En tant que femme féministe, lesbienne et autiste, quels pouvoirs souhaitez-vous démanteler ?
Quand j’étais plus jeune, je voulais m’attaquer aux pouvoirs hétéronormatifs et patriarcaux. Mais je pense que plus je vieillis, plus je deviens nuancée. Pour déconstruire véritablement la société, il faut reconnaître le privilège que confère la peau blanche. Pour être honnête, c’est probablement là que j’ai le plus de travail, parce que c’est là que se trouve mon plus grand pouvoir. Le problème, c’est qu’il est très difficile pour une personne blanche de parler de race quand il y a tant d’autres voix plus qualifiées pour le faire. Les grandes absentes sont les expériences minoritaires. Pour moi, femme blanche, parler du racisme reviendrait à brasser du vent. En revanche, il y a du pain sur la planche en dehors de la scène pour faire de la place à d’autres voix créatrices, et contribuer ainsi à une culture inclusive.
À vrai dire, j’ai déjà assez à faire en tant qu’autiste. Si je n’étais pas autiste, je ne serais qu’une femme blanche de plus, une Karen¹ qui pète un plomb. Nous vivons dans un monde où les personnes neurotypiques – les gens qui, entre autres, ne présentent pas de trouble du spectre de l’autisme – pensent qu’ils comprennent ce qu’est l’expérience autistique et tiennent à parler en notre nom. Nous n’avons pas souvent l’occasion de parler pour nous-mêmes dans la culture populaire – surtout en tant que femmes. J’ai donc l’impression que, dans cet espace de la scène, j’ai quelque chose à apporter. J’essaie de contrecarrer l’idée selon laquelle les autistes doivent être des savants ou des génies de la Silicon Valley pour justifier leur existence. C’est une conception tellement étroite de ce qu’est l’expérience autistique : très peu de personnes autistes ont des capacités exceptionnelles, mais c’est la majorité de celles qu’on voit. Le chemin est encore long, alors j’aimerais abattre quelques murs tant que ma visibilité le permet.
L’autisme est un élément important dans votre dernier spectacle, Douglas (2019). Qu’un diagnostic ait répondu à vos interrogations éclaire d’un jour nouveau votre récit. Comment cela irrigue-t-il votre travail ?
Comprendre le monde, c’est mon combat depuis toujours, surtout quand je n’étais pas diagnostiquée. Depuis que je sais que je présente un trouble du spectre autistique, je suis moins un casse-tête pour moi-même, mais ce monde reste toujours un casse-tête pour moi… J’ai toujours les mêmes difficultés, mais le fait de les comprendre me permet beaucoup plus facilement d’apprécier qui je suis. L’anxiété de soi, ce fardeau-là, a été quelque peu levée et j’ai l’impression de pouvoir être plus légère à ce sujet.
Du coup, j’apprends à donner un sens au monde. Je vois beaucoup de détails qui échappent aux autres. Dans mon travail, j’ai l’impression que ne pas me cantonner à raconter mon expérience de personne autiste, mais présenter aussi ma façon de voir le monde, c’est enrichissant, non pas pour moi, mais pour toutes les personnes qui n’ont pas ce prisme. De la même manière que j’ai pu utiliser des points de vue neurotypiques pour façonner ma compréhension du monde.
Il y a ce présupposé arrogant que tous nos esprits fonctionnent de la même manière, que nous percevons tous et toutes le monde pareillement. Pourtant beaucoup de conflits interpersonnels pourraient s’apaiser, si chacun·e commençait à réfléchir à sa manière de penser le monde. Mon autisme est présent à tous les niveaux de mon travail, il détermine comment le monde passe à travers moi.
Vous semblez très consciente de votre pouvoir lorsque vous êtes seule sur scène. Dans vos deux derniers spectacles, vous donnez régulièrement au public vos ficelles pour faire rire. Peut-on envisager cette démarche comme la conséquence logique d’un processus de déconstruction féministe ?
La comédie, ça peut être juste des ficelles qu’on tire ; c’est possible et c’est facile à faire : « Je vais vous raconter des blagues ! Je vais vous dire quand rire ! » Mais je traite mon public avec respect et je pense que le stand-up est une expérience très riche. Si je devais définir ma démarche, je dirais qu’il s’agit d’une recherche de « consentement enthousiaste ». Pour utiliser la métaphore du sexe : vous pouvez avoir un super rapport sexuel tout en vous assurant continuellement du consentement de votre partenaire. De la même manière, je pense que le public peut rester dans l’instant, même si mon spectacle est construit comme une conversation avec lui et non comme un monologue.
Parfois, je donne l’impression de faire la morale… Mais en fait, j’entretiens une conversation avec mon public. Je parle et je ressens son énergie, une réponse qui se dégage. Mon spectacle Nanette est un excellent exemple de cela : j’ai sous-estimé la capacité du public à se faire sa propre opinion. Quand je l’ai écrit, j’ai essayé de repousser le public, de me l’aliéner. [Dans ce spectacle, Hannah Gadsby enchaîne des blagues et fait monter la tension, jusqu’à une révélation finale bouleversante qui éclaire son récit d’une manière inattendue.] Alors bien sûr, l’assistance a ressenti tout ce que je voulais qu’elle ressente : je savais ce que je faisais. Mais ce que je n’avais pas prévu, c’est que le public ne me laisserait pas le repousser. Et ç’a été une véritable prise de conscience pour moi : le public n’est pas passif, contrairement à ce qu’on nous fait croire. Le reconnaître, c’est un moyen de s’assurer qu’on n’abuse pas de notre pouvoir sur scène.
L’impact émotionnel de ce que j’ai entre les mains, les coups que j’envoie, cela implique que les spectateurs et les spectatrices donnent de leur personne. C’est ce dont je parle quand je dis que le public n’est pas passif. C’est une leçon d’humilité… Avoir été capable de faire, comme ça, état de ma douleur, et que les gens y trouvent une forme de catharsis, cela donne espoir.
Dans Nanette, vous expliquez que vous refusez de répandre la colère. Peut-on être féministe sans être en colère ?
Je pense que la colère est intrinsèque au féminisme. Si vous n’êtes pas en colère dans ce monde, c’est que vous vous y prenez mal. Il y a tellement de raisons d’être en colère. Mais la colère n’est pas constructive en soi. Ce n’est pas une fin, c’est un début… Il faut apprendre à la maîtriser, surtout lorsqu’on vieillit. Je n’aime pas les personnes âgées en colère, je pense que, à leur âge, c’est quelque chose qu’elles devraient avoir réglé, dans une certaine mesure…
Moi, j’ai un problème de tonalité à cause de l’autisme. Quand je suis excitée, je peux donner l’impression d’être un peu plus… intense que je ne le voudrais. En plus, mon visage fait souvent le contraire de ce que je veux dire, donc parfois on peut penser que je suis en colère.
Cela étant dit, la colère est bien là dans Douglas. J’ai choisi de l’exprimer parce que je pense qu’il est important de la reconnaître, comme une catharsis publique. Mais c’est beaucoup plus ludique que dans Nanette. C’est de la colère canalisée. J’allume un feu en chacun des spectateurs, en chacune des spectatrices, mais je ne les enflamme pas. J’exprime ma colère, mais je ne répands pas de haine.
Dans Nanette, vous déclarez : « Je ne voudrais pas être un homme blanc hétéro, même si on me payait. Le salaire serait pourtant nettement meilleur. » Est-ce que rire des hommes est une forme de conquête du pouvoir ?
Il ne s’agit pas de conquérir le pouvoir, mais peut-être d’essayer de dégonfler certains ego démesurés. Beaucoup d’hommes n’ont jamais eu à regarder en face leurs comportements et c’est donc quelque chose de difficile qu’on leur demande de faire. Ça peut les mettre en colère – c’est compréhensible, même si ce n’est pas pardonnable… Enfin si, parce qu’on n’a pas le choix !
Quand j’ai écrit Nanette, j’étais vraiment excédée, je voyais tellement de choses aller mal autour de moi. À l’époque, [l’acteur américain] James Franco prétendait être féministe. C’est le même homme qui, en 2014, a proposé des relations sexuelles à une adolescente via Instagram et défiguré le travail de [la photographe états-unienne] Cindy Sherman²… Tant d’arrogance, ça m’a vraiment énervée !
Pouvez-vous nous parler de Body of Work, votre nouveau spectacle, qui se joue cet hiver à Paris³ ?
Cette fois, je vais raconter des histoires, comme je le faisais à mes débuts. Nanette et Douglas étaient davantage structurés par des blagues que par une histoire. Mais avec ce nouveau spectacle, je reviens à la narration.
J’aime écrire des textes longs, tisser des histoires ensemble. Je choisis d’abord une forme, un thème et je me demande ce que je veux apporter au monde. Donc, pour dire les choses simplement, Nanette était un coup de poing dans le ventre ; avec Douglas je voulais accéder au cerveau des gens et juste faire comme ça… (elle tourne la main comme si elle fourrageait vigoureusement). Mais ce nouveau spectacle, c’est un câlin.
Je pense que nous vivons un traumatisme en ce moment, lié au stress post-pandémique. Donc ce que je veux faire, c’est aller dans chaque foyer et permettre une catharsis en offrant une pause. Pour ce spectacle-ci, je sens qu’il y a une tranquillité et une gentillesse que j’ai hâte de partager avec le monde. •
Entretien réalisé en visioconférence en juillet 2021 et traduit par Alix Bayle, journaliste indépendante.
1. Le prénom Karen, très populaire aux États-Unis dans les années 1960, est porté par de nombreuses américaines aujourd’hui quinquagénaires. Il est devenu, selon le New York Times, « synonyme d’un type de femme blanche envahissante et hargneuse […] si sûre de son statut dans la société qu’elle n’hésite pas à faire appel aux autorités – en demandant à parler au gérant ou en appelant la police – pour les transgressions les plus insignifiantes et souvent totalement imaginaires ». Il est régulièrement l’objet
de mèmes sur les réseaux sociaux.
2. En 2014, dans une exposition photographique, James Franco revisite la série pionnière en noir et blanc de Cindy Sherman : Untitled Film Skills (1977–1980). Il pose lui-même, déguisé en femme, et reprend les mises en scène de la photographe. Très mal reçue par la critique, l’exposition est jugée cynique et narcissique. En 2018, l’acteur s’est rendu à la cérémonie des Golden Globes arborant un pin’s de soutien à la cause des femmes. Il a par la suite été accusé de harcèlement et d’agression sexuelle par plusieurs femmes. Son attitude a été dénoncée à la Marche des femmes de Los Angeles, la même année, notamment par l’actrice Scarlett Johansson.
3. Au Trianon le 29 janvier 2022.