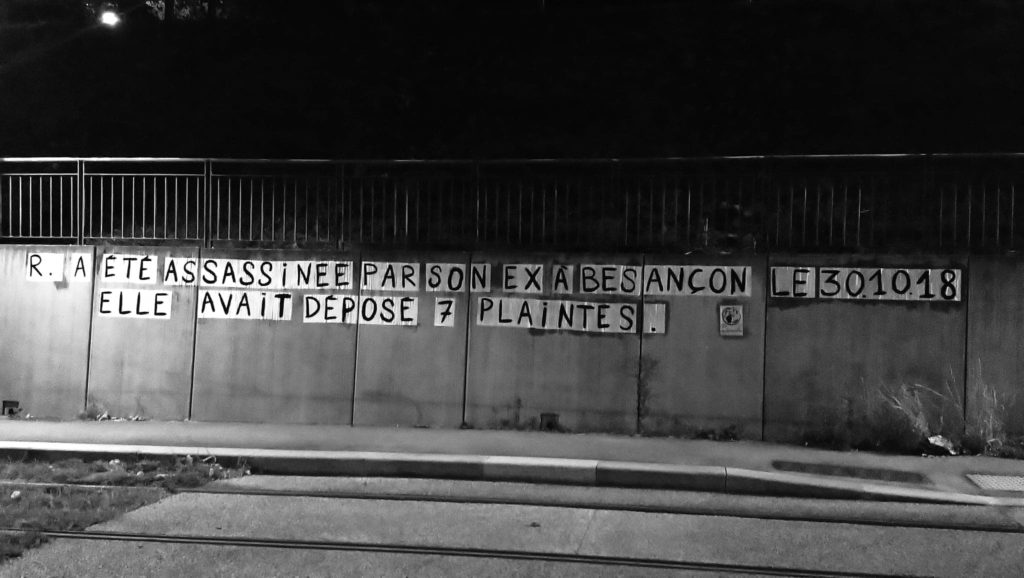On parle traditionnellement de l’affaire Cantat, mais il serait plus juste de parler « des » affaires Cantat. Car l’histoire, telle qu’on peut la raconter aujourd’hui, se déroule en deux temps.
Il y a la mort de Marie Trintignant sous les coups de Bertrand Cantat en 2003, qui produit la sidération de l’opinion publique, et un traitement médiatique plus appliqué à défendre la réputation de l’homme qu’à restituer des faits pourtant établis par les rapports d’autopsie. Et il y a l’indignation que provoque le retour de l’artiste sur la scène musicale et médiatique en 2010, à la demande express d’un boys’ club (1).
Tant qu’il purgeait sa peine – en prison, puis en liberté conditionnelle –, les féministes se sont tues. Mais en 2010, « la reprise de ses concerts et l’accueil en héros qu’il a reçu ont mis le feu aux poudres », se souvient Isabelle Germain, créatrice du média féministe Les Nouvelles News en 2009. Car, ainsi que l’a démontré Valérie Rey-Robert dans Une culture du viol à la française (Libertalia, 2019), si tout le monde prétend vouloir lutter contre les violences sexistes, il n’y a plus grand monde quand il s’agit de se désolidariser d’un ami compromis, ou d’arrêter de consommer les œuvres d’artistes accusés ou jugés coupables.
Une vingtaine de coups de poing
Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, Bertrand Cantat frappe sa compagne, Marie Trintignant, à plusieurs» reprises, au cours d’une violente dispute. Les médecins ne réussissent pas à la sauver ; elle meurt le 1er août 2003. Bertrand Cantat est le leader de Noir Désir, un groupe de rock très populaire et réputé de gauche pour ses textes et ses prises de position anticapitalistes. Marie Trintignant est comédienne, fille de l’acteur Jean-Louis Trintignant et de la réalisatrice Nadine Trintignant.
Cet été 2003, ils se trouvent sur le tournage du téléfilm Colette, une femme libre à Vilnius, en Lituanie, et un soir, à l’hôtel, ils se disputent au sujet des SMS qu’elle échange avec son ex-compagnon. Bertrand Cantat donne à Marie Trintignant plusieurs coups de poing, une vingtaine selon les experts. Elle est sonnée ou déjà dans le coma quand il la met au lit un peu après 1 heure. « J’ai cru qu’elle dormait, elle respirait normalement », se défendra Bertrand Cantat devant le tribunal de Vilnius. Elle saigne du visage et l’hémorragie cérébrale a probablement commencé.
Bertrand Cantat appelle Samuel Benchetrit, ex de Marie Trintignant et sujet de la dispute qui vient de se produire. Ce dernier s’inquiète, mais le chanteur lui assure que tout est rentré dans l’ordre : elle dort. Bertrand Cantat raccroche, reste seul quelques minutes. L’hématome sous-dural s’étend. Il appelle ensuite le frère de Marie Trintignant, Vincent, qui est sur place à Vilnius. Ce dernier le rejoint dans la chambre, il passe voir Marie – qui semble dormir –, entend son souffle. Elle est déjà dans le coma. Il est 7 h 15, plusieurs heures après les coups, lorsqu’il passe une deuxième fois et qu’il voit le sang s’écouler de la bouche de sa sœur. Il appelle alors les secours.
La faute au radiateur… et à la jalousie
En cet été de grande canicule, les médias français se saisissent de l’affaire, qui remplit les colonnes et les écrans – les réseaux sociaux, rappelons-le, n’existent pas encore. Largement relayées, les premières explications du chanteur devant la police lituanienne reprennent le mythe patriarcal de « la dispute qui a mal tourné ». Bertrand Cantat affirme avoir poussé Marie Trintignant, qui serait tombée sur un radiateur – une version qui restera longtemps imprimée dans les esprits.
Pourtant, le rapport d’autopsie publié la semaine suivante est formel : il n’y a qu’une ecchymose au crâne compatible avec une lésion de chute et celle-ci n’a entraîné ni « plaie cutanée ni fracture crânienne ». Dominique Lecomte et Walter Vorhauer, médecins légistes à l’institut médico-légal de Paris, ajoutent : « C’est l’ensemble des traumatismes et surtout les violents mouvements de va-et-vient de la tête qui ont été responsables des lésions mortelles observées. »
Après ce rapport qui infirme sa première version, Bertrand Cantat admet avoir donné « au moins quatre gifles très violentes ». Mais comme l’écrira Laurent Valdiguié le 16 mars 2004 dans Le Parisien, « les faits sont têtus. Dix-neuf coups traumatisants, dont sept au visage, ont provoqué le coma, puis la mort de Marie Trintignant. Qui les a portés ? Bertrand Cantat, qui le reconnaît. »
La société résiste de toutes ses forces à une vérité difficile à admettre : tous les hommes, même les hommes blancs, de gauche et artistes admirés, peuvent commettre l’irréparable, en tuant la femme qu’ils prétendent aimer. Pour éviter de se remettre en question, ils ont tendance à se réfugier derrière des mythes, des croyances et des stéréotypes qui transfèrent la responsabilité des violences sexistes. Ce sont les femmes qui « l’auraient bien cherché » ou d’autres hommes qui sont désignés coupables : ceux du passé, qui se comportaient mal, des classes dominées ou les hommes racisés. Cette fois, l’accusé est un semblable. Il faut donc former un front solidaire pour soutenir celui à qui, bien des fois, on s’est identifié en écoutant ses chansons.
De nombreux articles et prises de parole publiques s’attachent ainsi à minimiser cette violence qui a pourtant entraîné la mort. Les faits sont romantisés, c’est-à-dire qu’on les présente comme une conséquence acceptable du sentiment amoureux. C’est une tradition française qu’on retrouve dans de nombreuses œuvres, comme la chanson populaire de Johnny Hallyday Requiem pour un fou : « Je l’aimais tant que pour la garder je l’ai tuée. » En octobre 2003, dans le magazine Rock & Folk (2), le musicien et critique de rock Patrick Eudeline habille Bertrand Cantat du costume de l’amoureux éconduit, évoquant un drame shakespearien : s’il a tué sa compagne, c’est parce qu’il était jaloux : « Ce soir-là, l’indicible fut consommé. L’indicible des rapports de couple, de l’amour, du quiproquo de la passion. »
Pour Le Monde (3), il est aussi question de jalousie : « Le chanteur n’en finit pas d’interroger sa compagne sur sa relation avec Samuel Benchetrit. Elle boit, fume et ne lui répond pas. Il s’énerve, insiste, brise un verre. »
Ses mots à elle jugés plus graves que ses coups à lui
Pour diminuer la responsabilité de l’homme, il est également nécessaire de mettre à distance l’humanité de la femme, afin que sa mort ne provoque pas trop d’empathie. Patrick Eudeline, toujours dans Rock & Folk, va jusqu’à attribuer une valeur différente aux chagrins des familles : « Que l’image de la famille Cantat, de son ex (la mère de ses enfants…), de son frère, du groupe accouru, font mal… ! Plus encore que celle du clan Trintignant décomposé par la douleur. C’est que la mort est propre au moins. Terrible, mais définitive. »
Dans un autre registre, dès novembre 2003, soit quatre mois après les faits, l’avocat de Bertrand Cantat, Olivier Metzner, sème le doute sur l’honorabilité de la victime en demandant une enquête sur un accident de voiture qu’elle aurait provoqué dans la nuit du 5 au 6 août 1991. La Renault Clio de Marie Trintignant avait alors violemment heurté un véhicule de l’équipe technique sur un tournage, et elle avait été projetée à travers le pare-brise, puis hospitalisée pour de multiples blessures à la face. Elle avait 2,78 grammes d’alcool par litre de sang, ce qui lui avait valu une condamnation à deux mois de prison avec sursis et un an de suspension de permis.
Douze ans plus tard, cette séquence de la vie de Marie Trintignant est instrumentalisée par la défense de Bertrand Cantat pour expliquer la fracture-éclatement des os propres du nez relevée à l’autopsie. « Il s’agit de vérifier tout ce qui pourrait expliquer la fragilité physique de Marie (4) », tente de justifier Olivier Metzner. La transformation du réel est spectaculaire : ce n’est plus l’homme qui tue à coups de poing, mais c’est le nez et le crâne de la victime qui cèdent trop facilement sous les coups.
Minimiser, c’est aussi donner une importance égale aux paroles de Marie Trintignant et aux coups de Bertrand Cantat. En septembre 2003, dans une tribune publiée dans Libération (5), l’écrivain Jacques Lanzmann estime que les coups de poing sont une réponse justifiée aux provocations verbales de Marie Trintignant : « On frappe. On frappe pour faire taire les mots qui tuent. On frappe pour en finir avec les mots », parce que « les mots font plus mal que les coups ». L’infatigable Patrick Eudeline imagine aussi la scène : « “Mais tais-toi donc !” Elle ne se tait pas. Bien sûr. Alors, il frappe. Elle tombe. »
Ce recours à la violence pour faire taire une femme – qui pourtant, d’après Le Monde, refusait de parler – semble partagé par le groupe des commentateurs et commentatrices : « Je ne connaissais pas Cantat, mais comme tout le monde ou presque, je m’imagine à sa place ce soir-là, je ressasse toutes les violences, les cris, les scènes, les jalousies, tout ce que j’ai vécu, moi aussi, et qui aurait pu mal tourner », confie Patrick Eudeline. On n’est plus seulement dans la fiction, mais dans l’autofiction.
Marie Trintignant n’est plus, à travers ce récit, qu’un objet, un obstacle sur le chemin d’un homme devenu victime. Cette désensibilisation publique à son sort est notamment ce qui permettra presque 20 ans plus tard de continuer à en rire sur le site internet Purepeople : « Marie Trintignant : son fils Jules, futur mannequin ? Leur ressemblance “frappante” (6) ».
Apparaît l’injonction : il faut séparer l’homme de l’artiste
Bertrand Cantat est jugé en Lituanie un an après les faits, et sa défense commence par plaider le « crime passionnel » – un crime reconnu par le Code pénal lituanien, qui peut être puni d’une peine de prison de six ans au maximum. Cette qualification pénale n’existe pas en revanche dans la loi française, où l’on considère, au contraire, depuis 1994 que commettre un homicide sur un·e conjoint·e est une circonstance aggravante.
Les féministes montent alors au créneau. Isabelle Alonso, cofondatrice des Chiennes de garde, écrit sur son blog : « Insinuer que Marie n’était pas une sainte ou soumettre la victime d’un viol à une enquête de moralité relève d’une démarche identique : il s’agit de chercher dans la vie de la victime une justification à l’agression. » Et puis il y a la chanteuse Lio, amie de Marie Trintignant, elle-même victime de violences intrafamiliales, qui laissera sa colère éclater sur le plateau TV de Thierry Ardisson le 29 mars 2004 : « Dire que Marie était responsable de sa mort avec lui, que c’est la passion et l’amour qui l’ont tuée, non ! L’amour n’apporte pas la mort, ou alors c’est une erreur absolue et totale. […] Marie est morte sous ses coups ! »
En mars 2004, huit mois après les faits, Bertrand Cantat est condamné par la justice lituanienne à huit ans de prison pour meurtre commis en cas d’intention indirecte indéterminée, soit l’équivalent de ce que la justice française définit dans l’article 222–7 du Code pénal comme violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Transféré à la prison de Muret (Haute-Garonne) en septembre 2004, il purge sa peine jusqu’au 15 octobre 2007, date à laquelle il obtient une libération conditionnelle.
En juillet 2010, son contrôle judiciaire prend fin, et c’est le retour de l’artiste, de l’homme public qui n’a plus l’interdiction de produire « tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle liée à la mort de Marie Trintignant » ou de s’exprimer sur les faits. Quand il revient dans l’arène médiatique, une question éthique et morale est cependant posée : peut-on célébrer un homme jugé coupable de féminicide ?
Une des réponses à cette interrogation légitime est ni plus ni moins une injonction patriarcale : « Il faut séparer l’homme de l’artiste. » Les hommes – qui revendiquent pourtant haut et fort la rationalité comme un des attributs du masculin – s’acharnent, affaire après affaire, à suivre ce chemin intellectuel sinueux, pour ne pas dire tordu, sans parvenir à masquer l’essentiel : consommer les œuvres de l’artiste augmente le capital financier et l’influence de l’homme face à ses victimes ou aux féministes qui lancent l’alerte.
Quand les hommes sont accusés de violences sexistes et sexuelles, il est admis que ce n’est pas « si grave ». On nous invite à distinguer leurs fonctions exceptionnelles ou leurs apports publics au monde de ce qui relèverait de leurs vies privées. C’est en vertu de ce principe tacite que Nicole Belloubet, alors garde des Sceaux, répond aux accusations de viols et d’abus de faiblesse contre Gérald Darmanin, son collègue ministre de l’action et des comptes publics (depuis juillet 2020 à l’Intérieur) : « Au demeurant, [il] est un excellent ministre du budget. »
« Les femmes ne sont jamais qu’une chose. Mais aux hommes sont accordées mille dimensions. Violeurs, “on leur doit” de reconnaître qu’ils ne sont pas “que ça”. La violence est contrebalancée par ce que les hommes “apporteraient” à la société. Ce troc patriarcal doit cesser », résume Kaoutar Harchi dans un tweet le 15 décembre 2021 en réponse au journal L’Équipe, qui relativise les accusations de viol du nageur Yannick Agnel au regard de sa carrière prestigieuse.
Un retour en héros, mais l’image se lézarde
Dans le secteur des musiques actuelles, milieu dans lequel je travaillais encore en 2010, je suis aux premières loges pour observer ce phénomène. Les hommes occupent alors 80 % des postes de direction de salles et 77 % des postes de programmation (en 2018, selon la dernière étude en date (7) , les hommes occupent 88 % des postes de programmation et 75 % des postes de direction). Ils ont le pouvoir de faire et défaire les carrières. Ce sont eux qui ont décidé le retour de Bertrand Cantat en héros. En réunion d’équipe, on ne s’embarrassait pas de scrupules éthiques. On se demandait plutôt quel festival, quelle salle de musique actuelle aurait le privilège de faire jouer Bertrand Cantat en premier ou quel titre de presse spécialisé aurait l’exclusivité de son interview.
Le retour de Bertrand Cantat se fait finalement sur la scène du festival Les Rendez-Vous de Terres Neuves, à Bègles, en Gironde, le 2 octobre 2010, environ trois mois après la levée de son contrôle judiciaire, à l’invitation du groupe Eiffel. Romain Humeau, le chanteur, appelle « un ami, presque un frère » à le rejoindre sur scène. Si les médias généralistes relaient l’information en prenant soin de rappeler les faits reprochés à Bertrand Cantat, la presse musicale ne s’encombre pas de ce « détail ». On devine le soulagement d’une certaine caste musico-intellectuelle à pouvoir enfin retrouver son idole. Les Inrocks s’enflamment : Bertrand Cantat « renaît à la musique. Libéré » (8). Même excitation chez un chroniqueur du webzine La Grosse Radio, qui conclut : « Les quelques frissons qu’il aura finalement réussi à produire dans l’assistance sont autant de choses que ni moi ni les personnes présentes serons près d’oublier. » (9)
Pourtant, la réputation de Cantat commence à se lézarder, y compris dans le domaine de la musique. La première ombre au tableau vient de Serge Teyssot-Gay, cofondateur de Noir Désir, en novembre 2010 : « Je fais part de ma décision de ne pas reprendre avec Noir Désir, pour désaccords émotionnels, humains et musicaux avec Bertrand Cantat, rajoutés au sentiment d’indécence qui caractérise la situation du groupe depuis plusieurs années. » Le lendemain, c’est le batteur du groupe, Denis Barthe, qui annonce la fin de l’activité du groupe de rock français, maintenu « en respiration artificielle pour de sombres raisons ».
La double peine de Krisztina Rády
Depuis le suicide de son ex-épouse, la traductrice et écrivaine d’origine hongroise Krisztina Rády, en janvier 2010, des voix s’élèvent pour dénoncer la responsabilité de Bertrand Cantat dans sa disparition. La mère de ses deux enfants, qui l’a soutenu lors de son procès à Vilnius et auprès de qui il est revenu vivre après sa libération, s’est pendue alors qu’il dormait dans une autre pièce de la maison.
En 2013, un message vocal à ses parents faisant état de violences intrafamiliales est rendu public : « Hélas, je n’ai pas grand-chose de bon à vous offrir, et pourtant il aurait semblé que quelque chose de très bon m’arrive, mais en l’espace de quelques secondes Bertrand l’a empêché et l’a transformé en un vrai cauchemar qu’il appelle amour. Et j’en suis maintenant au point […] qu’hier j’ai failli y laisser une dent, tellement cette chose que je ne sais comment nommer ne va pas du tout. […] Mon coude est complètement tuméfié et malheureusement un cartilage s’est même cassé, mais ça n’a pas d’importance tant que je pourrai encore en parler. »
L’information, présentée dans Closer comme « Un nouveau drame qui frappe le chanteur », est-elle la manifestation du sort tragique qui s’acharne sur Bertrand Cantat ? Ce n’est pas ce que pense l’avocate Yael Mellul, spécialiste des violences conjugales. En 2013, elle demande une réouverture de l’enquête sur le suicide de Krisztina Rády pour faire reconnaître la notion de « suicide forcé », notion qui définit les suicides de femmes ayant été précédés de violences psychologiques de la part de leur conjoint. En 2018, ayant quitté le barreau et devenue présidente de l’association féministe Femme et libre, elle dépose plainte de nouveau contre Bertrand Cantat pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Dans un courrier adressé au parquet de Bordeaux, que Le Journal du dimanche avait pu consulter, Yael Mellul rapportait les extraits d’une lettre de Krisztina Rády faisant état des violences exercées par son ex-compagnon. La plainte a finalement été classée sans suite et Bertrand Cantat, à son tour, portera plainte pour « dénonciation calomnieuse ».
En octobre 2013, le chanteur est de nouveau célébré en une des Inrocks. « Si on voulait lui parler, c’était qu’[…]au-delà de l’effroi face à ce meurtre passionnel absurde, on ne reconnaissait pas le Bertrand Cantat décrit par une certaine presse qui avait largement battu en dégueulasserie, lynchage et enquêtes bâclées les tabloïds anglais que la France sait si bien montrer du doigt », se justifie le rédacteur en chef du mensuel, Jean-Daniel Beauvallet. Plus loin, il accuse les féministes d’être contre la réhabilitation d’un homme qui a purgé sa peine : « On ne peut lui interdire le droit d’exercer son métier au nom de la morale, de la décence : ça serait nier le travail et les décisions des tribunaux. » Une indignation, là encore, assez sélective : Les Inrocks ne se sont jamais offusqués qu’un délinquant ou un criminel ne puisse plus travailler dans la fonction publique en raison de son casier judiciaire.
En 2017, trois semaines après la vague #MeToo, Bertrand Cantat est d’ailleurs à nouveau en une du magazine. Des honneurs similaires sont réservés au réalisateur Roman Polanski, pourtant accusé de violences sexistes et sexuelles, lorsqu’il est couronné par le César de la meilleure réalisation en 2020. Les faits reconnus – avoir drogué une jeune fille de 13 ans pour la sodomiser – n’émeuvent pas plus la « grande famille » du cinéma français qu’un féminicide n’a bouleversé le milieu musical.
C’est que, en France, les élites culturelles ont un statut à part. Norimitsu Onishi, correspondant du New York Times à Paris, le notait encore en 2020 (10) à propos de l’affaire Matzneff : « La France a beau être un pays profondément égalitaire, son élite tend à se démarquer des gens ordinaires en s’affranchissant des règles et du code moral ambiant, ou, tout au moins, en défendant haut et fort ceux qui le font. » Le résultat, paradoxal, est que les affaires ne sont jamais closes. En novembre 2021, et presque 20 ans après la mort de Marie Trintignant, lorsque Wajdi Mouawad fait appel à Bertrand Cantat pour signer la musique de sa pièce de théâtre Mère au Théâtre de La Colline, les féministes ripostent avec une manifestation et un happening le soir de la première. Il ne s’agissait pas d’une apparition publique pour Cantat. Mais en le défendant comme ils l’ont fait, les membres du fameux « boys’ club » ne lui ont peut-être pas rendu service. C’est à ce genre de détail qu’on reconnaît aussi le patriarcat : personne n’en sort jamais vraiment grandi. •
(1) Ce terme désigne un réseau informel d’hommes qui se cooptent et s’entraident dans le cadre professionnel ou social.
(2) Patrick Eudeline, « La ballade de Marie et Bertrand », Rock & Folk, n°434, octobre 2003.
(3) Pascale Robert-Diard, « L’affaire Bertrand Cantat : Marie Trintignant, l’amour battu », Le Monde, 25 août 2006.
(4) Stéphane Bouchet, « Polémique sur un accident de la route », Le Parisien, 28 novembre 2003.
(5) Jacques Lanzmann, « Les mots qui tuent », Libération, 19 septembre 2003.
(6) Le titre de cet article publié le 28 novembre 2020 dans Purepeople, a depuis été modifié : « Leur ressemblance “frappante” » a été remplacé par « Leur ressemblance largement soulignée ».
(7) Collectif, « L’emploi permanent dans les lieux de musiques actuelles », Volume !, mis en ligne le 5 septembre 2018.
(8) Marc Besse, « Sur scène avec Eiffel, Bertrand Cantat renaît à la musique », Les Inrockuptibles, octobre 2010.
(9) Robix66, « Eiffel à Terres Neuves (avec Bertrand Cantat) », La Grosse Radio, 13 octobre 2010.
(10) Norimitsu Onishi, « Un écrivain pédophile – et l’élite française – sur le banc des accusés », The New York Times, 11 février 2020.