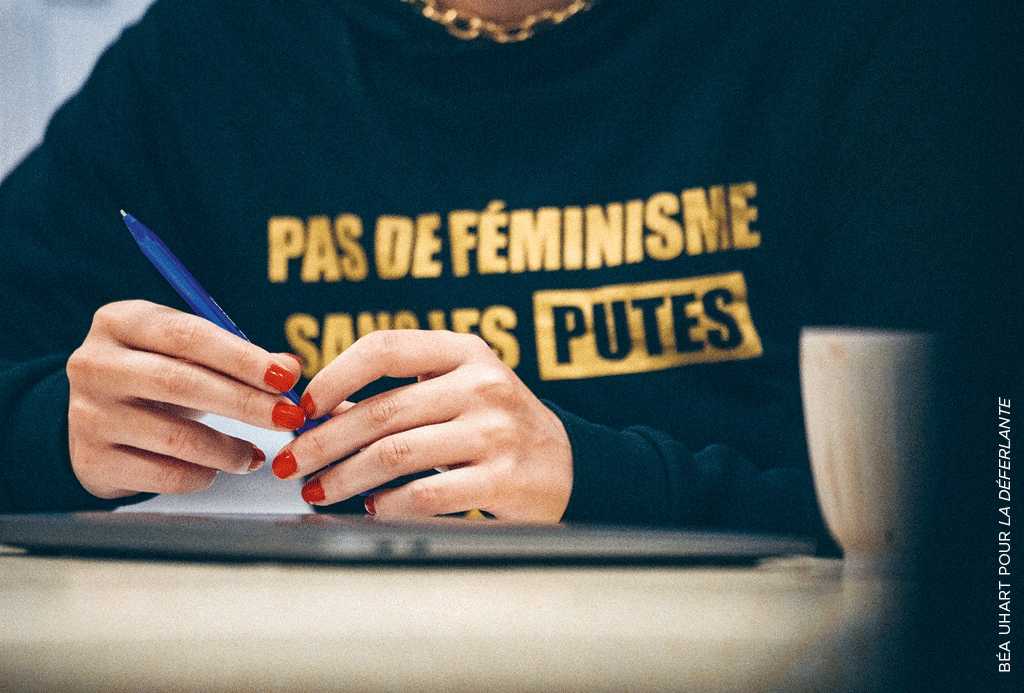L’engagement de Selma Hajri, 70 ans, ne date pas d’hier. Pour comprendre son importance, il faut remonter au début des années 2000, lorsqu’elle coordonne une étude sur le coût de l’avortement médicamenteux afin de le rendre accessible dans le Sud global.
Publié dans la plus prestigieuse des revues de médecine internationale, The Lancet, ce travail a donné naissance au protocole qui permet de réduire les coûts. Il est à l’heure actuelle utilisé dans la majorité des pays qui autorisent la pilule abortive, y compris en France. Vingt ans plus tard, la militante est toujours l’un des piliers de l’association Tawhida Ben Cheikh pour l’aide médicale, fondée en 2012 à Tunis et qui plaide pour la justice reproductive et l’éducation sexuelle. Elle anime également le Mouvement méditerranéen pour le droit et l’accès à l’avortement (MARA) et occupe la vice-présidence de l’Association pour la santé des femmes en Afrique Maghreb et Moyen-Orient (ASFAMM).
En septembre 2023, vous avez célébré le cinquantenaire de la légalisation de l’IVG en Tunisie en sonnant l’alarme. Longtemps érigée en exemple en matière d’IVG, la Tunisie voit-elle, actuellement, ce droit menacé ?
Sans que le droit soit remis en cause dans le champ politique, l’accès réel des femmes à l’IVG est de plus en plus difficile, notamment pour les plus pauvres et les moins urbaines. En 2014, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) ne recensait plus que deux hôpitaux réalisant des IVG chirurgicales dans tout le pays et, pendant la pandémie de Covid-19, nous avons fait face à une grave pénurie de médicaments abortifs. La dégradation de l’offre de services de santé sexuelle et reproductive est importante et rapide, bien que nous ne puissions la décrire avec précision puisque le Planning familial tunisien lui-même ne publie plus de statistiques depuis plusieurs années.

Crédit photographique : Ons Abid pour La Déferlante
Des groupes féministes tunisiens accumulent les témoignages qui décrivent des parcours semés d’embûches pour avorter et qui, parfois, échouent. Les femmes racontent des entraves multiples : tentatives de dissuasion, fausses informations médicales ou exigences illégales formulées par les personnels soignants. Des rendez-vous sont proposés hors délai [cinq examens sont nécessaires pour réaliser une IVG médicamenteuse en Tunisie]. Le parcours est parfois stoppé brutalement car on annonce à la patiente que le service est surchargé ; on lui reproche d’avoir avorté plusieurs fois et on lui annonce qu’elle n’est pas « prioritaire » ; on oublie de lui prescrire un examen ; on demande une autorisation du mari alors que cette contrainte n’existe pas dans la loi ; on impose de nombreux allers-retours à l’hôpital en étalant les rendez-vous, les rendant coûteux et peu discrets pour une femme qui souhaiterait avorter sans que son mari ou ses parents le sachent. Dans certaines régions, plus aucun service public de santé ne propose d’IVG et aucun·e gynécologue ne pratique d’aspiration – et les rares qui la pratiquent encore peuvent exiger des sommes très élevées.
Comment les féministes tunisiennes se mobilisent-elles pour défendre l’accès à l’avortement ?
L’association Tawhida Ben Cheikh a mené une étude en 2022 auprès d’un millier de jeunes femmes et jeunes hommes de 18 à 29 ans. Elle révèle que plus de 40 % ignorent que l’IVG est gratuite et accessible à toutes les femmes majeures. La société tunisienne pourrait, sans que le droit soit formellement remis en cause, perdre la connaissance de son existence. Former et informer est primordial. En l’absence d’études publiées par le ministère de la santé ou le Planning familial, ce travail de production de données fait partie des multiples moyens mobilisés par les quelques rares associations féministes tunisiennes qui collectent et diffusent également des témoignages, font de l’information sur la santé sexuelle, mobilisent la presse ou proposent de l’éducation à la santé sexuelle et reproductive en arabe sur les réseaux sociaux. Avec l’association Tawhida Ben Cheikh, nous proposons également des formations spécifiques à destination des soignant·es pour qu’elles et ils prennent conscience des implications de leurs positionnements personnels dans l’exercice de leur métier. Des jeunes femmes, comme la sage-femme Nourshenne Cheguenni, s’emparent avec enthousiasme des réseaux sociaux, mais le sujet reste encore relativement peu visible dans l’espace public tunisien alors que le mouvement social demeure assez timide sur le sujet.

Selma Hajri, chez elle à Tunis. Crédit photographique : Ons Abid pour La Déferlante
Comment expliquez-vous cette timidité ?
Longtemps ce droit a été brandi par le pouvoir tunisien comme un gage de sa supposée modernité sur la scène internationale. Il était regardé comme un acquis en Tunisie et nous n’avons pas spécialement été sensibles à l’importance de mener cette lutte. De plus, nous partons de loin car l’histoire très singulière de la légalisation de l’IVG en Tunisie pèse certainement dans les difficultés actuelles à se mobiliser. En 1973, la légalisation constituait l’un des volets d’une politique démographique d’État mise en place pour contrôler les naissances et réduire la natalité. L’avortement devait répondre à un agenda économique : les dirigeants visaient des objectifs politiques qui n’avaient pas grand-chose à voir avec la libération des femmes. Alors qu’elles étaient mobilisées contre le président Bourguiba [premier président de la Tunisie indépendante en 1957, désigné « président à vie » en 1975], les femmes de gauche – qui ne se qualifiaient pas de « féministes » à l’époque – ont usé d’un droit octroyé par un pouvoir politique qu’elles combattaient. C’est un sacré paradoxe qui laisse des traces : ce droit n’est pas associé à une victoire de la société tunisienne contre l’État, et force est de constater qu’en matière de droits le chemin semble compter autant que le résultat.
« INTERNET FACILITE L’ACCÈS À LA PILULE ABORTIVE : C’EST UNE VAGUE QU’ON NE PEUT PLUS ARRÊTER »
Autre conséquence de la manière dont ce droit a été obtenu, le tabou sur la sexualité en général, et sur le sexe des femmes en particulier, n’a pas été ébranlé dans la Tunisie de l’époque et reste très ancré. Ironiquement, ce tabou nous protège de l’émergence de mouvements qui militeraient contre l’avortement – que vous connaissez en Europe –, mais il fait aussi de l’IVG un non-sujet dans le débat public. Il imprègne toute la société, donc la gauche aussi. Pour défendre l’IVG, il faut accepter de se confronter à ce tabou, ce qui est loin d’être facile.

Crédit photographique : Ons Abid pour La Déferlante
Quelles seraient, selon vous, les conditions pour un accès pérenne et sécurisé à l’IVG à travers le monde ?
Il existe un gouffre entre le droit et la réalité. La criminalisation et les entraves à l’IVG n’ont jamais empêché les femmes d’avorter, mais elles les exposent toujours et partout à des dangers ; alors que le droit ne garantit pas l’accès pérenne à l’IVG pour toutes les femmes, comme on l’a vu récemment aux États-Unis.
Aujourd’hui, on peut s’attendre à ce que le droit ou l’accès à l’avortement soient mis en danger par un conservatisme qui gagne du terrain un peu partout dans le monde. Il faut s’y opposer, évidemment, et se battre dans le même temps pour l’accès à la contraception et à l’éducation sexuelle. Une lueur d’espoir se dessine cependant : les expert·es et professionnel·les du sujet constatent que l’accès à l’avortement sécurisé, quelles que soient les lois nationales, va devenir de plus en plus universel. L’utilisation d’Internet rend le recours à la méthode médicamenteuse plus aisé et accessible partout malgré les frontières et les lois nationales : c’est une vague qu’on ne peut plus arrêter. Je suis profondément optimiste, car aucun pouvoir n’a les moyens de stopper ça. On peut entraver, freiner ou canaliser l’information, mais la supprimer : non.

Crédit photographique : Ons Abid pour La Déferlante
Des organisations comme Women in Web diffusent dans le monde entier des informations et les molécules avec une très grande facilité. Dans les pays où l’IVG est interdite, les femmes se font déjà envoyer les médicaments par la poste et cela fonctionne très bien : prendre les comprimés déclenche une fausse couche qu’elles terminent seules ou à l’hôpital. L’avenir est là. C’est facile, c’est connu, c’est publié dans des revues scientifiques : les femmes sont parfaitement capables de se débrouiller sans médecin, sans mettre leur vie en danger pour autant. Au contraire, il y a une baisse extraordinaire de la mortalité consécutive aux avortements dans les pays où l’IVG est illégale et où les femmes ont recours à l’IVG médicamenteuse. Cette pratique, déjà extrêmement répandue, a été baptisée « avortement autogéré » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui la recommande depuis deux ans, considérant que c’est l’une des techniques les plus sécurisées.
Cette démédicalisation, c’est l’avenir. Mais elle ne règle pas la question du droit, parce que la criminalisation ne lève pas le tabou, génère du trafic, l’inflation des coûts, les inégalités d’accès et le risque d’avoir des médicaments issus du marché noir. Il faut donc lutter contre la criminalisation, et, sur ce terrain politique et social aussi, il n’y a que l’organisation des femmes qui peut permettre de gagner, et cela passe en général par un combat pour le droit. Il nous faut combiner les deux luttes. C’est d’autant plus important qu’il y a quelques échecs dans les IVG médicamenteuses [entre 1 et 5 %] : il est donc important qu’elles puissent avoir accès à plusieurs méthodes, qu’elles puissent donc, là encore, choisir.
→ Retrouvez la revue de presse ainsi que les coups de cœur de la rédaction juste ici.