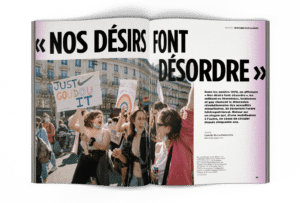Au début de 2024, dans un lycée public d’une petite ville occitane, la réalisatrice Nina Faure projette son documentaire We are coming, qui aborde la sexualité d’un point de vue féministe. Plusieurs classes y assistent, par groupes d’une centaine d’élèves, encadré·es par leurs professeur·es, mais sans préparation pédagogique préalable.
Dès les premières minutes, la réalisatrice comprend à leurs réactions que ces jeunes spectateur·ices « prennent le film à l’envers », ne saisissant pas, par exemple, le second degré de certaines scènes. Elle met le film en pause et fait le point : le documentaire a déjà été vu par des quantités d’élèves sans que cela ait posé problème, il est classé « tout public » et entre dans le champ de l’éducation à la vie affective et sexuelle (EAS), un enseignement obligatoire de la maternelle à la terminale (1). Deux élèves quittent tout de même la projection, et les échanges à l’issue de celle-ci sont tendus. « On aurait dit que c’était la première fois que ces jeunes étaient confronté·es à une discussion publique sur la sexualité », explique-t-elle avec le recul.
Si l’absence de préparation peut expliquer la réception compliquée du film, l’hostilité est aussi alimentée par un petit groupe de garçons affiliés à l’extrême droite, qui couvrent la voix des élèves ayant apprécié le film. Nina Faure se souvient notamment d’un élève offensif qui lui reproche de cacher que ce seraient « principalement les Noirs et les Arabes qui agressent les femmes en France », une information infondée régulièrement colportée par l’extrême droite. Un autre élève se dit choqué par le t‑shirt d’une des interviewées, représentant une Vierge dans une vulve, et commence à propager une rumeur selon laquelle « la Vierge se fait poutrer » dans le film. Ces élèves vont jusqu’à lancer une pétition pour dénoncer l’« atteinte à la laïcité et à la neutralité politique » qu’aurait constituées cette projection. Le personnel éducatif mettra une bonne semaine à faire redescendre la tension.
Sébastien (son prénom a été modifié) est professeur de philosophie et « référent égalité » – depuis 2018, tous les établissements de second cycle sont obligés de nommer ces référent·es, sur la base du volontariat, parmi leur personnel éducatif. Dans le lycée où est projeté le documentaire de Nina Faure, c’est donc lui qui est chargé de la promotion de l’égalité filles-garçons, de la prévention des violences sexistes et sexuelles et des LGBTphobies, en soutien aux intervenant·es en EAS. Sébastien explique que ces élèves d’extrême droite, qui « se vantent d’aller aux meetings de Bardella » et qui « parviennent à instaurer dans le quotidien de la classe une ambiance lourdement misogyne » se révèlent particulièrement virulents lors des séances d’éducation à la sexualité, lorsqu’ils s’offusquent par exemple de discussions sur la reproduction ou sur la transidentité. À ceux-là s’ajoutent des élèves « très chrétien·nes » : choqué·es par We are coming, elles et ils ont soutenu la pétition lancée après sa projection. Sébastien se heurte au fait qu’une partie des jeunes qu’il a en classe jugent « qu’on ne doit pas parler de sexualité à l’école, qu’on est trop jeunes, que c’est privé » – alors que, en parallèle, plusieurs filles lui confient avoir subi des viols, y compris de la part de camarades de classe.
« On aurait dit que c’était la première fois que ces jeunes étaient confronté·es à une discussion publique sur la sexualité. »
Nina Faure, réalisatrice
Chevaux de bataille de la droite radicale
Au lycée, une partie des élèves sont majeur·es ou proches de la majorité ; l’éducation à la sexualité a donc moins de risques qu’à l’école primaire ou au collège d’impliquer les parents et de provoquer un scandale médiatique – comme cela s’était passé avec les ABCD de l’égalité en 2014, et comme tentent de le faire aujourd’hui plusieurs collectifs proches de l’extrême droite, tels SOS Éducation ou Parents vigilants (2). Au lycée, des élèves prennent le relais de l’entreprise de déstabilisation de ces enseignements, chevaux de bataille historiques de la droite radicale et des associations catholiques intégristes. En 1894, déjà, l’antisémite notoire Édouard Drumont s’indignait contre le « système pornographique de coéducation des sexes » (c’est-à-dire la mixité à l’école), mis en place par des instituteur·ices libertaires comme Paul Robin. Ce dernier avait développé dans un orphelinat un enseignement multidisciplinaire émancipateur, athée, antipatriotique… et mixte, avec « filles et garçons [qui] suivent ensemble tous les enseignements et activités (couture, cuisine, travail du fer et du bois) (3) ».

Le collectif ultraréactionnaire Parents vigilants a tenu en novembre 2023 un colloque au Sénat qui s’est clos par une prise de parole d’Éric Zemmour (à gauche). Crédit : Quentin de Groeve /HANS LUCAS
Au-delà de l’affiliation aux partis d’extrême droite et à des organisations identitaires, les jeunes hommes sont de manière générale particulièrement ciblés par les mouvements masculinistes (4), qui pullulent sur Internet et prônent un antiféminisme souvent violent et « centré sur la victimisation des hommes », selon les sociologues Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri. Pour Sébastien, la misogynie et la LGBTphobie ordinaires exprimées bruyamment par une partie des garçons, « qui trouvent qu’on parle trop de ces sujets et préfèrent faire des blagues sur la place des femmes à la cuisine », sont un phénomène « plus insidieux, mais tout aussi contaminateur, car plus fréquent, que les prises de parole des élèves zemmouristes ». Cette aversion pour des rapports plus égalitaires, que l’on retrouve dans toutes les sphères sociales, l’interroge : « Est-ce que parler de consentement et de violences dans cette ambiance, ça ne fait pas plus de mal aux victimes que de ne pas en parler du tout ? » Une remarque qui prêche en faveur de configurations non mixtes sur certains sujets… mais aussi surtout pour une politique beaucoup plus ambitieuse en ce qui concerne l’éducation à la vie affective et sexuelle.
En mars 2024, le gouvernement avait annoncé la mise en place à la rentrée suivante d’un programme complet d’EAS du CP à la terminale, avec des thématiques précises pour chaque niveau et une approche transversale touchant toutes les disciplines. Mais l’initiative a été suspendue au moment des élections législatives de juin, et cet enseignement, tout comme les postes afférents, est pour l’heure dépourvu de budget à la hauteur des enjeux et repose sur la volonté des directions de monter (ou pas) des dossiers de financement pour faire intervenir des associations, acheter du matériel, former les enseignant·es, etc. Malgré l’obligation d’avoir au moins un·e référent·e égalité par lycée, il apparaît dans un sondage réalisé par l’association NousToutes en 2021 que seuls 41 % des lycées publics en ont nommé, et 11 % des lycées privés (5).
Dans les établissements où il y en a, ces référent·es manquent cruellement de temps et de formation appropriée, d’échanges entre pairs et de supports. Elles et ils ne sont pas non plus suffisamment rémunéré·es. En effet, les textes réglementaires ne déterminent pas de nombre d’heures ou d’augmentation de salaire pour cette mission, cela reste à la discrétion des chef·fes d’établissement : certain·es, comme Sébastien, peuvent simplement prendre des heures sur leur temps de travail sans rémunération supplémentaire, d’autres ont 15 minutes libérées par semaine, d’autres encore reçoivent un complément de salaire de quelques dizaines d’euros par mois. Elles et ils se heurtent aussi bien souvent au désintérêt de leurs collègues et supérieur·es, voire à leur hostilité. Quand, dépassé par les histoires de viols que lui ont confiées certaines élèves, Sébastien a voulu faire venir une association spécialiste des violences sexistes et sexuelles, la proviseure a refusé, arguant de l’absence de moyens financiers. Il a été renvoyé aux heures qu’il peut débloquer pour intervenir lui-même, alors qu’il n’est pas formé sur le sujet. « On a quand même l’impression que l’effet d’annonce [du gouvernement Attal] visait à maintenir la structure de domination, en mettant une charge énorme sur les quelques personnes investies », résume Nina Faure, qui a eu l’occasion d’échanger avec bon nombre de référent·es égalité au cours de ses projections en milieu scolaire.
Un levier de lutte contre les discriminations
Angelina Duc est infirmière depuis deux ans dans un lycée public drômois, et chargée de l’EAS. Elle regrette elle aussi ce manque de temps, de personnel formé et d’implication générale sur ce sujet. Depuis la dernière réforme du lycée, les emplois du temps sont très individualisés, les élèves ne sont plus souvent en classe entière et, avec Parcoursup et le contrôle continu, tous·tes subissent une pression accrue dès la seconde. Certes, la hiérarchie soutient les actions que mène Angelina Duc, « mais ce qui compte finalement, ce sont les bons résultats au bac, alors beaucoup d’enseignant·es ne veulent pas faire sauter une heure de cours pour ça ». Autre frein important selon elle, la mauvaise santé mentale des enfants, qui la mobilise beaucoup en tant qu’infirmière. « Un grand nombre d’élèves font des phobies scolaires, des tentatives de suicide, relève-t-elle. Le covid, les réseaux sociaux, l’état du monde, la pression scolaire, ajoutés à des situations familiales compliquées, aux violences sexuelles, à l’homophobie et la transphobie, cela fait beaucoup de choses qui augmentent leur anxiété. »
L’éducation à la sexualité et à l’égalité dès le plus jeune âge est reconnue, par l’État comme par les associations féministes et le milieu éducatif, comme étant primordiale pour lutter contre les violences et les discriminations, pour améliorer la vie de tous·tes et notamment celle des filles et des personnes queers. Elles et ils en sont bien conscient·es.
Depuis deux ans, j’interviens sur le sujet de l’autodéfense féministe dans une classe de seconde pro accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) d’un lycée privé catholique de la Drôme. Anne-Lise et Florence, professeures de français et de sciences médico-sociales, ont choisi ensemble de faire travailler les élèves sur une sélection de livres féministes, alors que l’EAS n’était jusqu’alors quasiment pas dispensée dans ce lycée. Dans leurs fiches de lecture, les lycéennes expriment le soulagement, la libération, les solutions que cela leur apporte à propos des violences sexuelles ou conjugales qu’elles subissent. Dans cette section, les garçons, très minoritaires, performent souvent des masculinités moins virilistes, disent aussi subir des discriminations et sont plus réceptifs à ces questions. La seule opposition à laquelle les enseignantes ont été confrontées est celle de parents d’une famille « très connue et puissante dans le milieu catholique intégriste », qui ont refusé que leur fille lise la BD Le Chœur des femmes (6), la jugeant « pornographique » et « contraire à leurs valeurs ». Ils ont essayé d’imposer une autre liste de livres aux enseignantes.
Plus globalement, dans les lycées, ce sont des élèves, féministes, LGBT+, antiracistes, des filles et des personnes queers surtout, qui sont les acteur·ices de la résistance aux idées réactionnaires. Toutes ces personnes sont par exemple souvent les premiers soutiens de leurs camarades trans, adoptant avant les adultes les nouveaux pronom et prénom. Conscientisé·es à ces questions par les réseaux sociaux, ces élèves réclament des interventions, les organisent, trouvent parfois de leur propre chef des financements : c’est notamment arrivé dans le lycée d’Angelina Duc, dans la Drôme, où je suis intervenue à l’initiative de lycéennes féministes. Celles-ci ont également poussé l’infirmière et une professeure de SVT à monter avec elles une grande exposition sur les questions d’orientation sexuelle, d’identité de genre, de santé sexuelle et reproductive, etc., que près de 500 élèves sont venu·es visiter.
Dans les lycées, les élèves, féministes, LGBT+, antiracistes sont les acteur·ices de la résistance aux idées réactionnaires.
Écoute et dialogue entre pairs
Dans ce contexte de moyens très limités, personnels et élèves engagé·es construisent autant que possible des actions pour favoriser une culture de l’égalité et consolider la résistance aux idées réactionnaires dans leurs établissements. Par exemple, avec une entrée progressive dans les thématiques, une répartition des élèves dans l’espace de façon à casser les logiques de boys’club, ou encore des interventions en non-mixité ou sur la base du volontariat afin de favoriser un espace de parole libre et bienveillant pour les participant·es.
Une autre piste est de soutenir d’abord les personnes les plus motivées et concernées, comme cela se fait au lycée général, technologique et professionnel Joseph-Vallot, situé dans la commune occitane de Lodève, où je suis intervenue en avril 2024. Maëva Béguin-Way, professeure d’anglais et référente égalité, et Mona Clot, conseillère principale d’éducation, ont décidé cette année de concentrer leurs efforts sur la constitution d’un groupe d’égaux-délégué·es, des élèves volontaires et déjà conscient·es des discriminations, susceptibles de devenir des personnes ressources pour leurs camarades. « Passé l’école primaire et le collège, où les adultes sont encore beaucoup sollicité·es pour régler les conflits, explique Mona Clot, au lycée, les élèves semblent perdre confiance en l’action des adultes et préfèrent se taire ou se tourner vers leurs ami·es pour avoir de l’écoute. » Ces jeunes ont bénéficié de trois journées complètes de formation sur les LGBTphobies, au repérage des violences, à l’autodéfense féministe et à l’accueil de la parole de victimes. L’une de leurs premières actions a consisté à organiser un Mois des fiertés au programme chargé : journée des vêtements non genrés, quiz de culture LGBT+, projections, vente au profit de l’association SOS Homophobie, enquête sur la répartition genrée des personnes dans l’espace scolaire, etc.
Un long chemin à parcourir
À partir de septembre 2024, ces égaux-délégué·es pourront intervenir dans des classes pour former à leur tour d’autres élèves à ces questions, afin que, petit à petit, la culture de l’égalité de genre essaime. En parallèle, Maëva Béguin-Way et une vingtaine d’enseignant·es du lycée Vallot et du collège voisin sont en train de rédiger un programme complet de séances d’EAS intégrées aux cours de la 6e à la terminale, qui seront ensuite dispensées pour que tous les sujets soient abordés au fil des années et que la totalité des élèves en bénéficie.
Pour ses actions, Maëva Béguin-Way peut compter sur le « soutien total » de la direction, avec une rémunération de 1 250 euros et un budget de 1 000 euros pour l’année. Un soutien qui a un effet sur ses collègues : si, au départ, une bonne partie d’entre elles et eux ne voyaient pas l’intérêt de la mission, plusieurs ont, depuis, suivi des formations « égalité » – mises en place par l’académie de Montpellier et dispensées notamment par Maëva Béguin-Way –, et se sont emparé·es de ces questions dans leurs cours, n’hésitant pas à venir la consulter pour aider des élèves. « Le fait que le proviseur encourage ce que l’on fait, ça aide, analyse-t-elle. J’ai peut-être des collègues qui n’adhèrent pas pleinement, mais ils ne se sentent pas légitimes à exprimer leur opposition frontalement. » Consciente du chemin qu’il reste à parcourir, elle est aussi impliquée au niveau de l’académie de Montpellier, en tant que membre de l’observatoire des violences de genre, qui recense les « faits établissements » relevant de violences sexistes et sexuelles. Si elle explique craindre parfois une vague de harcèlement par des militant·es d’extrême droite, à l’occasion du Mois des fiertés au lycée par exemple, elle est déterminée : « C’est un combat que je ne lâcherai pas et que je suis fière de mener collectivement avec les élèves et les membres de la communauté éducative qui portent ces valeurs. Je suis prête à en découdre avec n’importe qui. »
Face à divers phénomènes – l’offensive de la droite conservatrice contre les mineur·es trans, l’augmentation des actes LGBTphobes (7), ou encore le dénigrement jusqu’au sommet de l’État des dénonciations de violences sexuelles –, l’éducation à la sexualité, qui cristallise tant de clivages, est un enseignement ancré dans les vécus, qui répond à des besoins urgents. Dans le contexte d’extrême droitisation de la société, elle est aussi un rempart, un front de résistance à tenir, centimètre par centimètre, pour bloquer la prolifération des idées réactionnaires. •
Cet article a été édité par Diane Milelli.
(1) La loi du 4 juillet 2001 établit que les élèves doivent se voir dispenser au moins trois séances par an. En 2021, un rapport de l’Inspection générale de l’Éducation nationale constate que moins de 20 % des collégien·nes et moins de 15 % des écolier·es et lycéen·nes en bénéficiaient.
(2) Créée en 2001, SOS Éducation est proche des milieux ultralibéraux et d’extrême droite. Né en 2022 dans le sillage du parti d’extrême droite Reconquête !, le groupe Parents vigilants cherche à infiltrer les conseils d’école afin de contrer les initiatives de lutte contre les inégalités sociales, raciales et genrées.
(3) Grégory Chambat, Quand l’extrême droite rêve de faire école. Une bataille culturelle et sociale, éditions du Croquant, 2023.
(4) Lire à ce sujet l’article de Pauline Ferrari, « Masculinisme et biologie : le grand détournement »
(5) Sur un échantillon de 720 ayant répondu par « oui » ou par « non » parmi les 1 000 lycées interrogés par téléphone en juin 2021.
(6) Signée Aude Mermilliod (Le Lombard, 2021), elle est adaptée du roman du même nom du médecin Martin Winckler (P.O.L, 2009).
(7) Dans son rapport de 2024, l’association SOS Homophobie note par exemple une augmentation de 40 % des témoignages d’agressions physiques par rapport à 2022.