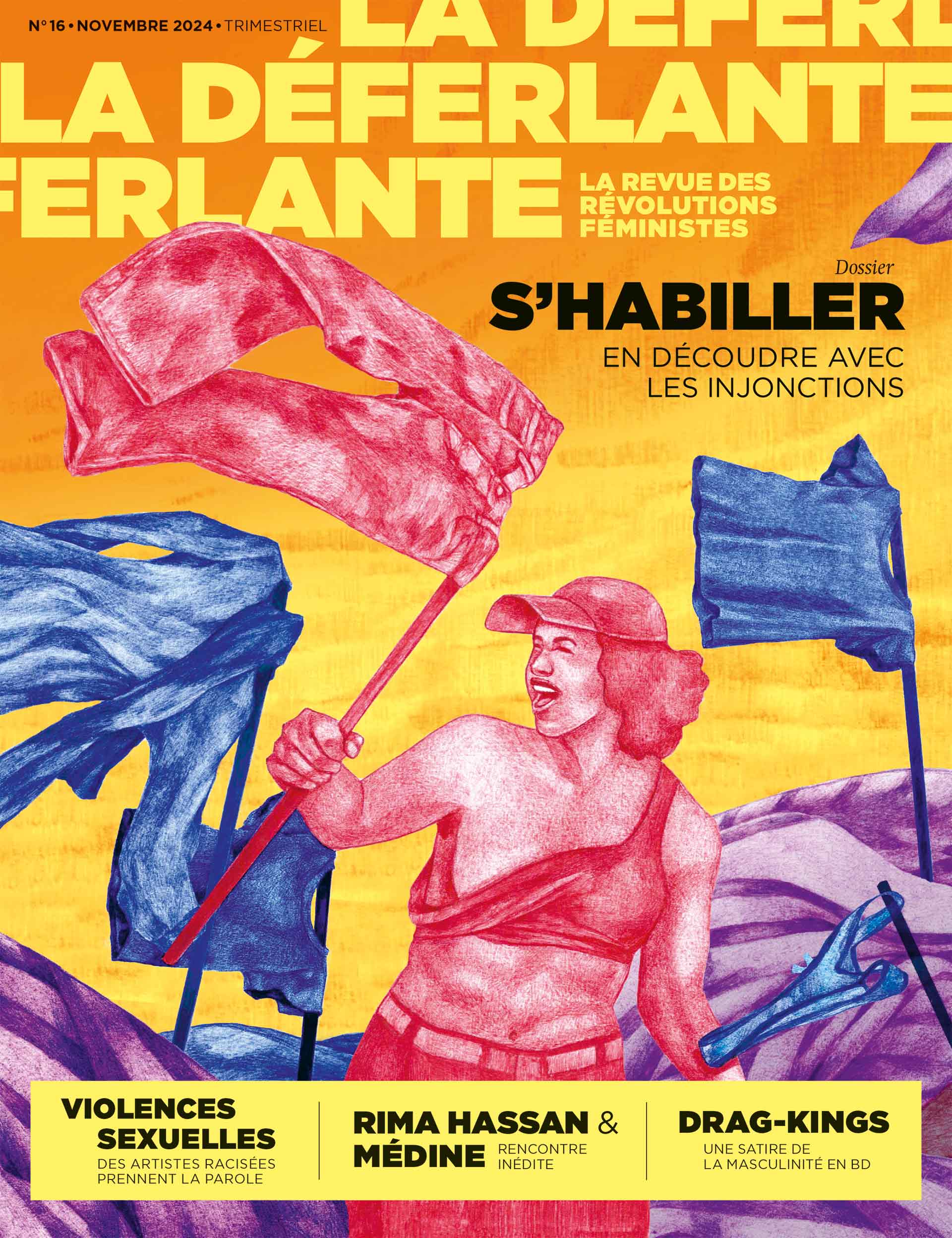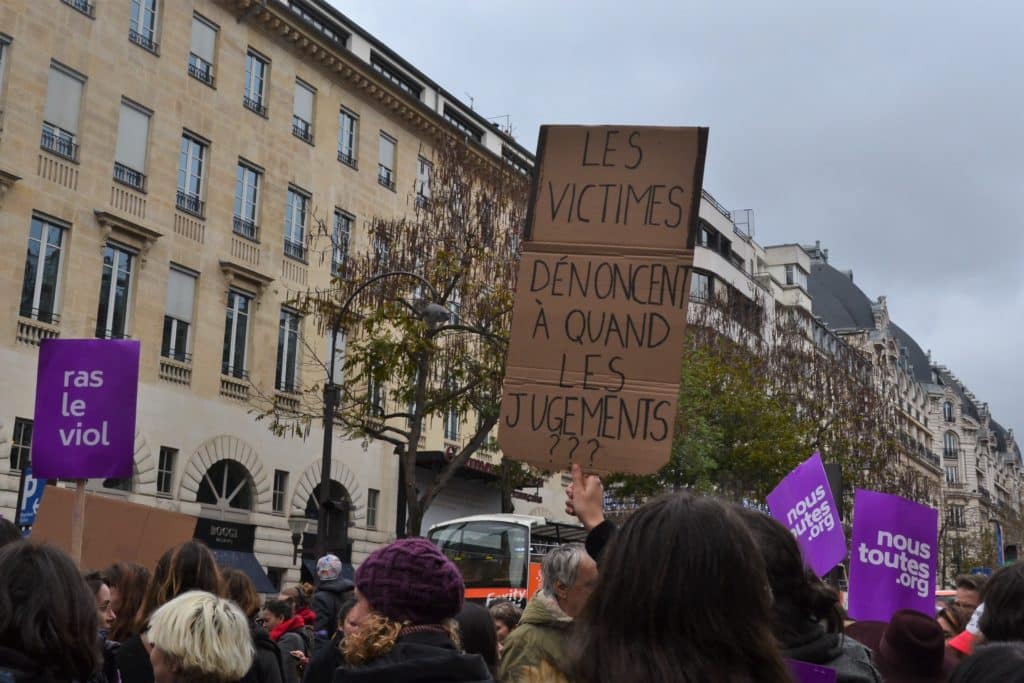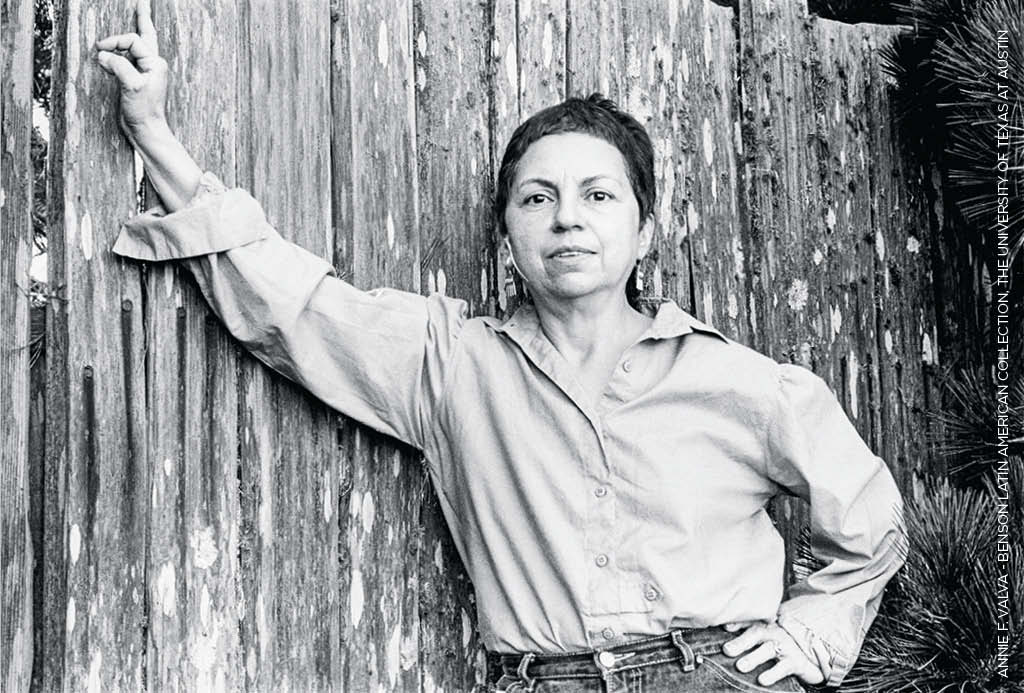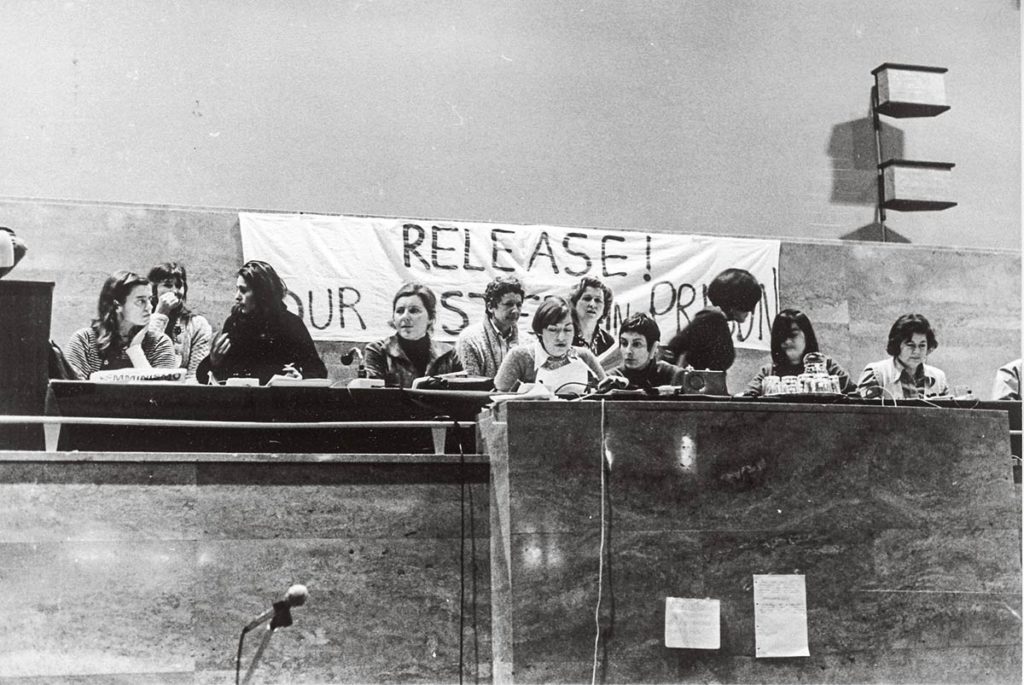Comment définissez-vous la cagole ?
Une cagole, c’est une femme du Sud à la fois sexy, drôle et vulgaire, qui n’a pas sa langue dans sa poche, occupe l’espace public et ne se laisse pas faire. Les cagoles sont bien reconnaissables, elles sont habillées très court et super flashy. Elles remettent en cause l’idée d’une sexualité féminine retenue, qui ne se dévoilerait que dans l’intime.
C’est rare dans un pays aussi misogyne que la France, où on demande aux femmes d’être pudiques et élégantes, c’est-à-dire de se contenir. Les cagoles montrent tout : les émotions, les seins, les fesses. Elles travaillent souvent en extérieur, dans la restauration, dans les bars, sur les marchés ou comme travailleuses du sexe. Elles font la fête, elles boivent, elles sont indépendantes et parlent fort. « Caguer » signifie « déféquer » en argot du sud de la France : la cagole, c’est celle qui fait chier (1). En fait, elles résistent à la misogynie des rues marseillaises par l’expression d’une féminité puissante. La cagole, c’est aussi un délire populaire qui n’a rien à voir avec les codes bourgeois de la féminité parisienne. Se revendiquer cagole, c’est répondre à un mépris parisien et de classe.
Peut-on dire que l’habit fait la cagole ?
Les vêtements, c’est le nerf de la guerre pour la cagole. C’est un peu sa vitrine, c’est à ça qu’on la reconnaît : la minijupe, les bijoux fantaisie comme les créoles, les faux ongles, les cheveux longs. Sans vêtements, il n’y a pas de cagole, juste une meuf qui insulte des gens dans la rue. Mais ce n’est pas parce qu’on porte une jupe léopard le temps d’une soirée qu’on en est forcément une. Être une cagole, c’est aussi une manière de se tenir, de se comporter, de parler. Et les cagoles sont plurielles. Une cagole en RTT – qui porte un jogging rose, des claquettes, des pinces dans les cheveux – est tout aussi identifiable ! Même en pyjama, elle dégage un truc sexy, féminin et vulgaire.

Lisa Granado, Miss Cagole 2024, à La Plaine (place Jean-Jaurès) à Marseille. © Gaëlle Matata pour La Déferlante
Selon vous, en quoi ça peut être féministe d’être une cagole ?
La cagole s’habille de manière extrêmement désirable en sachant que son allure dérange et qu’elle va devoir se défendre face à un harcèlement constant. Cela demande du courage et de la détermination d’assumer qui l’on est et de résister au machisme quotidien. La cagole vit selon ses propres règles. Être une femme qui fait ce qu’elle veut, ça me semble être une bonne définition de l’adjectif « féministe ».
Que répondez-vous à celles et ceux qui pensent que la cagole serait construite par et pour le regard masculin ?
La gagnante de Miss Cagole 2023, Meureh, est une grosse gouine, je suis moi-même une grosse gouine. On n’en a rien à faire du regard des hommes. Cette idée que les femmes qui sont féminines et sexys seraient forcément aliénées, c’est de la femphobie (2). Au contraire, l’hyperféminité des cagoles est tout sauf conforme, elle est hors normes. Notre société a un problème quand elle estime qu’être féminine est dévalorisant. Pour moi, les cagoles et les femmes à la féminité exacerbée sont en avance : elles ont dépassé cette idée qu’il faudrait se masculiniser pour être une « bonne » femme. S’habiller comme on l’entend, c’est libérateur. C’est vrai quand on est une cagole et qu’on décide d’embrasser sa cagolitude, ça l’est également quand on est butch et que l’on décide de s’habiller au rayon hommes ou de se couper les cheveux.
Est-ce qu’il y a une dimension queer dans la figure de la cagole ?
Bien entendu, même si certain·es n’en ont pas forcément conscience. Être une femme ou une personne queer, et choisir de ressembler à qui l’on souhaite être, à qui l’on est réellement : voilà le véritable empouvoirement.
La cagole fait bouger les normes de genre. Il y a quelque chose de très masculin dans sa façon de se comporter – le fait de picoler, de traîner dans les bars, de parler fort.
Pourquoi vous êtes-vous présentée au concours Miss Cagole ?
C’était une évidence. J’ai grandi au cours Ju’-La Plaine (3), pas loin du bar qui organise ce concours [lire l’encadré ci-dessous]. J’habite à Paris, mais j’étais à Marseille au moment du concours, donc je me suis présentée, et j’ai gagné ! Je me considère comme une cagole et une bonne représentante de ma ville. Je connais les habitant·es du quartier, donc c’est aussi un truc sentimental. L’élection de Miss Cagole est un événement à la bonne franquette, sans enjeu, si ce n’est celui de vouloir résister à la gentrification. Le Marseille populaire est très prisé des bourgeois·es et des Parisien·nes. Il y a une exotisation et une romantisation de sa culture, de ses populations paupérisées. Des personnes qui ne vivent absolument pas ces réalités-là se réapproprient certains codes, surtout vestimentaires. Il y a donc quelque chose de jubilatoire à affirmer : vous nous kiffez mais vous serez toujours des fakes – des fakes Marseillais·es, des fakes cagoles, des fakes kékés (4).
Être cagole, c’est donc une identité ?
Pour être une bonne Miss Cagole, il faut être une cagole au quotidien. Sinon, c’est du déguisement. Cette identité, tu l’as ou tu ne l’as pas. La cagole, c’est une femme de caractère, avec une identité complexe : elle est marseillaise ou originaire de la Côte d’Azur, elle a de la répartie mais aussi des qualités humaines. Une cagole, ça réconforte, ça fait rire, ça utilise des noms doux. C’est l’un des seuls archétypes de femmes sexys à être plus qu’un corps. Les autres sont déshumanisés. La femme fatale, par exemple, c’est un personnage de film, une sculpture, pas une femme qui pourrait exister. Les bimbos ou les vamps n’ont ni histoire ni vie réelle. Les cagoles ont une personnalité, de l’humour, et donc elles sont intelligentes… Prêter des capacités intellectuelles à une femme sexy, vulgaire et populaire, ça n’arrive jamais. La société n’a pas l’habitude d’humaniser les gens d’origine populaire. La cagole, elle, remet l’église au centre du village. •
Concours Miss Cagole : potache et politique
Antithèse du concours Miss France, l’élection de la Miss Cagole du quartier de La Plaine à Marseille a sa propre grammaire : défilé, karaoké et concours de tchatche… Son histoire a autant de trous qu’un bas résille : la première édition du concours aurait eu lieu vers 1995, probablement jusqu’en 1998, quand le bar du quartier où se tenait la compétition s’appelait encore L’Avenir, avant de devenir Le Traquenard. Anaelle Loze, sa nouvelle propriétaire et gérante, a relancé la tradition une première fois en 2017, puis en 2022. Face à une gentrification accélérée par la crise sanitaire du Covid, elle ravive une occasion d’affirmer un certain esprit du quartier, en célébrant un Marseille « vivant, populaire, engagé, inclusif… et antiraciste aussi, c’est important en ce moment ».
On comprend qu’il s’agit également de combattre la réappropriation de la cagole à des fins commerciales. Depuis 2021, un autre concours – Miss Cagole Nomade – est organisé par une entreprise d’événementiel éponyme. Tous ces concours ne participeraient-ils pas paradoxalement à la boboïsation de la ville et de ses symboles ? C’est tout ce que réfute Anaelle Loze : « Ah non ! C’est pour ça qu’on le fait hors saison touristique. Pour nous, c’est surtout une teuf. Et le prix, c’est un pot de moutarde, c’est dire si c’est une grosse blague. »
Entretien réalisé par Alix Bayle, en juin 2024, par téléphone. Cet article a été édité par Camille Drouet Chades.
(1) Autre origine étymologique admise : le mot « cagole » viendrait du mot provençal « cagoulo », un long tablier porté par les femmes employées naguère dans les usines d’empaquetage de dattes. Mal payées, certaines devaient se prostituer pour subsister.
(2) Dépréciation ou hostilité à l’égard des personnes qui se présentent comme féminines. En anglais, « femme » (prononcé « fèm ») désigne les lesbiennes dont l’apparence est jugée féminine, en opposition au terme « butch » qui qualifie les lesbiennes dont l’apparence est jugée masculine.
(3) Le cours Julien et La Plaine sont deux places du centre de Marseille.
(4) En anglais, « fake » désigne un faux, une contrefaçon ou une imitation. Le « kéké », aussi appelé « cake », est un homme qui prend soin de sa plastique et se met en scène dans l’espace public pour attirer l’attention.