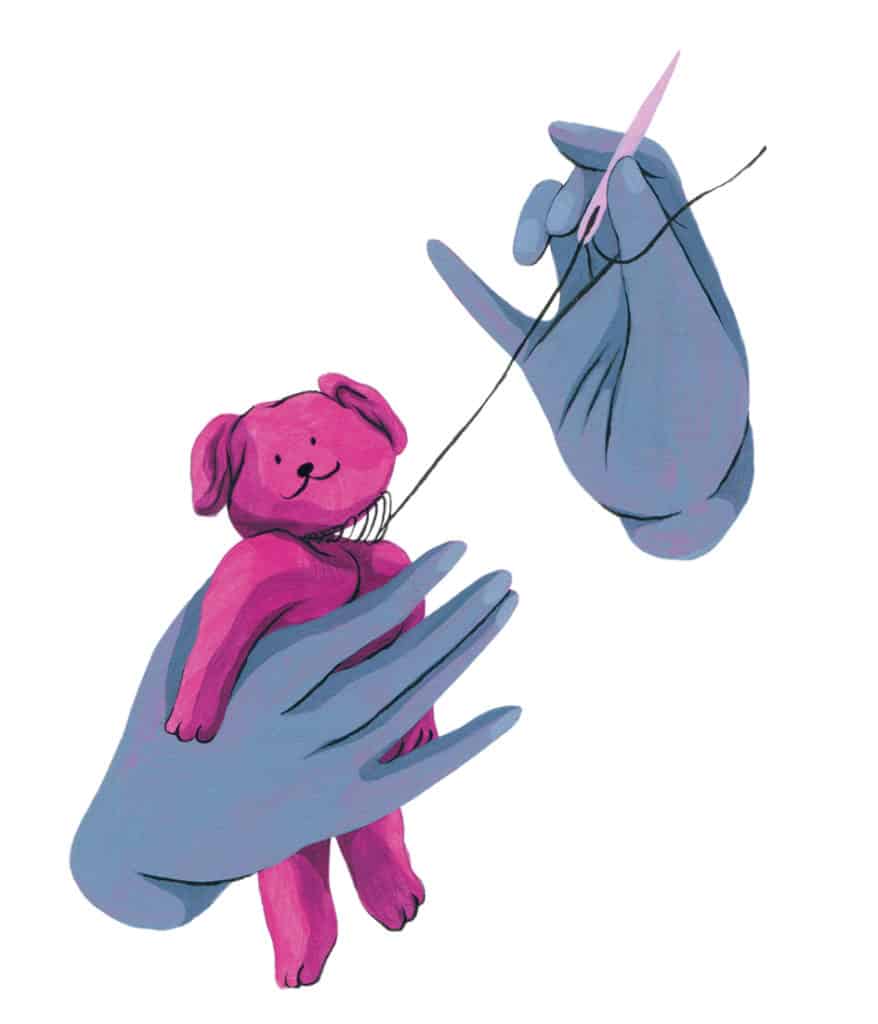Travailleuse sociale, ancienne directrice d’association d’accueil pour les jeunes victimes d’inceste, Nathalie Mathieu a coprésidé, avec le juge Édouard Durand, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) entre 2021 et 2023 avant d’en être évincée. Elle est l’autrice de Personne n’est prêt à entendre ça. Violences sexuelles faites aux enfants (L’Harmattan, 2024).
Quelques semaines après que Caroline Darian, la fille de Dominique Pelicot, a porté plainte pour viol contre son père et tandis que le procès Le Scouarnec met en lumière depuis plusieurs semaines les mécaniques incestueuses à l’œuvre dans beaucoup de familles, Nathalie Mathieu décrit la spécificité de ce crime assimilé à tort aux autres violences sexuelles et propose des pistes d’action pour l’éradiquer.
Procès des violeurs de Mazan, procès Le Scouarnec : dans ces deux affaires, les hommes jugés pour violences sexuelles sont également accusés d’inceste. Est-ce une coïncidence ?
Ces deux affaires très médiatisées ne sont pas forcément représentatives de la réalité. Car le plus souvent les auteurs d’inceste ne vont pas agresser des enfants en dehors de leur famille. Comme le dit l’anthropologue Dorothée Dussy, l’inceste est « un viol d’opportunité » car les enfants du cercle familial sont des proies faciles et les agresseurs peuvent « se servir » facilement. Joël Le Scouarnec a agressé sexuellement ses nièces, mais le secret a été gardé à l’intérieur de la famille. Ce n’est que quand il a violé la fille de ses voisins, âgée de 6 ans, qu’il a été dénoncé et que les carnets dans lesquels il consignait méthodiquement ses agressions ont été découverts.
Comme celui de Joël Le Scouarnec, le père de Dominique Pelicot se serait rendu coupable de viols et d’agression sur des enfants de la famille. Est-ce un schéma fréquent dans les affaires d’inceste ?
L’inceste n’arrive jamais par hasard car il préexiste toujours, dans les familles où il est dévoilé, un terrain incestuel, incestueux*, des rapports flous à la loi, des agresseurs égocentriques qui ont une difficulté à être empathique. Les témoignages reçus à la Ciivise parlent beaucoup de ces schémas qui se transmettent : de père en fils, chez les frères, les oncles. Du côté des mères, le silence se transmet également de génération en génération. D’où l’importance de stopper la chaîne.
Malgré tout, dans le champ judiciaire comme dans le champ politique, l’inceste est toujours traité comme le corollaire d’autres violences et très peu en tant que tel…
Notre société est construite sur deux croyances : d’abord que l’inceste serait marginal parce que tabou, ce qui est largement contredit par les chiffres [une personne sur dix en est ou en a été victime selon une enquête réalisée en 2020 par l’institut Ipsos], ensuite l’idée que ce qui se passe à l’intérieur de la famille relèverait de la sphère privée. Quand une victime parle – et encore plus quand elle accuse le chef de famille –, elle met à mal ces deux croyances et c’est elle qui est mise au ban de la société.
L’inceste reste considéré, encore aujourd’hui, comme le problème individuel de la victime et non pour ce qu’il est : un problème de santé publique. Malgré l’ampleur du phénomène, c’est toujours l’incrédulité qui domine quand on en parle et c’est ce qui empêche la société de conscientiser ce phénomène. On sait très bien – car les études sur le sujet sont nombreuses – que le lieu de tous les dangers pour l’enfant, c’est d’abord sa maison et sa famille. Mais les médias préfèrent s’intéresser à la figure du monstre. Ce déni contamine les familles, les institutions scolaires, juridiques, sociales.
« Les professionnel·les ont trop rarement à l’esprit que l’enfant est peut-être victime de violences sexuelles, alors que ça devrait être l’hypothèse numéro un. »
Un an et demi après la remise du rapport de la première équipe de la Ciivise, à l’automne 2023, qu’est-ce qui a vraiment changé ?
Avec cette première équipe, nous avons fait un point sur l’état actuel des connaissances sur l’inceste et ouvert un espace de parole inédit pour les victimes. En 2023, nous avons remis 82 préconisations : elles concernent le repérage des violences sexuelles par les professionnel·les, leur traitement judiciaire, les parcours spécifiques de soins et la prévention. En 2024, une nouvelle équipe a été nommée à la tête de cette institution. Elle n’a retenu que 16 de nos recommandations, dont la création d’une ordonnance de sûreté qui permet de mettre rapidement à l’abri les enfants, la clarification du processus de signalement et la protection des médecins, le questionnement systématique de l’enfant ou la facilitation de l’accès aux soins spécialisés pour les jeunes victimes. Je ne sais pas pourquoi celles-ci plutôt que d’autres. En tout cas, je ne vois pas d’effets concrets sur le terrain. L’objectif était de mettre en œuvre une politique publique ambitieuse pour protéger les enfants : on est très loin du compte.
Quelles seraient, selon vous, les mesures politiques à mettre en place urgemment pour lutter contre l’inceste ?
Sensibiliser les enfants au maximum est fondamental. Elles et ils doivent savoir qu’il y a des choses qui ne se font pas, mettre des mots dessus. Savoir aussi qu’il existe des adultes en capacité de les écouter et de les aider. Les associations qui actuellement s’opposent à l’enseignement d’un programme sur la vie affective, relationnelle et sexuelle aux enfants à l’école ont tort : moins on parle de sexualité aux petites filles et aux petits garçons, plus on préserve l’agresseur.
On sait que ces séances sont souvent l’occasion pour elles et eux de prendre la parole sur ce qui leur est arrivé. Et comme l’inceste est un phénomène massif, il faudrait que cette parole soit au cœur des préoccupations de tous les adultes qui travaillent avec des enfants. Quand leur comportement change, on cherche toujours plein d’excuses : ses parents divorcent, elle a eu un petit frère, il a déménagé, sa grand-mère est morte… Les professionnel·les ont trop rarement à l’esprit que l’enfant est peut-être victime de violences sexuelles, alors que ça devrait être l’hypothèse numéro un.
* Le terme « incestuel » renvoie à un climat familial dans lequel les limites sur la sexualité des adultes et celle des enfants ne sont pas clairement posées. Une famille « incestueuse » est une famille dans laquelle des actes incestueux sont commis.