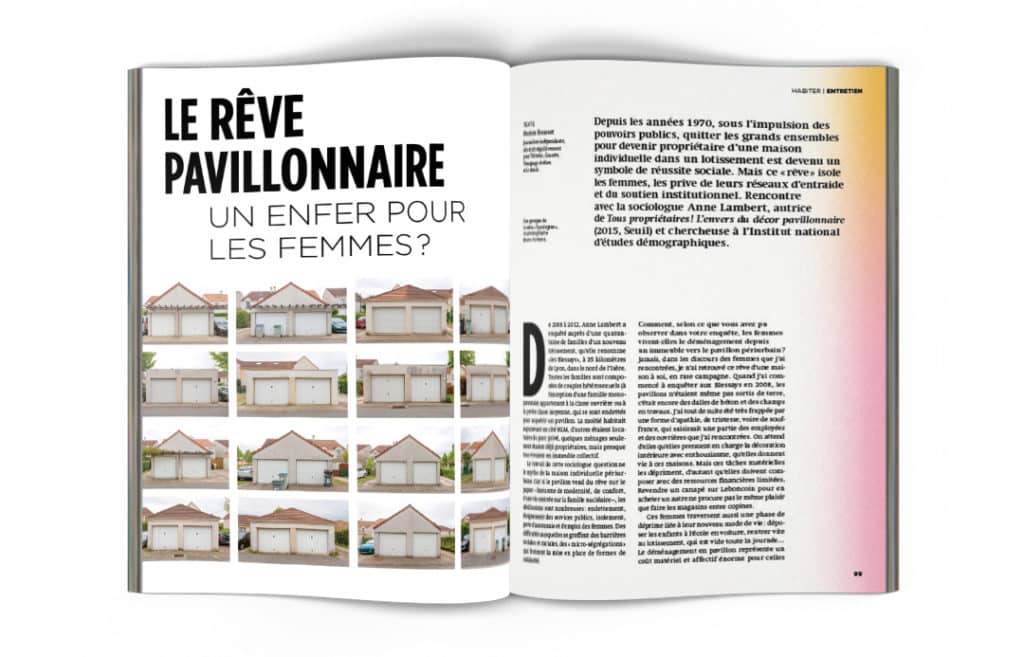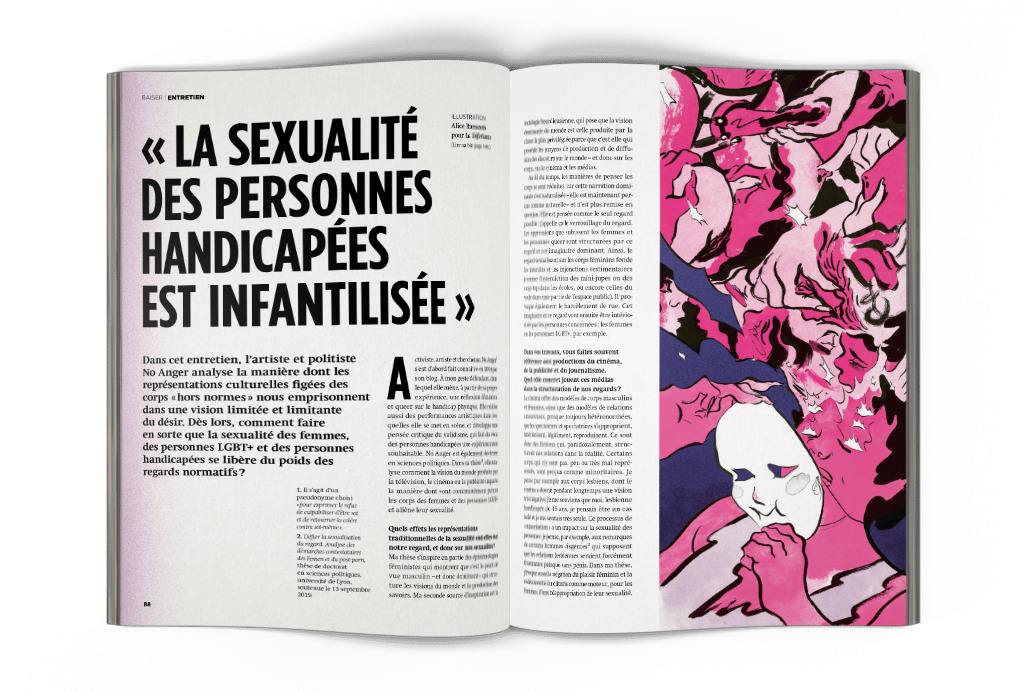Alors que 12 millions d’élèves font leur rentrée cette semaine, où en est la prise en charge des violences sexistes et sexuelles dans les établissements ? Neuf ans après la panique morale provoquée par les ABCD de l’égalité (lire notre article dans le numéro 7 de La Déferlante), les réflexions sur le genre restent apparemment un angle mort des enseignements et de la vie scolaire.
Yuna Visentin, professeure de français, restera longtemps marquée par ce débat organisé, il y a quelques années, dans une de ses classes de troisième : « Les hommes doivent-ils protéger les femmes ? » D’un exercice banal, l’expérience se transforme en fiasco pédagogique : des garçons prennent seuls la parole et empêchent les filles de s’exprimer, jusqu’à l’altercation.
Cette anecdote, qui ouvre l’essai qu’elle publie en cette rentrée, en dit long, selon elle, sur la difficulté à interroger les logiques de domination au sein d’une institution historiquement sexiste. « Dès sa naissance vers 1880, explique la professeure, le projet politique de “l’école républicaine” a été de séparer filles et garçons, renforçant de fait la binarité, l’hétéronormativité et les assignations de genre, en vue de l’exploitation par les hommes des personnes assignées femmes. Les textes de Jules Ferry sont très clairs sur la nécessité de préparer les filles à être des femmes au foyer. »
Les enseignant·es ne sont pas formé·es sur les questions de genre
Et si la mixité s’est mise en place dans les années 1960, « cela s’est fait sans aucun accompagnement pédagogique » et, aujourd’hui encore, sans « réelle mise à distance institutionnelle de cette histoire ». Pour Yuna Visentin, les violences subies à l’école par les personnes minorisées « ne sont pas un débordement », elles « organisent notre société », précise-t-elle. « Elles arrangent la société patriarcale, car elles nous minorent, nous paralysent. C’est très clair avec les violences racistes, mais c’est également vrai pour le sexisme. »
Pourtant, il serait faux d’affirmer que l’Éducation nationale ne s’est pas emparée de ces questions : « Si l’on se réfère aux circulaires, la question du genre est bien abordée », explique Séverine Pinaud, professeure de cinéma-audiovisuel dans un lycée toulousain et membre du collectif Ça commence à l’école. « Dans les textes, il est clairement énoncé que le genre est une construction sociale qui entraîne des violences contre lesquelles il faut lutter. »

Pour la professeure Yuna Visentin, le modèle d’école pensé par Jules Ferry, renforce la binarité et les stéréotypes de genre. Crédit photo : Google creative commons.
Les protocoles en place sont méconnus ou
non respectés, et les dispositifs existants ne sont par ailleurs pas suffisants. Ainsi, alors même que l’enseignante est l’une des deux référentes « Égalité » de son établissement, elle raconte n’avoir reçu aucune formation, aucune décharge, ni aucune compensation financière pour cette responsabilité. Au-delà de son cas, elle dénonce le fait que les enseignant·es ne sont pas tous·tes formé·es sur la question des oppressions de genre, donc « lorsque certain·es l’abordent en classe, c’est en fonction de leur déconstruction personnelle ».
Malgré tout, des initiatives existent localement. Ainsi, le collectif Ça commence à l’école, dans lequel milite Séverine Pinaud, est né à l’automne 2019 de la mobilisation de militantes et de syndicalistes féministes, après qu’une alerte a été lancée au sujet de quatre viols collectifs sur une adolescente de 14 ans aux abords d’un collège toulousain. Des rassemblements en soutien à la victime et à sa famille ont été organisés, l’inaction du collège et du rectorat a été dénoncée, et la lanceuse d’alerte a finalement été mutée pour poursuivre sa carrière sereinement. Séverine Pinaud remarque : « Nous avons développé une expertise pour aider nos collègues confronté·es à des violences sexistes et sexuelles subies par des élèves, notamment lorsque leur chef·fe d’établissement ne suit pas la procédure appropriée. »
« LE PROJET POLITIQUE DE L’ÉCOLE RÉPUBLICAINE A ÉTÉ DE SÉPARER FILLES ET GARÇONS, RENFORÇANT DE FAIT LA BINARITÉ
ET LES ASSIGNATIONS DE GENRE. »
Que ce soit le fait de militant·es de terrain ou de chercheur·euses, les logiques de genre et les oppressions qu’elles génèrent à l’école sont largement documentées. Dans un ouvrage qui paraît en cette rentrée, la géographe Édith Maruéjouls raconte comment elle accompagne des établissements scolaires à repenser l’aménagement de leur cour de récréation.
En intervenant auprès des équipes éducatives, des élèves et des administrations locales, elle aide à observer et nommer les problématiques de genre qui traversent cet espace : quel jeu accapare le plus de place dans la cour ? Le football. Qui y joue ? En général, des garçons. Où jouent les filles ? En périphérie de la cour. Est-ce que filles et garçons se mélangent ? Non. Une fois le constat établi, les équipes éducatives et les élèves dessinent ensemble un lieu où chacun·e est libre d’être égal·e : « Après mes interventions, écrit-elle, les filles me disent “je peux jouer à mes jeux”, mais surtout, “les garçons jouent enfin avec nous”. C’est-à-dire qu’on permet à des êtres humains de se parler. »
« Je n’ai jamais reçu un centime de l’Éducation nationale »
Un dispositif enthousiasmant qui ne peut se mettre en œuvre qu’à une échelle locale et qui, par ailleurs, semble ignoré au niveau national : « Je n’ai jamais reçu un centime de l’Éducation nationale, nous explique la chercheuse, je suis uniquement missionnée et payée par les collectivités locales. Tout au plus, l’Éducation nationale a repris mon travail sans me citer. »
Toutes nos interlocutrices insistent, malheureusement, sur la limite des actions individuelles. Pour Yuna Visentin : « On peut toujours tomber sur le bon ou la bonne professeur·e, ou la bonne école qui va prendre ces enjeux à bras-le-corps. Mais c’est incertain et c’est un problème. Il faut sortir du local, qui fait porter la responsabilité d’un changement sur l’individuel plutôt que sur une transformation collective. Il nous faut penser le collectif. » Pour cette nouvelle année scolaire, Ça commence à l’école réfléchit à mettre en place une formation syndicale dédiée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, afin d’augmenter les rangs des professionnel·les à même de se mobiliser collectivement, de mettre en place un rapport de force. « Sans cela, le rectorat nous ignore », explique Séverine Pinaud.
Précommandez le dernier numéro de La Déferlante !
Pour ce premier numéro de 2023, nous consacrons notre dossier au thème BAISER car, oui la révolution sexuelle reste encore à venir ! On y parle de sexologie féministe, de désirs qui font désordre, on y déconstruit les normes validistes et on plonge à pieds joints dans le récit de science-fiction érotique « Tout est chaos », signé Wendy Delorme et Elise Bonnard.
⟶ Vous souhaitez recevoir La Déferlante, au tarif de 15 euros (au lieu de 19), et sans engagement ? Découvrez notre offre d’abonnement à durée libre.