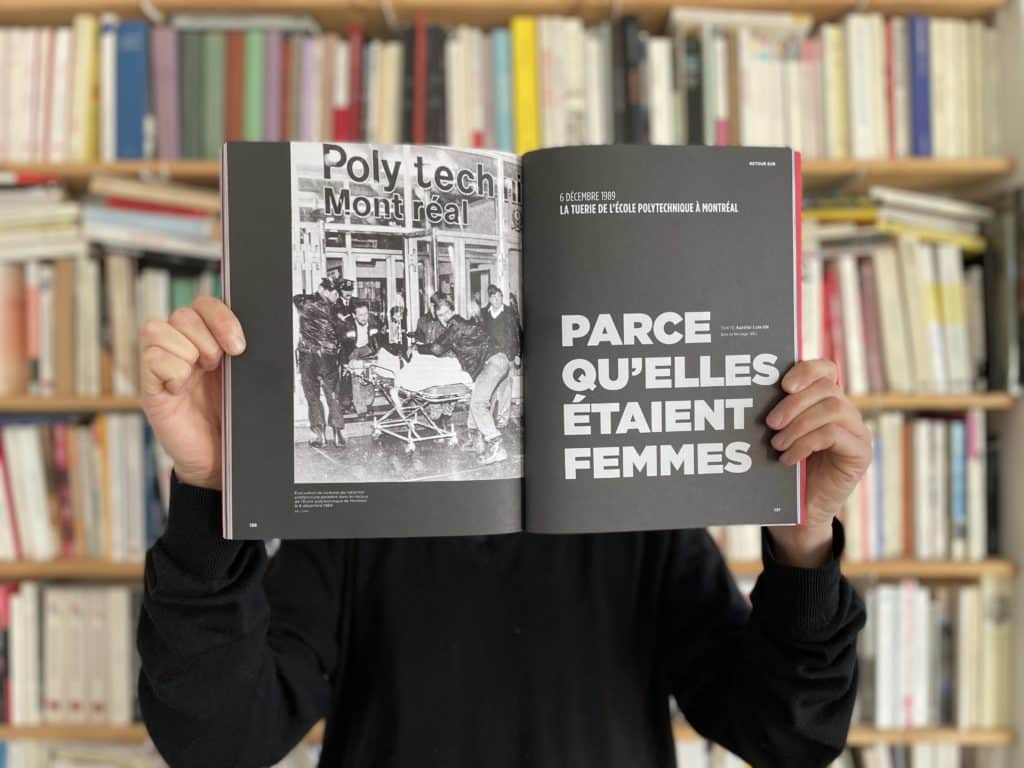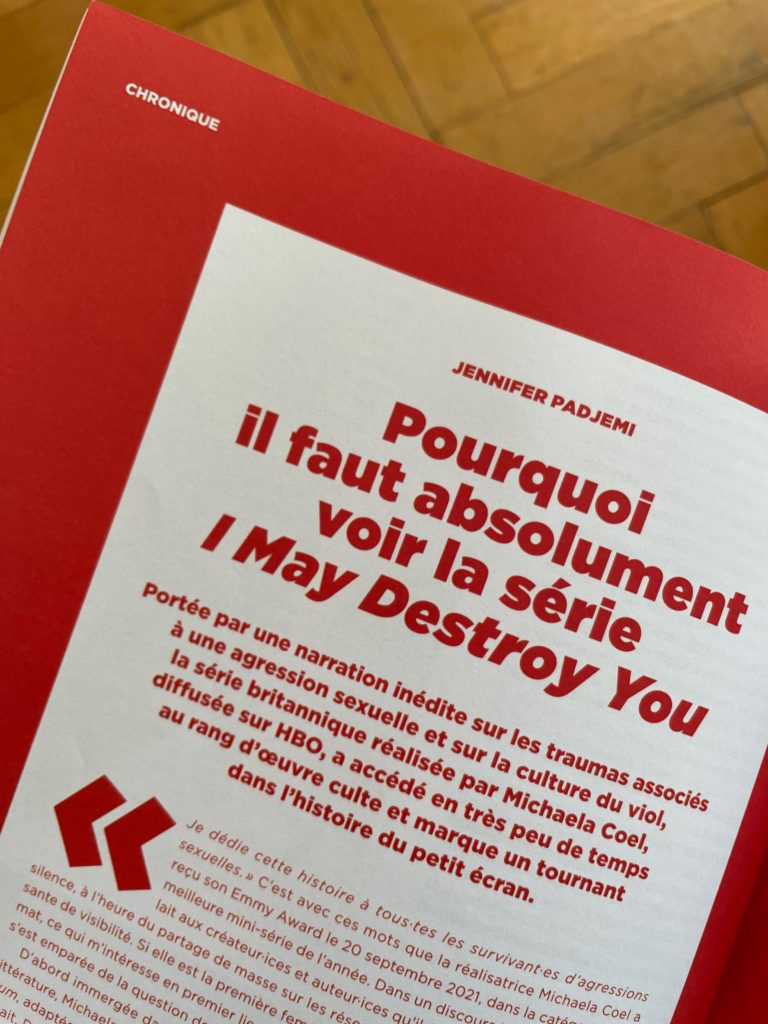Le 21 janvier 2025, une mission parlementaire menée par les députées Marie-Charlotte Garin (Les Écologistes) et Véronique Riotton (Renaissance) rendait un rapport préconisant une clarification de la notion de consentement dans la loi française sur le viol.
Pourquoi la notion de consentement n’a « jamais été une chose simple et évidente » à saisir, comme vous l’écrivez dans votre livre ?
À l’heure actuelle, on parle du consentement comme s’il s’agissait d’une nouveauté. Pourtant, c’est une notion centrale aussi bien dans la théorie politique moderne que dans les systèmes juridiques des démocraties occidentales. Ce qui se passe, c’est qu’une nouvelle approche du consentement est en train de percer, celle du consentement positif, ou affirmatif.
Dans les années 1980, il y a eu tout un débat aux États-Unis sur les violences sexuelles au sein des universités, avec des cas impliquant des professeurs et des étudiantes. Sous l’impulsion des mouvements féministes, l’idée s’est imposée que, pour plus de prudence, le consentement devait être exprimé de manière positive : le consentement, ce n’est pas seulement les situations dans lesquelles on ne dit pas « non », c’est quand on dit « oui ».
Dans cette configuration, le « oui » devient la seule manière de prouver le consentement. Dans les années 1990, cette nouvelle conception du consentement a infusé dans la rédaction de textes en loi, en Californie par exemple. Est-ce la seule façon d’envisager le consentement et de l’inscrire dans la loi ? Non, mais c’est l’idée la plus répandue aujourd’hui.
Une autre manière de définir le consentement est la voie négative, comme en France [lire notre encadré ci-dessous], où la définition légale du viol déduit le non-consentement lorsqu’il est fait usage de violence, de menace, de contrainte ou de surprise…
C’est vrai. Et l’Allemagne est aussi un bon exemple de cette manière de concevoir les choses : les textes de loi établissent qu’il n’y a pas consentement quand une personne dit « non », mais détaillent également les circonstances où il n’est pas possible de dire « non » — et de manière plus exhaustive que dans les textes français actuels. Car le viol c’est aussi toutes les fois où l’on n’a pas eu la possibilité de dire « non » : parce qu’on a eu peur, parce qu’on est mineure, parce que l’agresseur a utilisé son pouvoir pour nous contraindre…
« Le consentement est un concept qui peut dissimuler des inégalités de pouvoir. »
Clara Serra
Vous dites que vous regrettez que l’on soit passé du slogan « non c’est non » à l’idée que « seul un oui est un oui ». Pourquoi ?
Si l’on s’engage dans la voie où le « oui » devient la preuve indiscutable du consentement, on se retrouve dans une perspective clairement libérale et, à mon sens, problématique. Car il existe des situations où le consentement est vicié. Par exemple, une femme peut dire « oui » sous la menace, dans un contexte d’intimidation… Ce contexte n’est pas pris en compte lorsque l’on fait du « oui » un mot magique ; il est au contraire complètement occulté. Il faut être conscient·es que le consentement est un concept qui peut dissimuler des inégalités de pouvoir. Il me semble que la gauche avait raison quand, face au libéralisme, elle rappelait qu’aucun « oui » n’est libre s’il n’est pas assorti de la possibilité de dire « non ». Un·e travailleur·euse n’accepte un emploi de manière libre que si le refuser est également possible. Les femmes ne sont libres de dire « oui » que lorsqu’elles sont libres de dire « non », et le « non » me semble alors être une délimitation beaucoup plus claire du consentement.
Ces derniers mois, en France, dans le contexte du procès des violeurs de Mazan, des féministes et des politiques ont proposé d’intégrer le terme de « consentement » à la définition légale du viol. Qu’en pensez-vous ?
La loi française fonctionne déjà sur le principe du consentement, mais par la négative : c’est l’absence de consentement que la loi tente d’identifier lorsqu’elle tient compte de la violence, la menace, la contrainte ou la surprise qui ont pu s’exercer. Mais ce n’est pas explicite, c’est vrai ; or il est opportun que la loi énonce clairement son propre principe réglementaire. Je pense qu’il est possible d’être exhaustif·ves dans la recherche des critères qui faussent le consentement. Par exemple, dans un cas où il y a eu intimidation, il faut se demander à partir de quel moment l’asymétrie des positions de pouvoir est suffisante pour invalider le consentement. La véritable discussion politique se cache ici et c’est là que le féminisme a beaucoup à dire.
Ce que dit la loi française
En France, le Code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». Si la base de cette définition date de 1980, le critère de menace n’a été introduit qu’en 1994, et la mention des actes bucco-génitaux en 2021. Cette dernière permet de parler de viol même lorsque la victime n’est pas pénétrée.
→ Pour aller plus loin :
Clara Serra, La Doctrine du consentement, La fabrique éditions, 2025, 13 euros.